Le vingtième siècle commence au dix-neuvième.

Ce n'est pas tout à fait le siècle auquel on nous a fait croire.
Je concentrerai le faisceau de ma lunette sur quelques individus. Ce sont pour la plupart de grands héros, décorés, célébrés, membres de familles dynastiques. Ce sont les bergers bienveillants qui guident avec tendresse l’humanité vers son égorgement industriel. Les canevas, patrons et méthodes devisés au tout début de l’histoire de la colonisation ont été reconduits.
Une part importante des fortunes vertigineuses qui ont bâti la côte Est des É-U ont été constituées par des actes de piraterie. La flibuste amenait à ceux pour qui la fortune avait souri des sommes colossales accumulées rapidement. La plupart des grandes familles de pirates ont réinvesti leurs gains dans les plantations de coton et de tabac du Sud. Dès lors se dessine donc une technique, un modus operandi de ascension matérielle, qui fera école dans les décennies subséquentes.
Je vous convie, lecteurs, lectrices, et tout, à une sorte d'expérience. Il faudra en chemin se départir d'un lourd manteau, cousu d'idées reçues, de diktats, de dogmes, de tampons. Certains n'y parviendront pas. Faudra étrangler ses petits, parfois. Faudra rompre avec des images de carton pâte sur lesquelles on a construit de grands pans de nos domaines de certitude. Certains feront un bout de chemin mais seront incapables d'aller jusqu'au bout. Je ne suis pas certain, au moment d'écrire ces lignes, d'avoir la force, la patience et l'endurance de m'y rendre moi-même. À certains moment, je crois bien tomber, exsangue. Ce sont de rares humains qui me permettent de renouveler constamment ce travail d'amour. Et je retourne grâce à eux, pour eux, et avec leur descendance en tête, pétrir, nourrir, arroser.
Nous avons grandi dans la poigne implacable d'un système de valeurs et d'éducation dont une des principales fonctions était de perpétuer cette supercherie fondamentale : laissée libre, l'humanité retourne à la sauvagerie.
Nous portons tous le poids d'une sorte de culpabilité magique, celle de la bestialité, de l'abominable nuit des temps, celle de la nature. En associant la Shoah à la barbarie, et en tatouant ce concept de dix-mille façons dans notre langage, dans notre pensée, jusque dans nos désirs inconscients (masochistes, sadiques, tintouin), la ville s'est lavée les mains de ses crimes. La Cité, l'Empire, la Civilisation, ont été amenées à leur degré suprême de perfection technique au cours de ce Mauvais Siècle. Et cette évolution a entraîné pour l'être humain une croissante aliénation, un malheur inédit, une souffrance inouïe, et le grand, l'immense mensonge avec le joug duquel l'Homme doit aujourd'hui composer est celui-là : Toute personne convaincue de trahison idéologique en admettant son incapacité à vivre dans l'organisme sera taxé de mésadaptation, un terme emprunté à la pseudo-science de ces charlatans meurtriers d'eugénistes. Toute personne réclamant sa place légitime sous le soleil sera rompue. Pleurer est déjà un crime, du moins pleurer le monde, pleurer comme la rivière coule, comme la vie !... On nous convaincra en échange de pleurnicher, de mouchotter, de braillotter des océans de sentimentalisme mièvre, désâmé, dépiauté, séché de sa vie. « Des crimes contre le sentiment », a dit Thiran un jour et j'ai bien failli l'embrasser.
Il est venu le temps de se sauver avec les trésors, amis, citoyens, frères et sœurs. Les trésors sont connus de ceux d'entre nous qui sont prêts à faire le prochain saut, mais ce qui est fantastique est que la Cité n'en a cure. L'empire méprise les seuls trésors qui valent d'être emportés et c'est pourquoi on nous laissera quitter sans la moindre opposition. Les arts, évidemment, je parle des arts, les jouissances, le vin ! Le pain ! Le fromage ! La ville ne se souvient même plus du goût que ça avait jadis. On nous distribue des produits. Nous jouons le jeu grotesque. La bouteille est vide ? Pleine de boue ? C'est le rituel qui compte. La ville est sourde. Elle martèle inutilement ses tambours militaires, tonitruants, et depuis vingt ans, ses imitations synthétiques de tambours militaires. L'empire n'a plus que cette voix, celle de l'ordinaire, de l'ordonnance, de l'ordre... L'empire parle à l'impératif ! La ville rêve de créer l'ordre là où elle ne voit que chaos. Nous passerons indétectés sous ses fils barbelés. Elle restera seule, là-bas, tentant encore d'ordonner le chaos. De se faire passer pour l'Ordinatrice.
Sans un choc, nous aurons simplement coupé sa source. Lentement elle retournera aux ronces. Et pierre par pierre, caillou par caillou, fente par fente, les murs tomberont assoupis. Tout ce béton redeviendra du sable et le désert vertical s'étendra, s'évanouira, bien allongé, pour son grand repos. Emportons les guitares. Les livres. la peinture. Emportons nos chevelures. Nos orteils. Nos prunelles. Emportons le savoir. Emportons nos découvertes. Emportons le minimum. Emportons ce que nous pouvons porter. Emportons, surtout, les enfants.
Inutile d'emmener leurs jouets, la Terre les attend.
Chapitre 1 - William Walker
William Walker,  petit-fils du lieutenant Lipscomb Norvel, et cousin du Sénateur John Norvell, débute sa vie comme journaliste, mais se fait vite remarquer en 1854 en se lançant, à la tête d’une armée de mercenaires, à l’assaut des provinces mexicaines de Baja et Sonora. Il s’en proclame ensuite le président, jusqu’à ce que l’armée mexicaine le repousse en Californie.
petit-fils du lieutenant Lipscomb Norvel, et cousin du Sénateur John Norvell, débute sa vie comme journaliste, mais se fait vite remarquer en 1854 en se lançant, à la tête d’une armée de mercenaires, à l’assaut des provinces mexicaines de Baja et Sonora. Il s’en proclame ensuite le président, jusqu’à ce que l’armée mexicaine le repousse en Californie.
Qu’à cela ne tienne, tentant de profiter de la guerre civile financée par l’angleterre au Nicaragua, notre héros s’embarque avec les hommes qui lui restent et part à l’assaut du pays d’amérique centrale, qui représente à l’époque la seule route reliant New York et San Francisco. Il sera financé dans son projet par Cornelius VanDerBilt, qui transportera ensuite gratuitement renforts et équipements. Le premier septembre 1855, son immense et glorieuse armée de 350 hommes s’empare du pays. Après quelques mois à jouer les montreurs de marionnette, il se déclare président de la République du Nicaragua.
Walker, un sérieux visionnaire pour l’époque, s’empresse de rétablir l’esclavage (interdit en 1824), de réduire toute dissidence et opposition à néant et de céder tous les droits nationaux possibles à ses copains de Wall Street. Il organise même une élection au cours de laquelle il n’affronte aucun autre candidat, qu’il remporte haut la main (« si la tendance se maintient… »).
Son destin bascule lorsqu’il trahit VanderBilt pour favoriser ses rivaux Garrison et Morgan, qui achètent sa loyauté contre des livraisons d’armes et d’or. Garrison et Morgan reçoivent une lettre de VanDerBilt : « Chers messieurs, vous avez entrepris de me flouer. Je ne vous poursuivrai pas, la justice est trop lente. Non, je vais vous ruiner. Bien à vous, Cornelius VanDerBilt »
Le puissant Cornelius réussit rapidement à écraser Walker en organisant une coalition des gouvernements voisins, qui resteront ensuite éternellement de fidèles et serviles polichinelles de Wall Street. Notre héros se réfugie encore impunément aux États-Unis. Cependant, au cours d’une ultime tentative de conquête, l’infatigable William Walker sera capturé par les Britanniques, livré au Honduras, puis exécuté.
Voilà au moins une histoire qui finit bien.
Chapitre 2 - Samuel Walker
Samuel Hamilton Walker est un héros mythique de la conquête (ou de la perte, selon l'angle de vue) de l'Ouest. Sam survécut aux deux grandes humiliations de la guerre du Texas. Il échappa à la mort au Fort Alamo (en évitant simplement de s'y trouver) et réussit ensuite l'inénarrable en gagnant sa survie lors de la tenue par le général Santa-Ana de la célèbre loterie des bines, au cours de laquelle un prisonnier sur dix parmi un groupe d'évadés repris allait être exécuté. Il s'évada de nouveau et entra pour de bon dans la légende.
Il échappa à la mort au Fort Alamo (en évitant simplement de s'y trouver) et réussit ensuite l'inénarrable en gagnant sa survie lors de la tenue par le général Santa-Ana de la célèbre loterie des bines, au cours de laquelle un prisonnier sur dix parmi un groupe d'évadés repris allait être exécuté. Il s'évada de nouveau et entra pour de bon dans la légende.
En réalité, Samuel Hamilton Walker doit surtout sa grande renommée à la révolution industrielle. Il en fut un des plus grandioses artisans à titre de co-inventeur du Walker-Colt, un des premiers pistolets à répétition, qui connut une popularité indéniable (comparable à celle du iPod aujourd'hui) au pays des braves zé des libres, au milieu du 19e siècle. Il faut admettre que Sam Walker s'y connaissait en pogroms au pistolet. Il avait utilisé à bon escient le Patterson (une des premières versions du revolver Colt) au cours de la campagne d’extermination que le gouvernement des États-Unis mena contre les vilains Seminoles, peuplade agricole, pacifiste et sédentaire, qui avait eu la très impardonnable idée d’habiter la Floride.
Le beau Sam, amateur de castagne, servit ensuite dans la plupart des nobles conflits de l’époque. Il s'illustra, revolver au poing et crinière au vent, au cours de guerres génocidaires contre les Cris, les Comanches, les Kiowas et les Sioux. Il monta en grade, et c’est à titre de Capitaine des Mounted Rifles qu’il alla proposer à Sam Colt, alors pratiquement ruiné, de créer un pistolet répondant à ses exigences de massacreur expérimenté. Les deux Sam partirent en affaires. Le Walker Colt était né. Force est d'admettre que les connexions, déjà à l'époque, faisaient parfois des miracles. Le secrétaire du Trésor de l’époque, Robert J Walker, introduisit notre noble Sam au président Polk, qui fit placer la première de nombreuses commandes de 1000 unités de ces pistolets. Un autre lien familial unissait apparemment Samuel au futur maire de New York William Magear Tweed, membre comme lui de la loge Tammany (sorte de mafia démocrate de l'époque).
Ironiquement, en 1847, c'est avec son révolver de rêve, son précieux Walker-Colt à six coups, que Samuel Hamilton Walker rata un fantassin mexicain armé seulement d'une lance. La grossière pointe de fer de cette hallebarde en bois le transperça mortellement sur le champ de bataille, à Huamantla, au Mexique. Ses descendants s'arrangeront plus sagement pour profiter de la guerre bien à l'abri des égratignures ! Samuel Colt ne manqua pas d'exploiter la mort glorieuse de son partenaire pour exalter les vertus (?) de son pistolet. On raconte que c'est cette arme qui aurait permis à la « civilisation » de soumettre
La statue de Samuel Hamilton Walker trône au coeur du musée des Texas Rangers, à deux pas du ranch du président Georges Walker Bush, situé à Waco, Texas. l'Ouest.
 Les bonnes gens de ce monde sont bien loin d’être satisfaits les uns des autres et mes armes sont les meilleurs pacificateurs qui soient.
Les bonnes gens de ce monde sont bien loin d’être satisfaits les uns des autres et mes armes sont les meilleurs pacificateurs qui soient.
Sam Colt, était le Bill Gates du 19e siècle. Ce qu’il a inventé, en réalité, était surtout son propre mythe, son personnage. Samuel Colt est le prototype de l’inventeur du futur, celui du mauvais siècle, l’inventeur qui n’invente rien. Le créateur sans créativité, le démiurge qui bizarrement, mettra inversement au monde des machines de mort… Le créateur qui détruit !…
L’anecdote médiatique, mille fois reprise, donc plus vraie que le soleil au milieu du ciel, veut que Samuel Colt, au cours d’un voyage en bateau à vapeur, ait inventé le revolver. Il aurait observé longuement le mouvement de la roue à aube, ce qui lui aurait donné l’idée prodigieuse qui fera sa renommée.
En fait, ce voyage l’avait mené à Calcutta, en 1830. À cette époque, une arme faisait fureur chez les officiers britanniques en poste aux Indes, un pistolet anglais à répétition utilisant un système à barillet, INVENTÉ par Elisha Hayden Collier et breveté à Londres en… 1818 !… Son invention avait été inspirée par un prototype français plutôt commun dans les armureries royales de Louis XIII, datant du début du 17e siècle ! Qu’à cela ne tienne !… Hot damn, there’s top dollar to be made !… Le mythe de l’industriel génial se cherche des Mozart et ce seront surtout des armuriers, les Colt, Remington, Winchester, et Gatling, que la deuxième moitié du siècle retiendra, peut-être parce que la capacité de donner la mort à grande échelle donne à l’homme un aspect quasi divin dans l’œil de cette petite conne qu’est l’Histoire.
Samuel Colt se faisait appeler Colonel, sans qu’on sache trop dans quelle armée il prétendait avoir servi. Son association avec Walker lui apporta la fortune et la gloire. Il cultiva soigneusement ses contacts dans les gouvernements par la suite et ne manqua jamais une occasion d’offrir à un être puissant un joli cadeau plaqué or (il dédia 2500 coffrets de son vivant). Colt arma les deux côtés durant la guerre de Crimée (Britanniques, Russes, Turcs). Il arma souvent les deux côtés au cours des innombrables guerres d’indépendance, d’unification, de succession, qui secouèrent l’Europe au cours de la deuxième moitié du 19e siècle (Italie, France, Prusse, Autriche, etc.). Il arma même les deux côtés durant les guerres d’extermination aborigènes. Tous les autres suivirent dans la même voie. Smith & Wesson équipa également Russes et Turcs (modèle Russian) durant la guerre de Crimée. Et Winchester arma les deux côtés durant la guerre des Boers. Remington ne fut pas en reste.
Un enfant attardé comprendra facilement l’intérêt des barons industriels de la nouvelle Armistocratie à ce que se multiplient les conflits. Étrangement, c’est exactement ce qui va se produire.
Ces hommes du futur avaient pigé que ce qui compte n’est jamais la réalité, mais ce qui en sera retenu par les blaireaux, et surtout, qu’au poker, pas besoin d’une bonne main, suffit d’avoir tous les joueurs dans sa manche sauf le poulet qu’on veut plumer. Jugez-en par cette anecdote :
Les ingénieurs brillants et innovateurs de Smith & Wesson furent abasourdis en 1870 de voir leur prototype futuriste refusé par l’armée américaine. Ils proposaient un pistolet à répétition révolutionnaire, à cartouche métallique, à chargement par canon basculant articulé, à éjection automatique des douilles, montrant facilité d’emploi, durabilité, précision et puissance. Une pure merveille de machine à tuer. En fait, le type même de l’œuvre-revolver achevée, le vrai bon gun, tel qu’il existe encore aujourd’hui, près de 140 ans plus tard. L’armée US, pourtant, opta pour un absurde Remington à un coup, totalement désuet, et en commanda… 8 000 !… Comment ça s'épelle, bakshish ?
Tout compte fait, la véritable innovation de l’époque fût sans doute l’union de la corporation, de l’état et de l’armée. Les descendants des barons de l’Armériche allaient pousser l’idée à sa puissance maximale au cours du siècle suivant. Leurs vrais chefs-d’œuvre se préparaient déjà. Ils allaient donner sa véritable impulsion et surtout, son esthétique, à celui que j'appelle le mauvais siècle
William Avery Rockefeller Senior
Charlatan, vendeur itinérant de médicaments miracles (pétrole dilué, huile de serpent, etc.), plutôt polygame, un peu gambler, il abandonna sa famille à son sort. Deux de ses fils se hissèrent parmi les hommes les plus puissants de l’Histoire.
 John Davidson Rockefeller
John Davidson Rockefeller
La façon de faire de l’argent est d’acheter quand le sang inonde les rues.
Combien d’argent est suffisant, monsieur Rockefeller ?— Juste encore un petit peu.
De tous les grands héros que la terre ait porté, nul doute que John D. Rockefeller, premier milliardaire de l’Histoire, fut celui animé des meilleures intentions. Il pourchassait candidement l'objectif d’amasser le plus d’argent possible et l’on peut sans ambages déclarer : « mission accomplie, Johnny Boy ! ». Comme tous les grands capitalistes de son époque, il croyait fermement à la démocratie, aux lois du marché et au capitalisme, mais en tant que fables utiles !… Tartines populaires ! Bonnes pour les journaux ! Idéales pour abrutir les ouvriers ! Bercer leurs enfants ! Meubler les dimanches !… La meilleure preuve de l’autorité de ces mythes et galéjades est l’écrasante proportion de nos contemporains qui y croient encore de nos jours, tant à gauche qu’à droite, d’ailleurs !… Notre bon John D. fut sans doute celui qui dépensa le plus d’énergie et d’oseille à renforcer la merveilleuse légende des bienfaits de l’Industrialisation.
Après avoir érigé son empire sans la moindre corruption, répression, piraterie, tricherie ou malhonnêteté (toujours selon le folklore hollywoodien), il consacra ses jours à la quête de sa quasi christique philanthropie, beurrant avec dévotion la planète des miasmes pléthoriques que sa dégorgeante générosité. Non seulement se baladait-il les poches bourrées de pièces de 10¢ qu’il jetait en aumône aux badauds sur sa route, mais il finança également d’innombrables entreprises de bienfaisance, Églises, hôpitaux, écoles, etc. Son altruisme et sa bonté ayant fait l’objet de trillions d’hagiographies dithyrambiques, je vous parlerai plutôt ici de quelques-unes de ses passions plus discrètes, mais qui eurent sur le siècle naissant une influence remarquable.
Ayant réussi à accumuler un petit butin en spéculant sur des stocks de grain, John D. défraya les 300$ qu’il en coûtait à l’époque pour être exonéré de la conscription, et éviter la guerre civile de 1863. En lieu et place, il fit fortune en approvisionnant les troupes fédérales en whisky à des prix usuriers. Comme le camphène de presque toutes lampes états-uniennes venait des états du Sud, une pénurie menaçait. John eut l’idée géniale d’investir ses profits dans les raffineries de kérosène. Il fit des affaires d’or. En 1865, Rockefeller racheta tous ses partenaires et fonda Standard Oil. C’est là qu’il inventa l’intégration verticale. L’idée est simple, il faut posséder tous les maillons de la chaîne, la source, la transformation, les transports, les autorités. À son pinacle, en 1880, Standard contrôlait 95% du pétrole des Etats-Unis. 70% du marché de Standard se trouvait en Europe et en Russie. Vous vous ennuyez ? Ces chiffres vous endorment !? Rappelez-vous les principes de l’intégration verticale. Là où allait le pétrole de Standard, les chemins de fer, les flottes de navires et les gouvernements devaient également tomber sous le contrôle de Standard.
Bakou. Bakou est une petite ville dont on ne parle ni dans nos livres d’histoire, ni aux bulletins de nouvelles. Malgré tout, au tournant du siècle, la moitié du pétrole de la planète était sorti de Bakou. Bakou sur la mer Caspienne. Tout près de l’Afghanistan. On y reviendra, évidemment. En 1880, un boom pétrolier se produit dans la région, sous l'impulsion des frère Nobel de Suède et des Rothschild de Paris. Standard a déjà investi massivement dans la Russie Tzariste. Rockefeller tentera par tous les moyens de stopper la production ou de s'en emparer. Nicolas II, rébarbatif et loyal envers les Nobel, fidèles serviteurs de pères en fils, refusera de céder. Les champs des Nobel et des Rothschild sont la cible d'attentats. La Turquie et la Russie entrent en guerre. Le Japon attaque la Russie. Au tournant du siècle, on fera payer les Tsars pour leur arrogance.
Bakou devient rapidement un des principaux objectifs stratégiques du 20e siècle. La Turquie tente de s’en emparer en 1914, trouvant sur son chemin l’armée Russe et l’Arménie. Dommage pour les Arméniens. Le Kaiser y rêve en 14-18. Hitler rate mystérieusement l'occasion de s'en emparer, alors qu'on la lui offre sur un plateau. Bakou ?! Les pétrolières américaines ont mis la main dessus dans l'effondrement soviétique. Bakou ?! Pour transporter ses ressources vers l'Asie, on doit traverser l'Afghanistan. Oui, l'Afghanistan.
De très intenses contacts reliaient l’élite de Wall Street à la Russie dès la fin du 19e siècle. En fait, Rockefeller et ses collègues n’allaient prendre aucun risque et s’assurer de financer et d’armer les deux côtés de la révolution Bolchévique. Quand la révolution Russe se stabilisera autour de Staline au début des années 20, celui-ci fera cadeau de Bakou à un collègue et partenaire d’affaire de Rockefeller, un certain Averell Harriman, dont une des banques, la Brown Brothers Harriman était présidée par Percy Rockefeller.
En 1902, on évalua que Rockefeller possédait à lui seul les deux tiers de la production mondiale de pétrole, 1/500 de toute la richesse états-unienne et 1/2000 de la richesse mondiale. La cyclopéenne Standard Oil, enfreignant notamment la loi anti-trust, fut démantelée en 1911 à la suite d’une série de poursuites fédérales. On la divisa en 34 parcelles dont les plus connues sont Conoco, Chevron, Esso, et Mobil. Rockefeller et sa famille conservent le contrôle effectif de chacune des parties de l'Empire, qui n'a simplement plus le droit de s'avouer amalgamé. Quant à la scène internationale, les lois anti-trust ne s'y appliquent pas. Standard va donc continuer comme si rien n'était arrivé, à la différence qu'aux États-Unis, elle devra maintenir une spectaculaire charade de compétition.
Célébrons maintenant, tel que promis, la partie plus discrète (disons plus spécifique) de l’amour de son prochain dont fit preuve monsieur Rockefeller. Il acheta par exemple une église à son pasteur Baptiste, un personnage du nom de Thomas Dixon qui se rendit célèbre en publiant une vingtaine de livres, odes au Ku Klux Klan, dont le plus connu restera The Clansman. Rockefeller finança en 1902 la création du Conseil Général de l’Éducation (General Education Board), qui pendant plus de quarante ans eut une très forte et controversée influence raciste sur les institutions scolaires américaines. Toujours en 1902, John D. Rockefeller et E.H. Harriman font don de 11 M$ au Cold Spring Harbor Laboratory. Cet institut, construit sur un terrain appartenant aux frères Dulles (John Foster et Allan), est le tout premier laboratoire d’études eugénistes. C’est de là qu’apparaîtront les toutes premières lois de l’hygiène raciale. Enthousiaste, Rockefeller créé ensuite en 1909 un laboratoire d’Eugénisme sur un lopin  voisin appartenant à son ami Harriman. Puis, en 1910, il finance et organise l’Association pour la Recherche Eugénique. Et encore, la même année, l’Office des Données Eugéniques. C’est une passion !… En 1911, son ami et avocat John Foster Dulles résume ainsi la science eugéniste : « en éliminant les membres plus faibles de la population, une race plus pure pourra être créée »
voisin appartenant à son ami Harriman. Puis, en 1910, il finance et organise l’Association pour la Recherche Eugénique. Et encore, la même année, l’Office des Données Eugéniques. C’est une passion !… En 1911, son ami et avocat John Foster Dulles résume ainsi la science eugéniste : « en éliminant les membres plus faibles de la population, une race plus pure pourra être créée »
C’est de ces instituts eugénistes américains que migreront les thèses de la pureté de la race qui donnèrent sa couleur si particulière au milieu du Mauvais siècle. En 1928, Rockefeller fonde en Allemagne l’Institut Kaiser Wilhelm d’Eugénisme, d’Anthropologie et d’étude de l’Hérédité Humaine. Parmi les sommités qui dirigeront les recherches de ce laboratoire, on retrouve les noms de Josef Mengele et Otmar Verschuer.
Percy Avery Rockefeller
Tout au long de l’admirable carrière de son frangin, Percy Rockefeller poursuivra une course parallèle. Il dirigera et possédera en partie les Anaconda Copper, Bethlehem Steel, Biltmore Hotels, Cuba Company, Chile Copper, Westen Union, Brown Brothers Harriman, Edison, et surtout, Remington Arms. Il vendra des armes aux deux côtés pendant la première guerre mondiale et fera partie des plus ardents faucons en faveur d'une intervention américaine, qui aura finalement lieu en 1917, équipée en grande partie par Remington, évidemment. Ensuite, en pleine dépression économique, c’est le petit Percy qui offrira 400 000 mitraillettes légères Remington aux Sturmabteilungs (SA), le bras armé du parti Nazi d’Adolf Hitler.
Chapitre 5 – Morgan
 John Pierpont Morgan
John Pierpont Morgan
Un homme a toujours deux raisons de faire ce qu'il fait. La bonne et la vraie.
Je n'ai nul besoin d'un avocat qui me dise ce que je n'ai pas le droit de faire. Je les paie pour me dire comment faire ce que je veux faire.
Un jour, dans un bar, J.P. Morgan hurle au serveur en commandant sa bière : « Quand Morgan boit, tout le monde boit ! » Tous les clients prennent une bière. Morgan vide son verre et plaque une pièce de 10¢ sur la table, vociférant : « Quand Morgan paie, tout le monde paie !
Son papa, Junius Spencer Morgan, dirigeait la firme J.S. Morgan & Co à Londres. Il offrit à fiston la branche New-Yorkaise de sa compagnie, qui prit éventuellement le nom J.P. Morgan & Co. (aujourd’hui JPMorgan Chase). Au moment de la guerre de sécession, il parvint à éviter la conscription en payant une décharge de 300 $. Il eut l’idée de faire l’acquisition de 5000 fusils défectueux qu’il paya 17 500 $ et de revendre le lot tel quel à l’armée Fédérale pour 110 000 $. Comme les soldats voyaient leurs mains exploser à l’usage, Morgan fut poursuivi, mais un juge confirma la validité du contrat. Il utilisa son profit à bon escient et acquit le contrôle de nombreuses firmes, dont Drexel, Peabody, et Carnegie.
En 1891, Morgan fusionna Edison et Thomson pour former la General Electric. En 1895, il s’empara de la flotte Leyland, ainsi que de nombreuses lignes navales, créant la White Star, constructeurs et opérateurs des vaisseaux Britannic, Olympic et… Titanic. En 1899, J.P. Morgan possédait et/ou contrôlait quatre des cinq principales compagnies de chemin de fer d’Amérique, regroupant, entre autres, les intérêts des Rockefeller, Vanderbilt et… Harriman.
Un épisode m’a toujours fait rigoler. En 1900, Morgan finance les recherches de Nikola Tesla, le véritable inventeur de la radio (mais non, pas Marconi !), un génie scientifique aujourd’hui méconnu à qui l’on doit notamment le courant alternatif, la distribution polyphase et le moteur AC, ainsi que de fortes contributions à la cybernétique, au contrôle à distance, au radar, à l’informatique, à la balistique, à l’aéronautique (il invente le décollage vertical dans les années 20 !), à la navigation (le propulseur sans hélices) et à la physique nucléaire. Lorsque Tesla, débordant d’enthousiasme, montre à Morgan qu’il a réussi à créer un système qui permettrait la distribution gratuite d’électricité, sans fils ni câbles, sur toute la planète, le gros J.P. se gratte. Il ne voit absolument pas le profit à tirer d’une telle connerie. Il coupe les vivres au projet.
En 1904, J.P. Morgan fondit neuf aciéries en une seule et monstrueuse United States Steel Corporation, la première entreprise du monde à posséder des actifs d’un milliard. En 1912, le comité Pujo, chargé d’enquêter sur les activités douteuses des banques américaines évalua que les trois groupes que J.P. contrôlait, J.P. Morgan & Co., First National, et National City Bank, possédaient une somme de 22 trillions de dollars, l’équivalent de toutes les possessions et ressources publiques, personnelles et privées des 22 états à l’Ouest du Mississippi.
En 1913 J.P. Morgan réussit un de ses plus grands coups. Après avoir placé son homme à la tête du pays, un certain Woodrow Wilson, Il fait créer par un de ses associés, le sénateur Nelson Aldrich, une entité carrément diabolique, la Federal Reserve Bank. Essentiellement, il s'agit d'une entreprise privée, propriété de quelques grands trusts bancaires (dont le sien), et détenant le pouvoir d'imprimer, distribuer, contrôler, restreindre ou accroître la circulation des devises des États-Unis. Autrement dit, ce petit groupe pourrait (s'ils étaient retors et malhonnêtes) savoir d'avance quand se produiront certaines récessions, inflations, ou crises boursières. Au-delà de cela, il leur revient d'émettre la monnaie, qu'ils louent ensuite au gouvernement américain contre intérêt et profit.
John Pierpont mourut cette année-là, au cours d’un voyage en Italie, et ne vit jamais se réaliser le second de ses deux chefs d'oeuvres, la Glorieuse 14-18. Son fils Junior hérita de la majeure partie de sa fortune.
Détail amusant, les photos connues de J.P. Morgan sont toutes retouchées. Il détestait son nez, sévèrement déformé par la rosace, et ne permettait à personne de le photographier. Le portrait ci-haut est le seul que j’ai trouvé montrant son visage dans toute sa splendeur.
 John Pierpont Morgan, Jr.
John Pierpont Morgan, Jr.
J.P. Morgan Jr. aimait se vanter d’être le digne descendant du pirate Henry Morgan. Il baptisa son yacht personnel le Corsaire et y faisait flotter le Jolly Roger (crâne sur tibias croisés) au-dessus du Stars & Stripes. Il nomma un de ses fils Junius Spencer (du nom de son grand-papa) et l’autre Henry.
En août 1914, Morgan Junior signa un contrat avec la Bank of England, lui assurant le monopole de l’émission des obligations de guerre de l’Angleterre et de la France. Tel un devin, il avait fait en sorte que ses firmes investissent massivement dans la fabrication d’armes, dont il détenait maintenant l’exclusivité de l’approvisionnement aux alliés de l’Entente Cordiale (France et Angleterre). Ses banques prêtèrent 12 millions à la Russie et 50 millions à la France pour leur permettre d’acheter des armes… à ses propres armureries ! La totalité des munitions états-uniennes et britanniques achetées durant la première guerre mondiale furent manufacturées par les compagnies de J.P. Morgan. En cours de conflit, Morgan organisa un groupe de 2200 banques et prêta 500 millions supplémentaires aux gouvernements alliés qui s'empressèrent de lui retourner le chèque pour étancher leur soif d'acier, d'explosifs, de plomb, de machines.
En 1920, le président du conseil de W.A. Harriman & Co., un certain George Herbert Walker, arrangea une fusion monstre entre son entreprise et Morton & Co., devanture de Guaranty Trust Co., elle même un vestibule de la J.P. Morgan. Harriman représentait déjà une des plus grandes flottes de navires du monde depuis que le gouvernement des États-Unis lui avait fait cadeau de la gigantesque ligne Hamburg-Amerika, confisquée à l’Allemagne parmi les innombrables compensations aux vainqueurs à la fin du cataclysme.
Le 16 septembre 1920 à midi, une bombe explosa devant la banque J.P. Morgan & Co., située au 23, Wall Street. On retrouva une note dans une boîte aux lettres située à proximité disant « Souvenez-vous que nous n’en tolérerons pas plus. Libérez les prisonniers politiques ou ça sera la mort assurée pour vous tous. Signé : American Anarchists Fighters. » Les responsables ne furent jamais découverts. La facade de la banque porte encore les marques de ce bizarre d'attentat, que les responsables n'ont jamais voulu effacer.
Régulièrement embêté par des citoyens ulcérés, le Sénat mena encore une fois une enquête sur les pratiques bancaires, en 1929, pour se rendre compte qu’une longue liste de personnages officiels du gouvernement avaient reçu, à très bas prix, des actions dans les entreprises de J.P. Morgan. Cette liste incluait de gros noms tels que Calvin Coolidge (président des ÉU), William Woodin (secrétaire du trésor sous Roosevelt), McAdoo (secrétaire du trésor sous Wilson), Adams (secrétaire de la Marine), Bernard Baruch (président du conseil des industries militaires de Wilson et Roosevelt), etc. Il y eut très peu de suites.
En cette même année 1929, J.P. Morgan Junior a une inspiration géniale et se retire du marché boursier. D'autres le suivent, tels les Rockefeller, Harriman, et Vanderbilt. Juste à temps. De façon totalement imprévisible, la Banque de la Réserve Fédérale fondée par papa Morgan entreprend de restreindre les devises, ce qui cause un crash boursier sans précédent. C'est une aubaine pour les barons, qui ont l'occasion de racheter pour des cacahuètes la quasi-totalité de l'industrie indépendante américaine qui leur échappait encore, ainsi que les deux tiers des terres agricoles à l'Ouest du Mississippi*. Les pauvres blaireaux qui n'avaient pas été prévenus s'effondrent, se jettent par les fenêtres, c'est la Grande Dépression. La classe moyenne est pratiquement liquidée. La classe ouvrière, jetée à la rue. Les rois rigolent et se construisent des palais fantastiques. Ils ont enfin les budgets pour entreprendre une oeuvre grandiose.
C'est le début des années trente et le soleil brille comme jamais sur Wall Street.
* C'est sur ces terres-là que se construira le plus grand piège à fric de toute l'Hisoire humaine, une sorte de pays/parking qu'on appelle parfois Suburbia. C'est un Vanderbilt qui l'inventa, il aura son propre paragraphe dans l'histoire du mauvais siècle.
Chapitre 6 - Warburg

Nous aurons un gouvernement mondial, qu’on le veuille ou non. Reste à savoir si le gouvernement mondial sera établi par consentement ou par conquête. 17 février 1950, au Conseil des Relations Internationales des États-Unis
Origines
Quittant l’Italie au 16e siècle, cette famille prend le nom de sa ville d’adoption, Warburg. Ils déménagent encore un siècle plus tard, cette fois à Altona, près de Hambourg où ils demeureront jusqu’en 1945.
C’est en 1798 que les frères Gerson et Moïse-Marcus Warburg fondent une banque, la M. M. Warburg & Co. qui deviendra une des grandes banques d’Europe et existe encore aujourd’hui. Ce sont les Warburg qui feront le pont entre les intérêts banquiers européens des Rothschild et les capitaux états-uniens des Rockefeller, Morgan, Ford, Harriman et Vanderbilt.
 Jacob Henry Schiff
Jacob Henry Schiff
Il nait à Francfort, d’une famille confinée au minuscule ghetto où le décret datant de Frédérick III force encore les juifs à s’entasser. Il faut savoir que la plupart des villes d’Europe traitent les juifs comme des animaux et les cantonnent à des sections définies des agglomérations, souvent murées. Il est bon également de rappeler qu’à l’époque, la majorité des confessions chrétiennes limitent les transactions financières et découragent le commerce. C’est pour cette raison sans doute que dans l’Europe post-médiévale assoiffée de capitaux, l’on tolére les juifs. Pour leur utilité économique ! Cela a pour effet, paradoxalement, d’enrichir quelques-unes de leurs familles tout en attisant les haines, peurs et jalousies des bourgeois chrétiens, ressentiments qui vont mijoter durant des siècles, jusqu’à nos jours, propagés par l’ignorance, la désinformation et la simple connerie humaine, ultime énergie renouvelable. C’est dans ce contexte que la famille Schiff se retrouve à partager une étroite maison avec les Bauer, dont l’emblème familial est un écu rouge, en allemand : Rothschild.
Jacob Schiff déménage aux É.U. en 1865 et, irrigué des capitaux de ses maîtres les Rothschild, devient rapidement le dirigeant de Kuhn Loeb & Co., qui grossit jusqu’à représenter une des plus importantes banques de l’hémisphère. Il rachète l’immense chemin de fer Union Pacific, le plus imposant réseau ferroviaire d’Amérique. À la suite d’une manœuvre classique, il réussit à faire élire quelques représentants au Congrès qui, en retour de parts dans l’entreprise, subventionnent lourdement les achats de terrains de la compagnie. Cette affaire éclate au grand jour et est connue comme le Scandale du Crédit Mobilier de 1872. Comme c’est souvent le cas, les responsables s’en tirent sans anicroches et quelques boucs émissaires se contentent de faire semblant de jouer à la chaise musicale. Résultat : un profit net de 21 millions (63 milliards en dollars d’aujourd’hui). Schiff et les Warburg organisent en 1898 la cession de la Union Pacific Railroad à un certain spéculateur du nom de E.H. Harriman.
Les attaques contre les communautés juives remontent aux croisades. Il y eut le massacre du Château de York, en 1190. Puis lors de la Peste Noire de 1348, une hystérie mystique se déchaîna sur l’Allemagne et des exterminations eurent lieu dans une dizaine de villes, jusqu’à 100 000 morts en quelques mois. Cependant, on appelle «pogroms» les attaques ciblées, répétées, et ambitieuses, perpétrées contre les juifs au 19e siècle. Le terme passe dans le vocabulaire occidental vers 1881, alors qu’une vague de massacres engloutit le Sud-ouest de la Russie Impériale, après l’assassinat du Tzar Alexandre II, dont un des meurtriers était, accessoirement, d'origine juive. Maisons brûlées, tortures, viols, enfants battus, meurtres, des milliers de victimes. Histoire de calmer les esprits, le nouveau Tzar, Alexandre III fait porter la responsabilité des ces horreurs sur… Les Juifs eux-mêmes !… Étrangement, les pogroms se poursuivent pendant trois longues années. Le mouvement Sioniste naît dans ces circonstances-là. Beaucoup de Juifs entreprennent d’émigrer aux États-Unis, alors que l’idée fait son chemin d’un retour à la Terre Ancestrale, dans le contexte où aucun pays (le Canada non plus, en passant) ne semble prêt à les considérer comme des citoyens à part entière.
Les choses ne s’améliorent pas sous Nicolas II, elles s’enveniment !… En 1903, plusieurs milliers de Juifs sont tués et des dizaines de milliers d’autres blessés dans une nouvelle flambée de pogroms qui dure jusqu’en 1906. L’armée impériale, non contente de laisser les émeutes se produire, participe activement à certains massacres, comme également la police tsariste, la sinistre Ochrana. Il n’est donc pas inexplicable que certains Juifs puissants aient eu une petite dent contre le Tzar et sa Russie Impériale. La famille Romanov va finir par passer à la caisse.
Jacob Henry Schiff consent donc un prêt de 200 millions de dollars au Japon en 1904 pour soutenir les ambitions nippones en Chine. Les territoires visés par le Japon sont occupés par… la Russie. C’est l’époque où toutes les puissances mondiales se tapent la Chine, dévastée et impuissante. Les navires ultramodernes de la flotte japonaise viennent d’être livrés par la Vickers, directement d’Angleterre. C’est un désastre humiliant pour Nicolas II, qui doit retirer ses troupes, abandonner ses places fortes et pleurer sa flotte, coulée par le fond jusqu’au dernier navire, réduite à néant.
Dans les années 10, Schiff va armer les puissances centrales, ennemies de la Russie, Allemagne, Autriche, Hongrie, mais aussi l’Empire Ottoman, en prévision de la première guerre. Lorsque le conflit éclate en 1914, il prête aussi de l’argent à la France pour qu’elle s’arme contre ces mêmes puissances centrales, tout en recommandant à tout le monde de faire la paix le plus tôt possible. Il usera finalement de son influence sur Woodrow Wilson pour pousser les États-Unis à intervenir à leur tour.
Jacob Henry Schiff préparait depuis une dizaine d’années, en collaboration avec le Kaiser allemand, le financement de la révolution Russe. En 1917, la rébellion embrase toute la Russie et paralyse le front de l’Est, ce qui a pour effet de rallonger la guerre de deux ans. Les états d’Europe sont ruinés ? qu’à cela ne tienne, on va leur prêter encore quelques centaines de millions. Schiff investit massivement dans le gouvernement Bolchevique de Lénine, favorisant sa victoire sur les autres factions révolutionnaires. La dette Bolchevique, contractée à Wall Street, sera honorée dans les années 20 et je vous expliquerai comment. La fille de Jacob Schiff devient l’épouse de son partenaire chez Kuhn et cie, Félix Warburg.
Au début du Mauvais Siècle, les quatre frères Warburg se séparent. Aby Moritz Warburg quitte la planète bancaire et part à Florence où il devient collectionneur et se passionne pour l’histoire de l’Art. Les frères Paul et Félix vont s’installer à Wall Street New York, où il s’achètent une participation dans l’affaire Kuhn, Loeb & Co de Jacob Schiff. Max reste derrière et dirige la banque paternelle, M. M. Warburg & Co., à Hambourg. Il est un des conseillers importants du Kaiser Wilhelm II, et à l’orée de la première guerre mondiale, finance et organise son armement.
En 1913, Paul Moritz Warburg dirige le petit groupe sélect qui réussit un des plus gros hold-ups de toute l’histoire de l’humanité : la création de Federal Reserve Bank. Il y avait déjà près de 75 ans que les banquiers de toutes les moutures tentaient le coup. Les présidents Lincoln, McKinley et Garfield ont été assassinés pour s'y être opposés. Je vais tenter de vous expliquer la chose.
Petite histoire du fric mou
À l’origine, les possédants déposaient leur or dans la voûte d’un orfèvre. Pour chaque dépôt, celui-ci remettait une quittance, équivalente au poids de l’or qui lui était confié, d’où le nom de Livre, Pound, Peso, Lira, etc. Rapidement, les gens se mirent à s’échanger ces quittances, plus pratiques à transporter que des kilos de métal encombrant, pour régler leurs achats ou leurs dettes. Éventuellement, les orfèvres se rendirent compte que plus personne ne venait chercher cet or, qui changeait de main de nombreuses fois mais dormait tout ce temps à la cave. Ils eurent l’idée d’acheter des propriétés à revenu avec cet or, puisqu’il ne servait à rien. Puis, ils réalisèrent qu’ils pouvaient prêter plusieurs fois l’équivalent du véritable magot en leur possession et en tirer un intérêt, sans jamais se faire prendre. La banque était née. Cependant, lorsqu’un orfèvre possède 10 livres d’or et met en circulation 100 livres de quittances, il dévalue la quittance de 90% dans le monde réel. C’est-à-dire que si tous les dépositaires viennent un après-midi reprendre leur or, leurs 100 livres de quittance ne leur permettront pas d’obtenir un kopek de plus que les 10 livres d’or reposant sur la tablette du coffre et il y aura ce qu’on appelle un Crash.
Là où ça devient franchement dingue, c’est quand on crée une banque centrale, ou fédérale. Cette institution est censée émettre des notes (les billets) représentant la valeur du trésor en possession du gouvernement. Pour simplifier, si le gouvernement a un actif de 100 livres d’or, de lampadaires, ou de bouteilles scotch, il peut théoriquement émettre 100 billets d’une livre, qui serviront aux citoyens dans leurs transactions quotidiennes. Mais la réalité est toute autre.
Les banques fédérales n’appartiennent jamais aux gouvernements (donc à la population), mais aux banques les plus influentes du pays. Voici comment ça fonctionne : le gouvernement sera actionnaire à 20 % de la banque, et déposera donc 20 livres d’or. Quatre banques seront également actionnaires, à part égale avec le gouvernement. Cependant, seul l’état déposera véritablement son or, puisque les banques se prêteront à elles mêmes le montant de leur mise de fond, en investissant les 20 livres que le pauvre blaireau de peuple vient de leur donner. Donc, dès le départ, le capital qui devait être de 100 livres n’est en réalité que de 20. Dévaluation. Il y a pire. Cette banque fédérale a maintenant le droit d’imprimer de la monnaie. Elle va décider du nombre de billets à imprimer. Eh bien, ces dénominations représenteront la somme totale de la DETTE que le gouvernement aura envers la banque centrale. Si, si ! Ils fabriquent une piastre en papier pour quelques sous, puis la louent au gouvernement pour la somme nominale inscrite sur sa face, soit 1, 2, 10, 1000 livres, etc. « Pourquoi, bon sang, paierions-nous ce montant absurde ? » C’est ainsi. Les peuples de la Terre le permettent. C’est simplement une subtile continuité de la monarchie héréditaire, avec un masque souriant.
Bon, combien de billets vont-ils émettre, ces experts de la finance ?! Le trésor prétend posséder 100 livres (alors qu’il n’y en a que 20), vous vous dites : « simple ! ils impriment 100 billets de 1 livre ». Eh bien… Euh… Non. C’est à eux que revient le choix de la quantité de devises en circulation. Ce qui veut dire qu’une fois les 100 premières notes distribuées, la banque fédérale peut à loisir en imprimer 900 nouvelles. Avec comme résultat que votre pinte de lait qui coûtait 2¢, vaut maintenant 20¢. Le lendemain, nos amis de la banque centrale peuvent décider de garder dans la voûte 95% de l’argent qui leur passe entre les mains. Au bout de quelques jours, il n’y a plus que 50 notes de 1 livre en circulation. La même pinte de lait s’achète désormais 1¢, parce que chaque note représente le double de la somme symbolique représentée au départ. Vous trouvez ça scandaleux ? Pensez-y, ces messieurs peuvent sans ambages profiter de leur contrôle de cette respiration de l’inflation et de la récession pour constamment acheter la pinte de lait à 1¢ et vous la revendre à 20 ! Tout le monde a travaillé très fort ? Plein d’heures supplémentaires ?! Vous êtes devenus riches ?! Il suffit à la banque d’imprimer encore 1000 billets et de les mettre en circulation, c’est-à-dire d’acheter eux-mêmes des valeurs sur le marché (le camion de lait, par exemple), alors qu’ils ne possèdent pas un traître sou d’actif, pour que les 10 billets qui dorment dans votre poche perdent la moitié de leur valeur. Dans les faits, la banque vient d’aller prendre 5 livres dans votre poche. C’est un hold-up subtil. Le hold-up international de tous les habitants de la Terre par un petit groupe de banquiers et d’industriels.
Vous ne me croyez pas, hum ?! je sens que j’ai besoin d’aide… En voici : L’inflation aux États-Unis depuis 1913, année de la création de la Federal Reserve Bank par Paul Warburg, JP Morgan, Rockefeller et leurs potes : 2950% !
La plupart des Américains ne comprennent pas vraiment l’opération des prêteurs d’argent internationaux. Les comptes du Système de la Réserve Fédérale n’ont jamais fait l’objet d’une vérification. La FED opère sans le moindre contrôle du Congrès et manipule le crédit des Etats-Unis.— Le Sénateur Barry Goldwater (Rep. AR)
C’est une bonne chose que les gens de la nation ne comprennent pas notre système bancaire et monétaire, parce que s’ils y arrivaient, je crois qu’il y aurait une révolution avant demain matin. — Henry Ford, industriel
Les banques fédérales ne sont pas des agences gouvernementales mais sont des corporations privées, indépendantes, contrôlées localement.— Lewis contre le gouvernement des États-Unis, 1239, procès du 9e circuit, 1982
Nous avons, dans ce pays, une des institutions les plus corrompues que le monde ait jamais connues. Je parle de la Federal Reserve Bank. Cette institution maléfique a appauvri le peuple des États-Unis et a pratiquement ruiné le gouvernement. Ce crime a été commis par les charognards de fric qui la contrôlent. Il n’y a pas un seul homme ici, à portée de voix qui ignore que ce pays est gouverné par des banquiers internationaux. —Louis T. McFadden, Congressman 1932 (Rep. Pa)
Lorsque vous et moi signons un chèque, les fonds suffisants doivent être présents dans votre compte pour couvrir le montant du chèque, mais lorsque la Réserve Fédérale signe un chèque, il n’y a pas de dépôt bancaire y correspondant. Lorsque la Réserve Fédérale signe un chèque, elle crée de l’argent.— Manuel d’utilisateur des services, Federal Reserve Bank de Boston
De toutes les inventions imaginées pour voler les classes ouvrières de l’humanité, aucune n’a été aussi efficace que celle qui les mystifie grâce à l’argent de papier.— Daniel Webster, secrétaire d’État, É.-U., 1841
14-18
Une des idées du Kaiser Wilhelm II, toujours conseillé par Max Warburg, est d’accéder au pétrole mésopotamien en construisant une ligne de chemin de fer reliant Berlin à Bassora (l’Irak d’aujourd’hui). La Couronne britannique, dont la flotte a abandonné le charbon en 1904 au profit du pétrole, ne peut laisser le monopole de sa Royal Dutch Shell s’effriter. En 1914, quelques mois avant que le projet ne soit complété, la guerre est déclarée sous un prétexte bidon, l’assassinat du Duc Franz Ferdinand. Les banquiers de toutes parts se frottent les mains. Pour eux, c’est noël !…
Alors que les Bolcheviques ne contrôlent qu’une fraction infime du territoire Russe (parcelle qu’ils passent près de perdre à l’été 1918), la American League to Aid and Cooperate with Russia est organisée à Washington D.C. pour augmenter le support offert au groupe de Lénine et Trotski, déjà soutenu par Jacob Schiff. Il s’agit d’un consortium regroupant General Electric, Baltimore & Ohio Railroad, et surtout, la Federal Reserve Bank, bref, un lobby des Warburg.
Lors du traité de Versailles en 1919, des réparations sévères sont exigées par les alliés à l’Allemagne et à ses alliés. Parmi celles-ci, mentionnons que Royal Dutch Shell, pétrolière appartenant à la Couronne britannique, reçoit les champs pétroliers de tout le Moyen Orient en cadeau. 75 % des liquidités nécessaires aux lourds paiements imposés à l’Allemagne sont prêtés au gouvernement Berlinois par des banques US dont la Federal Reserve Bank dirigée par Paul Warburg. C’est donc le peuple américain qui va payer avec ses impôts les réparations allemandes de la première guerre aux grandes entreprises qui ont organisé le conflit d’un bout à l’autre. Cette situation contribue à créer la lourde dette nationale qui assure aux banques leur ascendant sur la politique américaine. Voilà qui jette un éclairage prosaïque sur le « miracle » de la reprise allemande, et sur la légendaire efficacité du régime nazi, qu’on continue de nous vanter jusqu’à nos jours sous diverses formes.
1920 : malgré les cendres encore chaudes et l’horreur cuisante avec laquelle le Monde regarde l’hécatombe qui vient de s’achever, Wall Street commence déjà à faire la promotion d’une politique de la revanche en Europe Centrale et à préparer l’avènement d’une nouvelle guerre entre la France, l’Allemagne et la Russie.
Création à New York du Council on Foreign Relations (sorte de ministère américain des affaires étrangères, échappant à tout contrôle gouvernemental, appartenant à des banques et des trusts industriels). Sa direction est confiée à Paul Moritz Warburg. Il en reste un membre influent jusqu’à sa mort, en 1932. Il fonde également en 1921 la International Acceptance Bank of New York (banque de réception de capitaux étrangers), qui fusionne ensuite avec la Banque de Manhattan. Il est de surcroît fondateur, actionnaire important, et directeur de I.G. Farben USA, compagnie soeur de la I.G. Farben allemande, dirigée par son frérot Max Warburg. I.G. Farben et Vereinigte Stahlwerke ont produit à elles deux 95 % des explosifs utilisés par les forces de l’Axe au cours de la seconde guerre mondiale.
La Hamburg-Amerika line a pour banque (donc créancier) la M.M. Warburg de Hambourg. Dans le cadre des « réparations », c’est donc Warburg lui-même qui organise son transfert au trust de Averell Harriman et George Herbert Walker, dont le bras américain de sa banque, détenu par ses frères Félix et Paul Warburg, est partiellement propriétaire. Résumons le trajet du fric. Le blaireau américain paie son impôt, qui se ramasse à la Federal Reserve Bank de Paul Warburg et cie. Cet argent passe ensuite en prêt à l’Allemagne, en réalité à la Reichsbank de Max Warburg et cie. Le fric transite encore une fois vers la Union Bank de Harriman, dont Felix Warburg est un actionnaire important. Cet argent (ou ce qu’il en reste) est ensuite utilisé pour compléter la transaction cédant une immense flotte de navires, la Hamburg-Amerika, de la M.M. Warburg à la Union Bank, toujours propriété partielle des Warburg. Résultat, l’argent volé à un blaireau, l’Américain, a servi à déposséder un autre blaireau, l’Allemand, et les gouvernements des deux pays encourent de lourds intérêts, alors qu’une gigantesque flotte de navires a semblé changer de mains. Pour compléter la boucle, en 1933, le même Max Warburg devient le directeur du conseil d’administration de la Hamburg-Amerika line.
James Paul Warburg, fils de Paul Moritz, oeuvre aux postes de vice-président, puis président des banques de son papa, les International Acceptance Bank, et Manhattan, de 1921 à 1934, tout en devenant conseiller auprès de divers présidents des États-Unis dont Franklin Delano Roosevelt.
En 1922, Max Warburg offre son concours à l’établissement à Berlin d’un réseau d’investissement aussi puissant que discret. Les dirigeants en sont Averell Harriman, fils de E.H. Harriman, et George Herbert Walker.
Dans les années 20, les banquiers de Wall Street cherchent en Europe Centrale sur qui miser pour s’assurer d’une guerre le plus tôt possible. Paul Moritz Warburg se rend en Allemagne en 1929 et en 1930, pour y représenter la International Acceptance Bank, intéressée à financer et organiser le parti National Socialiste de Adolf Hitler. Il représente également le Guaranty Trust de J.P. Mogan dans le même contexte.
En 1929, les banquiers en contrôle de la Federal Reserve Bank organisent un coup d’état économique en créant de toutes pièces un effondrement de la bourse. Les principales entreprises impliquées se sont discrètement retirées du marché boursier au cours des mois précédents. Ils en profiteront ensuite pour reprendre les affaires les plus profitables, liquider les autres, et mettre la main sur d’immenses terres (plus des deux tiers des fermes indépendantes à l'Ouest du Mississippi), que les fermiers états-uniens sont forcés de laisser aller, faute de liquidités. C’est sur ces terrains que sera construite la grande utopie américaine de la planète Suburbia, au cours des 30 années suivantes.
Le crash de 1929 n’a rien eu d’accidentel. C’est un événement soigneusement planifié. Les Banquiers internationaux ont cherché à engendrer ici une condition désespérée, de façon à devenir nos maîtres à tous. — Louis T. McFadden, Chairman of the House Banking and Currency Committee, 1933.
Prise de Pouvoir
Imbibé de fonds et d’appuis provenant de toutes parts (Wall Street, la City de Londres, les Thyssen, les Schacht, les Krupp), Adolf Hitler et ses S.A., armés de 400 000 mitraillettes par Rockefeller et J.P. Morgan, s’emparent du pouvoir après un coup d’état déguisé, en janvier 1933.
À compter de 1933, Max Warburg participe à la direction financière de l’état Nazi en siégeant au CA de la Reichsbank, sous Hjalmar Schacht de qui il est très proche. Il est parallèlement un des grands actionnaires et dirigeants de la partie allemande de l’immense conglomérat chimique nazi I.G. Farben (américano-germanique), tristement célèbre pour la création et la vente du Zyklon B (le poison employé dans les camps d’extermination), mais également fournisseur de l’armée allemande en gaz toxiques, ersatz pétroliers et produits divers, dont évidemment, des explosifs. I.G. Farben a un parti pris très clair dans la guerre qui se prépare, puisque la branche américaine de la firme bloque l’accès de l’armée U.S. à ses brevets comportant des applications militaires, en réservant l’exclusivité au côté Nazi.
Le 29 mars 1933, Erich, le fils de Max, envoie un télégramme à son cousin, Frederick Warburg, alors directeur d’une branche du réseau ferroviaire des Harriman. Il y demande à Frederick d’user de toute son influence pour stopper les activités anti-nazies en Amérique. En fait, les Warburg ont le contrôle politique et financier du American-Jewish Committee et du B’nai B’rith, qui publient en 1933 une déclaration commune déconseillant toute action de protestation ou de boycott envers l’Allemagne Nazie et allant jusqu’à proposer d’empêcher la tenue de réunions, de manifestations et de toutes formes d’agitation à l’encontre du régime de Adolf Hitler.
La même année, Max Warburg négocie un important pacte pour la création d’un trust chargé de l’exportation de tous les produits Allemands vers les États-Unis. Ce trust regroupant 150 entreprises est mené par la Harriman International & Co., dirigée par Oliver Harriman, cousin de Averell. Les tractations réunissent Hjalmar Schacht, le ministre nazi de l’économie, Max Warburg, Kurt Von Schroeder et l’avocat attitré des principales banques nazies tout au long des années 30, un américain nommé John Foster Dulles.
Opposé au New Deal de FDR, James Paul Warburg quitte le gouvernement des États-Unis en 1934. Il réintègrera le gouvernement en 1942 en tant qu’assistant spécial au Coordonateur de l’Information, William Joseph Donovan. Il aura alors l’occasion de travailler en compagnie d’un certain Edward Bernays, de qui on reparlera.
En 1938, il devient étrange pour les racistes Nazis d’exhiber un banquier juif à la tête de leur complexe économique, militaire et industriel. Max Warburg est « chassé » d’Allemagne, cesse de siéger sur les conseils d’administration des entreprises nazies, abandonne ses fonctions dans l’appareil d’état du Troisième Reich et part s’installer à New York. Cette année-là, Erich Warburg, le fils de Max, fonde Warburg Pincus à New York.
Le réseau construit par les Warburg, les Harriman et leurs acolytes continue d’opérer, jusqu’en 1942 dans certains cas, et jusqu’en 1945 dans d’autres. Le profits engrangés sont astronomiques. Contrairement à Schiff, résolument ému par le sort de ses congénères et toujours prêt à se porter à leur secours, les Warburg semblent dotés d’une indifférence ahurissante aux souffrances des êtres humains en général, mais des juifs en particulier. Ont-ils été dupés ? Peut-être étaient-ils anti-sémites eux-mêmes ?! Ou alors plutôt détachés de leur admirable culture ancestrale et simplement avides de capitaux, de contrôle, de puissance. Abasourdissant mystère.
Erich Warburg s’engage dans l’armée américaine pendant la guerre, avec le grade de lieutenant-colonel. Malgré sa place modeste dans la hiérarchie militaire et les graves risques d’apparence de conflit d’intérêt, on le laisse déployer son influence pour garder Hambourg, la ville familiale, dans la zone Britannique lors de la partition de l’Allemagne. C’est lui qui sera chargé de l’interrogatoire de Herman Göring en 1945. Cette année-là, le dirigeant par intérim de la banque des Warburg depuis le départ de Max en 1938, Rudolf Brinckmann, redonne le contrôle de la M.M. Warburg à Erich.
Max Warburg s’éteint à New York en 1946. La même année, en Angleterre, le petit-fils de Moïse Warburg, Siegmund George Warburg, fonde la S.G. Warburg & Co.
Erich M. Warburg consacre le reste de sa vie au rapprochement entre l’Allemagne et les États-Unis après la seconde guerre mondiale. Pour ses efforts en ce sens, on lui octroie en 1988 une récompense prestigieuse, le prix Erich M. Warburg !… La liste des autres récipiendaires inclut quelques grands hommes, dont le Dr. Henry Kissinger (architecte du génocide cambodgien), le général Klaus Naumann (en charge des bombardements de l’OTAN dans les Balkans) et Monsieur George Herbert Walker Bush.
 Pourquoi devrais-je me soucier de la loi ? N'ais-je pas la puissance ?
Pourquoi devrais-je me soucier de la loi ? N'ais-je pas la puissance ?
Si j'avais pris le temps de m'éduquer, je n'aurais pas eu le temps d'apprendre quoi que ce soit d'autre.
J'ai été fou toute ma vie, obsédé par l'idée de faire de l'argent.
Pazzi
Pazzi (en anglais patsy) est un mot italien qui signifie à la fois marionnette et imbécile. Dans le monde de l'espionnage, donc du fric, et conséquemment dans le vaste et merveilleux monde du Mauvais Siècle en particulier, il s'agit d'un personnage destiné à accomplir publiquement la volonté de maîtres désireux de rester dans l’ombre. Ce qui différencie le pazzi du simple valet, c'est que le pazzi croit (et c’est la que son imbécillité est utile) qu'il est un moteur important de sa propre action. Marinus Vanderlubbe, le simple d’esprit «communiste», condamné et exécuté par les Nazis pour avoir incendié le Reichstag, est un exemple frappant. Certaines familles deviennent des pazzis de père en fils, les sommes en apparence colossales de fric qu’on les laisse accumuler en cours de route ne changeant ultimement rien à leur rôle de marionnettes. Les Bush sont des pazzis. Les Farrish sont des pazzis. Chamberlain, Wilson, Pétain, pazzis !.
L'histoire des Vanderbilt peut nous permettre de distinguer le rêve américain de la réalité. À prime abord, on croirait que le destin de cette famille valide ce poussiéreux fantasme américain de l'ascension sociale ouverte à tous ceux qui en ont la force et le talent, quelle que soit leur naissance. Cornelius Vanderbilt part de rien et devient, à force de détermination et d'ingéniosité, un des hommes les plus riches de la planète, blablabla, sortez les flugelhorns. Pourtant, l'histoire de cette famille montre bien comment les forces aristocratiques, tout en ayant l’air de ménager une place aux nouvelles classes, sauront en fait s'en servir, les utiliser, et leur confier les tâches les plus moches. Au moment de sa mort, 87% de la fortune colossale de J.P. Morgan appartenait en réalité aux Rothschild. En définitive, le recul nous permet de constater que les Vanderbilt, malgré toute leur volonté et leur dévouement à la cause de la puissance et du fric, aussi riches qu'ils ont pu l’être, ne sont jamais venus près de surpasser le rôle plutôt tragique de famille de pazzis.
Cornelius Vanderbilt, posterboy du rêve américain
Il naît sur une petite ferme à Staten Island, dans l'état de New York, un jour d’hiver 1794. Délaissant l'école à l'âge de 11 ans, Cornelius commence à travailler comme manoeuvre dans les traversiers reliant l'île de New York aux berges de la Hudson. Il n'a que seize ans lorsqu'il démarre sa propre affaire, une plateforme faisant la navette entre l'île de Manhattan et Staten.
La guerre de 1812 fait de lui un homme important lorsqu'il décroche le contrat d'approvisionnement des forts protégeant la ville de New York. Évidemment, il en faut de bonnes, pour aller et venir sur le fleuve, la cale pleine de munitions, sous le feu de l'ennemi. Pour remplir cet engagement, il acquiert une petite flotte de schooners. De là lui vient son sobriquet de "commodore". À dix-neuf ans, il épouse sa cousine et voisine Sophia, qui lui donnera 13 enfants.
À la fin de la guerre, deux crapules bien planquées, Fulton et Livingston, réussissent à se faire octroyer le monopole de toute la navigation à vapeur dans les eaux de New York. Vanderbilt décide néanmoins d'offrir un service sur la très cruciale route entre Philadelphie et Manhattan. Grâce à sa tête de bouc et à sa grande connaissance des eaux, il parvient à éviter la capture de ses navires par les autorités. Fulton fulmine et Livingston est livide !… Ils tentent de l'acheter, en vain. Il réplique : « Je ne me soucie pas tellement de l'argent que je fais, ce que je veux surtout c'est prouver mon point. » Vanderbilt, innocent petit fermier dans les souliers d'un homme d'affaire, croit fermement à la libre entreprise, au american dream. Fulton et Livingston le poursuivent jusqu'en cour suprême, perdent, et voient leur petit empire démantelé. On y croirait presque nous aussi. Mais les temps vont changer.
En 1829, Vanderbilt relie Manhattan à Albany. Travailleur infatigable et tyrannique, dès les années trente, il se lance dans les chemins de fer. Sa flotte compte 100 navires en 1840 et il est désormais considéré comme le plus important employeur de tous les États-Unis. La ruée vers l'or lui donne l'idée d'offrir un raccourci aux émigrants passant par les lacs du Nicaragua. C'est dans cette optique qu'il finance la pathétique aventure de William Walker, dont j'ai parlé dans le premier chapitre.
Résolument unioniste à l’éclatement de la guerre civile, Vanderbilt offre un de ses navires à vapeur aux forces fédérales, pendant que ses contemporains Rockefeller, Morgan et cætera, beurrent leurs tartines des deux côtés. Lincoln lui en est reconnaissant et à la fin de la guerre… lui offre une médaille. Difficile de s'empêcher d'imaginer les membres du club des banquiers en train de se taper sur les cuisses !
Sa femme s'éteint en 1869 et il se remarie, avec une autre cousine, une Crawford. En 1870 Cornelius Vanderbilt possède un immense empire ferroviaire incluant les Hudson River Railroad, New York Central et New Haven Railroads. C'est lui qui crée le Grand Central Terminal à New York. Bonhomme terre à terre, fils d’agriculteur, il restera adepte d’une certaine simplicité et malgré sa cyclopéenne fortune, habite jusqu'à la fin de ses jours la modeste maison familiale de New York.
Vanderbilt fait d’ailleurs très peu la charité de son vivant, ne laissant à toute fin pratique qu'un million pour la fondation de l'Université Vanderbilt. Tout puritain, conservateur, et pingre qu’il est, il prête pourtant sept mille dollars aux sœurs Virginia et Tennie Caflin, suffragettes notoires et grandes héroïnes obscures du féminisme, pour les aider à se partir en affaires. Il faut dire qu’elles sont comme lui, nées pauvres, bouillantes et pleines d’ambitions et d’espoir dans la destinée glorieuse de l’Amérique. Grâce à son aide, les deux sœurs publient des années durant leur journal radical Woodhull and Caflin’s Weekly
Dans son testament, Cornelius Vanderbilt déshérite tous ses enfants sauf son fils William, qu'il considère seul capable de sauvegarder l'empire familial, à qui il laisse 95% de sa fortune, évaluée à 100 M.
Après sa mort en 1877, quatre de ses enfants contestent son testament, arguant l'aliénation mentale. En 1882, après de multiples et infructueuses batailles judiciaires, le meneur des contestataires, Cornelius Jeremiah se donne la mort. Il est le premier d’une longue lignée de suicidés dans l’histoire tragique de cette dynastie. L'héritier principal, William Henry Vanderbilt, se jette au travail comme un forcené et parvient à faire profiter les entreprises familiales, à telle enseigne qu'il double la valeur de l'empire en moins de neuf ans. Cependant, il meurt en 1885, l'homme le plus riche de la Terre et selon toute vraisemblance, un des plus actifs pazzis de l'histoire moderne.
Qu'on cesse les pleurnichardes. Les chemins de fers ne roulent pas pour le bénéfice du cher public. Ils sont construits pour des hommes qui y investissent leur argent et espèrent en tirer un profit. — William Henry Vanderbilt
Ses enfants à lui, contrairement à leurs père et grand-père, cherchent de toutes leurs forces à accéder à la bonne société, à obtenir une reconnaissance de la part des classes aristocratiques américaines. Ils croient accomplir cet exploit en brisant avec la tradition puritaine de leurs parents et en se faisant construire d'épatants châteaux, les fameux « Manoirs Vanderbilt », dont les photographies et reproductions font l’objet d’un véritable ouragan médiatique. On leur fera ainsi croire qu'ils sont parvenus à joindre le groupe des familles oligarchiques américaines de l'ère moderne.
 William Kissam Vanderbilt
William Kissam Vanderbilt
Il est choisi par son papa pour porter le flambeau de la dynastie. Sa première femme, Avan Erskine Smith vient de l’Alabama, d’une famille de grands propriétaires d’esclaves. On lui doit le fameux aphorisme « marrie-toi une première fois pour l’argent, ensuite, par amour ». Elle force leur fille à marier le Duc de Marlborough. Après leur divorce, William Kissam épouse Anne Harriman. Il reste le chef de la famille jusqu’à sa mort en 1920.
Le boulot de pazzi qu’on préférerait ne jamais se voir confier est sans doute celui de chair à torpille. Alfred, petit fils de Cornelius, a hérité toute la fortune de Cornelius II, puisque Cornelius III a été déshérité (décidément) et que William Henry II est mort.
Il gaffe un peu, le bel Alfred, en 1908, et entreprend de tripoter les grivoises rondeurs de la sémillante Agnès Ruíz, femme de l’ambassadeur de Cuba. Éplorée, après un humiliant divorce, Ellen French, la femme d’Alfred, se suicide en 1909. Alfred part se cacher à Londres et se remarie rapidement avec Margaret Emerson, héritière d’une des premières grandes pharmaceutiques, fabricante du Bromo-Seltzer. Le 7 mai 1915, il est tué dans la catastrophe du transatlantique Lusitania.
Le Lusitania est un navire de la flotte de J.P. Morgan. Je suis tenté de croire que les organisateurs internationaux de la première guerre le font couler par une torpille plus ou moins allemande, dans le but d'amener les É.-U. à entrer en guerre. C’est une très grande illustration de la guignolerie de l’époque que l’état-major allemand s’empresse de confirmer sa responsabilité. C’est donc qu’on prend ses ordres de la même source et en très haut lieu, que ce soit chez le boche, ou chez le rosbif. La mort d'Alfred Gwynne Vanderbilt à bord du Lusitania sert trois propos. Primo, convaincre monsieur tout le monde que la guerre n'est pas une pièce de théâtre montée par les puissants (même leurs propres mômes y périssent !). Secundo, stimuler les sentiments belliqueux de la classe des nouveaux riches, jusque là opposés, comme tous les Américains, à l’idée absurde d’aller soi-même ou d’envoyer des gens se faire ouvrir le ventre par des obus dans cette guerre grotesque aux motivations abstraites. Tertio, sa mort nettoie la famille d’un élément indésirable, qui ne devait pas manquer d’attirer les railleries de la bonne société de l’époque.
 William Kissam Vanderbilt II
William Kissam Vanderbilt II
Le petit Willie va sans trop s'en rendre compte créer un monstre. En 1902, il se fait construire un palace à Long Island. Son enthousiasme pour les voitures rapides l'amène à organiser une classique, la Coupe Vanderbilt, tout premier événement majeur de course automobile tenu en Amérique. La course a lieu chez lui, à Long Island, dans le comté de Nassau, actuel domicile des Islanders de New York de la LNH. La course souffre d'un « problème de contrôle du public » et en 1906, la mort d'un spectateur convainc les autorités de financer la construction du Long Island Motor Parkway, la première autoroute de l'histoire, construite sur des bandes de terres appartenant au chemin de fer familial.
Évidemment, le résultat final est que monsieur Vanderbilt peut se rendre plus rapidement en bagnole de son bureau de New York à son manoir de Long Island. Ce mode de vie est lourdement médiatisé par la suite, de façon à rendre désirable ce qui deviendra le american way of life, une vie centrée sur l'automobile, l'autoroute, et la vie au grand air. Détail amusant, William Kissam passe beaucoup de temps en Acadie, dans sa gigantesque pourvoirie personnelle sur la rivière Restigouche. En 1933, comme il sied à un des inventeurs de la Suburbia, Wiliam Kissam Vanderbilt III, son fils, meurt tragiquement, entre chez lui et New York, dans un... accident de voiture.
Au moment du Crash de 1929, selon Tarpley et de nombreuses sources, les Vanderbilt font partie du petit arche de Noé des grands banquiers qui profitent de l’écrasement des marchés pour mettre la main sur d’immenses territoires et sur une part monstrueuse de l’industrie indépendante du monde industrialisé. Cependant, les Vanderbilt perdent quand même 40 million en quelques années, ne serait-ce que parce que le peuple n’a plus les moyen de prendre ni le bateau ni le train.
 Cornelius Vanderbilt junior
Cornelius Vanderbilt junior
Qui fait régulièrement scandale. Il faut songer à élever la mémoire de Cornelius Vanderbilt au rang de héros du féminisme !
Le fils de Frederick devient socialiste au cours de ses études en finance à Londres. Pour cette raison, sa famille le déshérite des 74 millions de dollars qui auraient dû lui revenir. Ça ne le libère pas tellement, lui qui jusqu'à la fin, malgré le pacte de non-agression nazi-soviétique (Molotov – Ribbentrop), malgré les octrois aux banques de Wall Street, les procès truqués, les exécution, et même pendant l’atroce guerre d’Espagne, soutient Staline et son faux communisme trempé dans le sang des travailleurs.
Il lui arrive une aventure particulière en 1926, alors qu’il séjourne en Italie. Certaines sources prétendent qu’il est à l’époque ambassadeur des Etats-Unis à Rome, ce qui est faux. Je n’ai pas encore réussi à établir les raisons de sa présence sur place. Quoi qu’il en soit, lui et Mussolini sont potes comme larrons en foire et Benito l’emmène pour virée extravagante et arrosée de quatre jours à travers le Nord de la presqu’île à bord d’un… blindé !… Cornelius Jr. Raconte, en 1959 : Un petit bambin se tenant sur le côté de la route tenta de traverser avant que nous n’arrivions sur lui. Le véhicule eût un soubresaut et je sentis les roues monter puis redescendre. Je me retournai rapidement. Je revois encore le petit corps écrabouillé étalé sur la route. Je sentis alors une main sur mon genou droit et j’entendis une voix qui disait « Ne regardez jamais en arrière, monsieur Vanderbilt, ne regardez jamais en arrière, dans la vie. »
Peut-être alerté par cette aventure, ce sera ce même Cornelius Junior qui révélera en tout premier lieu au monde l’existence des camps de concentration nazis. Malheureusement pour les millions de victimes de ces camps, l’occident trouvera les descriptions trop brutalement horribles, trop exagérées et dégénérées pour y croire et sa crédibilité en souffrit. C’est toujours le même Cornelius qui poussera Charlie Chaplin à tourner The Great Dictator. En voyage en Allemagne au cours des années trente, il envoya au comédien réalisateur une série de cartes postales représentant Adolf Hitler en pleine action. Mort de rire devant les simagrées du petit pazzi autrichien, Chaplin commença à l’imiter, frappé de la ressemblance du Fuhrer avec Charlot, son personnage célèbre. C’était à l’époque où on rigolait encore à entendre le nom de Adolf Hitler.
70 ans après la mort du Commodore, il ne reste rien de tous les légendaires manoirs des Vanderbilt sur la 5e avenue, réduits en poussière. La plupart des autres sont devenus des musées. En 1989, il ne reste pratiquement plus rien de la fortune familiale.
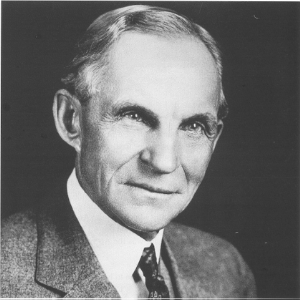 Quelqu'un a dit un jour que soixante familles dirigent les destinées du pays. Mais si on se penchait sur les vingt-cinq individus en contrôle des finances de la nation, les véritables faiseurs de guerre de la planète seraient révélés.
Quelqu'un a dit un jour que soixante familles dirigent les destinées du pays. Mais si on se penchait sur les vingt-cinq individus en contrôle des finances de la nation, les véritables faiseurs de guerre de la planète seraient révélés.
Il y a deux Wall Street. La partie qui crée et la partie qui détruit. Morgan fait partie des créateurs. Je connais monsieur Morgan depuis des années. Il a toujours aidé et supporté Thomas Edison, un de mes amis intimes...
Henry For est né sur une ferme près de Détroit au Michigan d’un père irlandais et d’une mère d’origine belge. Il a commencé à s’intéresser à la mécanique vers l’âge de dix ans, se créant une réputation de réparateur de montres. Il travaille comme machiniste, opérateur de moteur à vapeur, puis ingénieur à la Edison Illuminating. À 40 ans il fonde avec quelques associés la Ford Motor Company. Nous sommes en 1903.
Contrairement à la croyance répandue, Henry Ford n’invente pas l’automobile. C’est plutôt un certain Karl Benz qui accomplit l’exploit en 1885. Ferdinand Verbiest avait lancé l’idée en 1672, avec un véhicule autonome à vapeur qui ne connut pas un succès retentissant. C’est 13 ans avant la fondation de la compagnie Ford que la première production industrielle d’automobiles est lancée, en France, par Émile Levasseur et Armand Peugeot. Dès 1897, la Daimler Motor Company se lançait dans la production de masse de son véhicule, la même année où Rudolf Diesel construisait son premier moteur.
Contrairement à la croyance répandue, la chaîne de montage n’a pas été inventée par Henry Ford. La chaîne de production avait été conçue par Oliver Evans en 1780 et la chaîne d’assemblage proprement dite fut l’œuvre de Eli Whitney, autre fils de fermier états-unien né dans la région de Boston, qui organisa ainsi sa fabrique de mousquets en… 1801 ! Une chaîne d’assemblage a également été inaugurée la même année en Angleterre par le Français Marc Brunel.
Contrairement à la croyance répandue, Ford n’a pas non plus été le pionnier de la chaîne d’assemblage pour l’industrie automobile. Ransom Eli Olds l’avait brevetée en 1901, faisant de sa compagnie, la Olds Motor Vehicle Company, la première entreprise états-unienne à se lancer dans la production de masse dans le secteur automobile.
Mais… Mais… Mais !… glapit le lecteur. Mais que doit-on à ce monsieur Ford ? n’est-il pas une grande figure de l’Amérique, un avant-gardiste ?! Un innovateur ?! L'auteur de ces lignes répondra : tout à fait. En vérité, monsieur Ford a surtout été un précurseur au plan social et politique. Cependant, comme c’était un homme d’une grande modestie, et que les États-Uniens en général sont des gens qui détestent la vantardise et le chauvinisme, ses plus grandes visions sont restées dans l’ombre, pratiquement inconnues du public. Ne reculant devant rien pour honorer la mémoire de ce champion de l’avancement social, je vous propose ici de nous rafraîchir la mémoire en évoquant quelques uns des exploits héroïques moins connus de ce bon vieux Henry Ford, de sa compagnie, de ses descendants.
Henry Ford inventa presque le pacifisme. En plein cœur de la Première Guerre mondiale, Ford finança l’équipage d’un navire pour la paix qui vogua de l’Amérique jusqu’en Suède. Cependant, le Monde n’étant pas prêt pour cette idée, Ford fut l’objet de blagues dans les médias. Pas homme à s’en laisser imposer, il quitta le navire, retourna chez lui et se lança dans la production massive de munitions, accumulant des millions de dollars de profit dans l'aventure !
En 1918, Ford acquiert un tout petit journal, le Dearborn Independent. Homme de conviction, Ford y publie les Protocoles des Sages de Sion ! Les idées répandues dans ce journal étaient notoirement anti-immigration, anti-ouvrières et anti-sémites. Le tirage grimpa jusqu’à atteindre 700 000 lecteurs. En plus des absurdes Protocoles, le Dearborn publia au cours des années 20 un ensemble de quatre tomes intitulé Le Juif International, Principal Problème de l’Humanité.
Ces publications connurent un franc succès, notamment en Allemagne et en Autriche, où un certain Adolf Hitler en fit une lecture admirative. Hitler afficha une photo de Ford sur son mur et parla même de lui dans son excellent petit caca intitulé Mein Kampf (Mon Combat). Monsieur Hitler proclama même : « Je ferai de mon mieux pour mettre en pratique les théories de Ford en Allemagne et je concevrai une voiture du peuple (la Volkswagen), sur le modèle de la Ford-T. »
Le Dearborn condamna malgré tout les pogroms. En fait, ils condamnèrent surtout les juifs eux-mêmes, qu’ils tenaient pour principaux responsables de ces déplaisants désordres. Un avocat juif de San Francisco, Aaron Shapiro poursuivit le Dearborn pour diffamation, ce qui entraîna sa fermeture en 1927. Villipendé, Ford tenta de faire porter le chapeau à ses éditeurs, prétendant même n’avoir jamais lu sa propre chronique (Ford’s Own Page), La Propre Page de Ford. Ces prétentions furent démolies en cours de procès.
Ce n’est en 1942 (!) que cessa la distribution des populaires volumes Le Juif International. Quelques déficients le proposent encore sur Internet aux sub-normaux en manque de crétineries.
Sur une note triste et émouvante, on raconte que monsieur Ford, alors âgé de 80 ans, subit une crise cardiaque en regardant un film tourné dans les camps de concentration Nazis. Un grand sensible.
L’amitié entre les peuple
Russie : En 1929, l'année du Crash, un autre de ses admirateurs, Josef Staline, fit construire par Ford une usine modèle à Gorky, capable de produire 100 000 véhicules par année, le tout assorti d’un contrat d’achat de produits Ford d’une valeur de 30 millions.
Espagne : Lorsqu’une coalition de libéraux, de marxistes et de socialistes remporta les élections en 1936, le Général Franco, fort de sa longue expérience des guerres coloniales en Afrique et soutenu financièrement par Hitler et Mussolini, attaqua la république à l'aide d’une armée de traîtres, de fascistes et de mercenaires. Son groupe était sur le point de perdre la guerre civile quand ses amis de Ford, General Motors et Studebaker lui firent cadeau de 12 000 véhicules divers. Le Reich et l’Italie de Mussolini en ajoutèrent 6 000 et la Luftwaffe vola carrément au secours du futur despote, inventant au passage le bombardement aérien de populations civiles. Staline, de son côté, socialiste de nom et de logo, mais fasciste dans les faits, se fit un plaisir d’abandonner la république espagnole. Les gouvernements démocratiques du monde entier restèrent de glace et seuls quelques associations se portèrent au secours de la démocratie espagnole, de façon indépendante. La quasi-totalité des survivants de ces brigades furent poursuivis dans leurs pays. Ford continua à opérer dans l’Espagne Franquiste jusqu’à la mort du dictateur et le gouvernement des États-Unis investit massivement dans la consolidation du tyran, considérant Franco comme un allié dans la Guerre Froide.
Allemagne : En 1922, la révolte bavaroise du parti National Socialiste d’Adolf Hitler reçut un appui de taille lorsque Henry Ford y contribua 70 000 $. Il continua de soutenir Hitler tout au long des années 20 et 30.
En 1928, Ford Motors fusionna 40 % de ses intérêts en Allemagne avec ceux du cartel I.G. Farben, la compagnie pro nazie des Warburg. Carl Bosch de I.G. Farben devint le président de Ford-Werke, alors que Edsel Ford, le fils de Henry rejoignit le conseil d’administration de I.G. Farben Amérique.
Juste à l’aube de la Seconde Guerre Mondiale, en 1938, les responsables du Troisième Reich remirent à Henry Ford la médaille de la Grande Croix de l’Aigle, la plus haute distinction décernée à un étranger par l’Allemagne Nazie. Benito Mussolini avait reçu la sienne. Il faut dire que Ford Motors venait d’inaugurer à Berlin une usine d’assemblage de camions pour le transport des troupes de la Wermacht.
Au début de la guerre, en 1939, tant Ford que GM convertirent leurs usines allemandes et autrichiennes vers la production d’équipement militaire. GM et Ford construisirent 90 % des transports blindés Mule, et 70 % des camions lourds du Reich. Les services d’espionnage États-Uniens considéraient ces véhicules comme la colonne vertébrale du système de transport allemand.
Au cours du conflit, Ford-Werke assuma le contrôle de toutes ses filiales en Europe et profita bien de l’occupation pour écraser Renault, Citroën et Peugeot en France et solidifier sa position en Hollande, en Belgique et au Danemark. Le président de Ford France, Maurice Dollfuss, fut le tout premier dignitaire Français reçu à Berlin après la capitulation. Il écrivit dans une lettre à Edsel Ford en 1941 que les profits nets de l’entreprise atteignaient des niveaux records, à 58 millions de francs.
En 1942, l’aviation britannique bombarda l’usine Ford de Poissy. Les médias alliés publièrent même des photos du bombardement, mais aucun ne mentionna le fait que l’usine appartenait à Ford Motors. Le gouvernement de Vichy compensa Ford pour la destruction de sa propriété, lui octroyant une maigre pitance de... 38 millions de francs.
Après la guerre, Ford et GM exigèrent des dommages et intérêts du gouvernement des États-Unis pour compenser les ravages qu’avaient subi leurs intérêts sous les bombardements alliés. Ford reçut entre autres 1 million de dollars pour la « destruction » de son usine de Cologne, qui fut pourtant totalement reconstruite et opérationnelle dès 1945.
Réduction de la Population
Ford a été un ardent défenseur des plastiques de soja et de l’éthanol. L’idée géniale de brûler de la nourriture dans le moteur à combustion d’une voiture construite à 75% de protéines comestibles vient de lui. En 1942, il présenta réellement au public une automobile en plastique de soja fonctionnant à l’agro combustible. Déplorable mais vrai, ce fut un bide total.
Imaginez seulement ce que serait aujourd’hui la population du globe si nous avions eu la sagesse de suivre sa vision et d’arracher de la bouche des hordes sauvages les aliments nécessaires à leur pullulement ! Tous ces difformes nourrissons du tiers-monde serviraient d’engrais pour nos réservoirs ! Un monde idyllique ! Le blanc irait faire ses courses dans un carrosse en os de pauvres ! Ah, que de rêves, que de rêves !
Ford a vraiment inventé quelques trucs, pour de vrai de vrai !… Ford a contribué à inventer les briquettes de BBQ. Il a eu l’idée de vendre les retailles de bois qui traînaient dans la cour de son usine. La compagnie ainsi créée, Kingsford, triomphe toujours dans ce domaine de pointe. D’autre part, les employés de Ford ont vraiment inventé le convoyeur. Puis, c’est Ford qui a eu l’idée de forcer un employé à demeurer immobile devant sa machine toute la journée, dans le but d’améliorer sa sécurité.
 Lindbergh
Lindbergh
Ford était un ami intime du célèbre pilote Charles Lindbergh, président du parti pro-nazi America First. Comme le bon Henry, Lindbergh était un fan de l’eugénisme et un ardent promoteur de la suprématie de la race Aryenne. Terrifié par le communisme, qui risquait de « noyer la race blanche dans une mer de Jaunes, de Noirs et de Bruns », il prônait ouvertement une alliance Américano-Germanique contre la Russie soviétique. Anti-sémite modéré, il proposait de limiter le pourcentage de Juifs dans la société, mais d’en garder quelques uns, puisque « une faible quantité du bon type de Juif peut constituer un atout pour n’importe quel pays ». En raison de sa proximité avec le régime de Hitler (il reçut lui aussi une distinction nazie en 1938), Roosevelt l’empêcha de se joindre à l’armée états-unienne au cours de la Seconde Guerre.
- Ford détestait par principe toute activité impliquant que des gens se touchent. Il a beaucoup investi dans les clubs de set carrés, contribuant à la popularité de cette danse vertueuse.
- Ford aimait s’habiller en Père Noël.
- Ford était un grand ami de Thomas Edison. Ça ne l’a pas empêché de se livrer à l’étonnante entreprise de capturer son dernier souffle sur son lit de mort. L’éprouvette est en vitrine au musée Henry Ford près de Détroit. L’auteur de ces lignes ne se peut plus à l’idée d’un jour poser les yeux dessus en personne.
Chapitre 9 - Edward Bernays
 Si nous comprenons les mécanismes et les motivations de la pensée de groupe, ne pouvons-nous pas contrôler et enrégimenter les masses selon notre volonté, sans qu’elles ne s’en doutent? La pratique récente de la propagande a prouvé que c’était possible, du moins jusqu’à un certain point. — Edward Bernays, Propaganda, 1928
Si nous comprenons les mécanismes et les motivations de la pensée de groupe, ne pouvons-nous pas contrôler et enrégimenter les masses selon notre volonté, sans qu’elles ne s’en doutent? La pratique récente de la propagande a prouvé que c’était possible, du moins jusqu’à un certain point. — Edward Bernays, Propaganda, 1928
L’Ingénierie du Consentement
Edward Bernays, que Joseph Goebbels idolâtrait, a vraiment existé.Dites à votre cousine Nathalie, celle qui répète constamment « théorie de complot », qu’elle peut la boucler. D’ailleurs, cette locution, « théorie de complot », est ce que Bernays a appelé un « tampon » (rubber stamp), voir annexe 1.
En 1923 Bernays publie Crystallizing Public Opinion (La Cristallisation de l’opinion publique). Les relations publiques modernes sont nées, et remplacent désormais les primitives techniques publicitaires.
Ce n’est pas Edward Bernays qui invente la profession de conseiller en relations publiques. Le tout premier à faire vraiment ce métier sera Ivy Ledbetter Lee.
Il n’y a pas qu’en Europe que la guerre fait rage, en 1914. En Amérique, le monde corporatif affronte les ouvriers. Avec des mitrailleuses. Lors d’une grève de mineurs particulièrement acrimonieuse à Ludlow, au Colorado, John D. Rockefeller fait intervenir l’armée, qui ouvre le feu dans le campement des grévistes. Deux femmes, six hommes et douze enfants meurent carbonisés et criblés de balles dans le massacre, et des centaines sont blessés. Étrangement, cette petite bavure nuit à l’image de Rockefeller, qui a déjà souffert de la publication de nombreux articles révélant ses agissements de crapule mafieuse et l’échelle à peine humaine de la corruption que sa tentaculaire Standard Oil a engendrée dans le monde entier. En fait, l’époque du fameux « que le public aille se faire foutre » du fils Vanderbilt est révolue. Le public commence à en avoir marre, et songe peut-être finalement à pendre aux lampadaires les porcs qui égorgent ses enfants. Ça lui passera.
Ainsi naît l’ère moderne des relations publiques. Poison Ivy Lee est engagé par Rockefeller pour refaire son image. Celui-ci bourre les journaux d’articles exposant les syndicats (et toute opposition ouvrière) comme un frein à la très souhaitable liberté industrielle. De l’autre côté, Lee convainc Rockefeller que la rénovation de son image passe par une apparence de grandeur d’âme, et que le succès financier de ses multiples cartels ne pourra qu’en profiter. D’où l’idée de toutes ces largesses et générosités dont le spectacle grossier garnira dorénavant sans merci les colonnes de la machine médiatique.
Aujourd’hui, on connaît mieux Rockefeller pour l’infinie bonté de sa philanthropie munificente que pour ses pratiques illégales en affaires, sa brutalité dans les relations de travail, son rôle sinistre dans la montée de l’Allemagne Nazie. C’est un retentissant succès de relations publiques !
À compter de ce jour, Ivy Lee soignera l’image des Rockefeller et de leurs amis et collègues, qui se préparaient à un long siècle de bavures et avaient bien l’air de se douter que pour garder la cousine Nathalie bien nounoune, il faudrait pomper des milliards dans ce qui ne s’appelait pas encore la désinformation. Ils ne se doutaient cependant pas à quel point ce drôle petit métier de crieur de cirque allait se perfectionner sous leurs yeux, sous l’action combinée du bon gros cash, de l’étonnante psychanalyse et du génie d’un tout petit homme nommé Edward L. Bernays.
Edward Bernays est né à Vienne, en 1891, mais à l’âge d’un an, il devient citoyen des Etats-Unis d’Amérique lorsque son papa Ely émigre à New York. Le petit Eddie est le neveu de Sigmund Freud, dont il lira les livres, qu’il admirera non seulement pour sa célébrité, mais aussi pour la profondeur de ses découvertes et avec lequel il conservera un contact privilégié. Il débute dans la carrière en s’occupant de la mise en marché d’une tournée américaine des Ballets Russes, puis devient l’impresario de Caruso, avec lequel il fait ses armes et grâce auquel il sera introduit au gratin du showbiz, ce qui lui servira par la suite. Il tente sans succès de s’engager dans l’armée de terre, qui le rejette en raison de ses lointaines origines autrichiennes. Qu’à cela ne tienne, on le retrouve à l’état major, où il aide à prêcher l’effort de guerre.
Un de ses premiers clients est Mazaryk, le président de la toute nouvelle Tchécoslovaquie. En 1918, Bernays le persuade de retarder l’indépendance de son pays d’une journée, pour mieux s’assurer les premières pages des journaux.
Edward Bernays force une rupture importante dans la façon de mettre un produit en marché en faisant réaliser à l’industrie qu’il est plus efficace de s’adresser indirectement au désir (inconscient) du client qu’à ses besoins.
Jusqu’aux années 20, la compagnie Poupou Poulet Inc. proposait à Nathalie d’acheter les poulets de Poupou Poulet Inc en vantant leur durabilité, leur versatilité, la qualité de leur fabrication, et gnagnagna. À compter de Bernays, qui commence à expérimenter sur la gestion des masses en utilisant la stimulation du soi irrationnel, l’entreprise convainc plutôt Nathalie qu’il lui manque un pénis, et qu’elle peut remplacer ce pénis par un poulet de Poupou Poulet Inc.
Dans les années 20, les grandes banques américaines fondent d’immenses chaînes de magasins et les truffent à craquer de produits innombrables. C’est la naissance de la société de consommation et, dorénavant, il n’y a plus rien de rationnel dans la relation entre le consommateur et le produit, puisque c’est à son inconscient qu’on s’adresse. L’ampleur du phénomène est ahurissante. C’est à compter de cette époque que les chaînes de restauration poussent comme des champignons, proposant principalement deux produits, le pénis (hot-dog) et le nichon (hamburger).
Les Flambeaux de la liberté
Bernays raconte avec fierté comment il a réussi à faire fumer la cigarette aux femmes de la planète.
American Tobacco payait depuis des années les grandes stars de l’opéra pour prétendre que les Lucky Strikes adoucissaient leur voix, reposaient leur gorge, magnifiaient leurs performances et purifiaient leur timbre. Une entreprise concurrente engage Bernays, qui recrute une armée de médecins et de spécialistes de la gorge et de la trachée, chargés d’exprimer l’idée qu’aucune preuve scientifique ne permet d’affirmer que les Lucky Strikes sont meilleures pour la santé que leurs concurrentes, qu’en fait, toutes les cigarettes sont également bénéfiques pour la gorge, la voix, et la santé en général, pas seulement les Lucky Strikes. Le résultat est immédiat. Et American Tobacco engage Bernays à l’année, n’exigeant au départ qu’une chose, qu’il ne travaille plus pour ses adversaires.
Les compagnies de tabac américaines avaient frappé tout un coup de génie au cours de la première guerre mondiale, en faisant acheter par l’armée des milliards de cigarettes, qui étaient distribuées aux soldats parmi leurs rations. Jusqu’alors, les hommes leur préféraient le cigare, la pipe ou la chique, jugés plus virils, mais lorsque les GI reviennent du front en 1918, la cigarette est devenue synonyme de fraternité, de victoire, et de la domination de l’Amérique. Un problème persiste, la femme. D’une part, l’homme refuse de voir la femme fumer. De nombreux établissements interdisent carrément les fumoirs aux femmes. D’autre part, quant à la femme elle-même, elle trouve vulgaire l’idée de fumer en public, et les quelques rares fumeuses le font en cachette.
Dans les années 20, Bernays analyse la situation, soumet ses observations à un psychiatre de New York qui confirme ses soupçons. Bernays orchestre un des grands coups de marketing de l’histoire en détournant une marche catholique (la procession de Pâques) pour en faire un événement politique au profit des suffragettes. Une dizaine de jeunes premières, invitées par lui et soigneusement instruites du plan de bataille, se présentent au-devant de la procession, exhibent leurs cigarettes, et s’allument devant les caméras des journaux. Bernays lance le slogan aux journalistes présents: « elles allument des flambeaux pour la liberté ».
Ça coule de source. Les journaux accordent la première page à la nouvelle. Les conservateurs vendent de la copie grâce à l’aspect scandaleux. Les progressistes sont charmés. Les féministes exultent, jubilent de l’ampleur du phénomène médiatique. Toute la société états-unienne est flattée sur la muqueuse par l’imparable évocation de la sacrosainte liberté. La femme éprise d’émancipation devra simplement fumer. Fumer c’est voter !
Tout le monde profite des photos sexy de ces jolies jeunes femmes. Tous y gagnent! C’est fantastique. Bernays avait compris que la femme de l’après-guerre avait bossé dans les usines pendant que les hommes étaient au front et il lui offrait un symbole phallique digne de l’ampleur de ses revendications, la clope.
Les succès se poursuivent pour l’association Bernays American Tobacco. Histoire de mousser les ventes encore plus, Edward recrute différentes associations de médecins et finance leurs campagnes agressives pour la minceur chez la femme. La femme américaine en santé sera donc filiforme ! Les magasines spécialisés et les publications destinées aux médecins publient des articles, vantant les vertus de la maigreur féminine, mais aussi de la Lucky Strike, le choix des médecins, et toujours la meilleure pour la santé.
Des publicités dans les journaux et les magazines, présentées par des regroupements de docteurs, de médecins de famille, de dentistes et d’instituts plus ou moins bidons (tous fondés par Bernays avec des fonds de American Tobacco) proposent ensuite carrément à la femme de tendre la main vers une cigarette plutôt que vers un bonbon, ce qui est tellement meilleur pour la santé. La campagne connaît un tel succès que les grands confiseurs et les producteurs de sucre attaquent American Tobacco en justice et réclament des dommages et intérêt. C’est un triomphe, la femme est maigre, elle est libre, elle respire la santé !
Bernays invente le concept de la bidirectionnalité du rapport entre le produit et le client. Eddie est le premier à proposer d’aller voir le consommateur en personne pour écouter sa voix. Les instituts de sondage naissent de ce nouveau besoin. Gallup est le tout premier, en 1935. C’est en tenant un des tous premiers focus groups que Bernays découvre un défaut majeur de la cigarette dans la conquête du public féminin, la couleur. Primo, la femme moderne veut porter du rouge à lèvres (on vient justement à peine de la convaincre que ses lèvres n’avaient pas la bonne teinte) et le rouge tache la cigarette. C’est pas beau. On lui offre donc premièrement des cigarettes mode, avec l’embout de couleur foncée. Ce n’est pas tout. Le paquet vert des Lucky Strikes déplaît aux dames, puisqu’il ne va avec rien de ce qu’elles portent. Bernays propose à American Tobacco de modifier la couleur du paquet pour qu’il s’agence avec les teintes de l’époque. Il affronte un refus catégorique. La marque a mis tellement d’énergie à imposer son image que c’est hors de question. Qu’à cela ne tienne. Eddie fait jouer ses contacts dans le milieu de la mode et des textiles (d’autres clients à lui) et parvient à imposer la couleur verte du paquet de Lucky Strikes. Le vert devient une des couleurs marquantes des années folles et, chose essentielle, la femme moderne peut sortir son paquet de Lucky Strikes n’importe où, il s’agence avec sa robe, le mur, les tentures, le piano, la lampe, le tapis. Et son teint.
Détail marrant, au cours de la même période, l’association des producteurs de porcs des États-Unis engage Bernays. Celui-ci se rend compte que les américains se contentent pour la plus part d’un simple café ou d’un jus d’orange au petit-déjeuner. Eddy s’agite en tous sens, déniche quelques médecins prêts à tout pour un petit chèque, et entame une campagne multi-azimuths pour convaincre les états-unies de commencer la journée par des oeufs et du bacon. À cette époque, donc, une seule même entreprise de relations publiques, celle de Bernays, fait à la fois l’apologie de la maigreur et chante les vertus du bacon.
 Teapot Dome
Teapot Dome
Poison Ivy avait fait sa marque et son beurre grâce au massacre de Ludlow. C’est le scandale dit du Teapot Dome qui lance véritablement Bernays et lui fait mériter son surnom de Father of Spin (le père de la désinformation). Aux prises avec le scandale du Teapot Dome, le président Harding fait appel à Bernays. Celui-ci ne pourra pas l’empêcher d’être un peu assassiné. Il meurt empoisonné d’une embolie, d’une crise cardiaque et/ou d’un arrêt respiratoire compliqué par une étrange inaction des médecins, au cours d’un voyage en train.
C’est l’occasion d’inaugurer une (autre) annexe au Mauvais Siècle, qui s’intitulera le Petit Manuel du Filoutage. Le vice-président Coolidge devient président à la place du président et Bernays poursuit son boulot de réparateur d’image. On vend dans un premier temps l’idée rassurante que Coolidge est un personnage drabe, ennuyant, un homme ordinaire, un bon mari (contrairement à Harding qui avait des copines), un petit potache sans l'envergure des crapules habituelles. Une fois que tout le monde a avalé cette idée, on s’attaque à son pseudo-caractère tristounet en le faisant passer pour un homme discrètement fascinant. Bernays organise des fêtes à la Maison Blanche avec tout le gratin d’Hollywood. Les journalistes accourent, les photographes se délectent. Coolidge devient cool tout court. Bernays est un membre à succès de la société New-Yorkaise, donnant parties sur soirées dans son chic appartement au Netherlands Hotel où il reçoit tant les stars que les politiciens, les riches, les grands de ce monde. Tout le monde est content.
Plus personne ne se rappelle que le Teapot Dome était relié au parti de Coolidge, qui remporte l’élection. Keep cool with Coolidge !
C’est également au cours de ces années que Bernays développe l’idée du Soi consommateur. Walter Lippman (auteur en 1922 de l’expression « fabrication du consentement » — manufacturing consent) et Bernays (qui pousse plus loin avec « ingénierie du consentement » engineering consent) considèrent tous deux que la masse doit être contrôlée, guidée, restreinte. Ses espoirs, désirs, besoins et aspirations doivent être canalisés par l’élite, les bergers du troupeau. L’élite de la société américaine (les grands banquiers, les industriels et leurs valets) rêve d’une société stable, docile et profitable.
Le consensus chez les historiens serait apparemment que Hoover manquait de charisme, ne s'y entendait pas en politique, n'avait pas beaucoup d'appuis chez les élus, ne pigeait rien à l'économie. Joli défi pour Bernays. Herbert Clark Hoover est élu président à la place de Coolidge en 1928. Il prend office le 4 mars 1929. Il avait été secrétaire du commerce sous Harding et Coolidge, donc le Teapot Dome avait été commis sous sa garde ! Qui s'en souvenait ? Qui s'en souçiait ?! Hoover garde Bernays à son emploi, lui confiant diverses missions. Dès le mois d'octobre de la première année du mandat de ce grotesque pazzi, c'est le crash. Bernays est donc au sommet de la tour durant ces années cruciales de la Grande Dépression, au cours desquelles les grandes banques américaines et internationales procèdent à leur immense arnaque.
En 1924, Procter & Gamble engage Bernays. Le problème ? Les enfants détestent le savon. Pourquoi ? Ça pique les yeux. Bernays lance un concours national de... sculpture dans le savon Ivory. Des millions d’enfants participent ! Ce faisant, ils apprivoisent le savon. De toute façon, chez Procter, on rigole bien, les écoles achètent des caisses de savon pour leurs cours d’art ! On distribue même aux mères de familles des guides expliquant comment transformer les copeaux en savon à lessive. Bernays restera à l’emploi de Procter & Gamble pendant près de quarante ans.
Les chapitres VI et XI de Mein Kampf sont directement inspirés de Cristallizing. Goebbels, d’abord rival, puis bras droit d’Hitler dans les années 20 et ministre de la propagande Nazi de 1933 à 1945, admirait ouvertement Bernays et s’inspira de ses livres et de ses exploits du début à la fin. Les nazis ont invité sans succès Bernays à venir travailler pour eux. Malgré qu’il partageait leur haine violente des communistes, Eddy, juif, patriote et progressiste, détestait le fascisme et a décliné. Pour Edward Bernays, l’élite devait effectivement dicter ses volontés au peuple, mais il prônait une manière douce et sophistiquée de mener le troupeau à l’enclos, contrairement à la méthode gourdin des Mussolinni, Franco et Salazar. Les Nazis étaient des gens ouverts, raisonnables, modernes ! ils se ménagèrent une méthode mixte, utilisant un peu de gourdin, un peu de chansonnette, et menèrent avec une belle vigueur le troupeau dans l’enclos, comme on le sait.
Bernays convainc les architectes et designers d’intérieur des années trente d’encastrer des bibliothèques partout. Son client ? L’éditeur géant Simon & Schuster. Les jeunes mariés cherchent des livres pour garnir leurs bibliothèques.
En 1931, dans le film Thirty Million Frenchmen, Maurice Chevalier chante une chanson dont un des vers est « You’ve got those ways, those fetching ways, that make me rush out to Cartier’s » (Ta façon charmante me donne envie de t’offrir une putain de montre de riche). Edward Bernays a payé les producteurs du film pour inclure ce vers dans le film. Le client de Eddie ? Cartier.
De la même façon, faisant fi de tout réalisme historique, les cowboys d’Hollywood commencent à fumer des cigarettes à l’écran. Des scènes de clope sont ajoutées brutalement au moment du tournage, souvent montées un peu n’importe où. L’important est simplement de faire croire à une tradition associant l’homme, le vrai, à la cigarette. Le héros des films de westerns n’est presque jamais un cowboy (employé de ferme), mais presque toujours le sheriff. Sheriff = flic = autorité = civilisation. Il est donc l’élément de l’histoire représentant la volonté de l’élite de mettre de l’ordre, d’asservir le monde aux besoins de la cité. D’imposer la volonté de l’empire aux hommes libres. J’invite les parents parmi mes lecteurs à méditer sur les personnages et les actions du film Toy Story que leurs enfants ont regardé mille neuf cent soixante quatorze fois. Le leadership est assumé par l’armée et la police. La peau est blanche. Le sexe est masculin. Les inférieurs suivent, aident, font de leur mieux, collaborent. C’est ce qu’on leur demande. Le mal ultime (identifié par la meuzik) : modifier les produits industrialisés pour en faire quelque chose de nouveau (certainement ce qu’on pourrait appeler l’art). Les produits souffrent quand on leur manque de respect. Ce film est une preuve que Bernays est éternel.
Une des grandes obsessions historiques de l’Amérique est Order out of Chaos (faire jaillir l’ordre du chaos). C’est une des phrases favorites de Rockefeller, qui pendant la conquête de l’Ouest faisait la conquête du Monde. C’est également une des expressions préférées de Edward Bernays, qui l’emploie souvent dans ses écrits. Ce sont les derniers mots de son bouquin de 1928, Propaganda.
En 1936, Bernays est engagé par la compagnie Philco pour développer le marché états-unien de la radio, jusque-là stagnant. Ça a marché.
 En 1939, Bernays participe de multiples façons à l’Expo Mondiale se déroulant à New York. Bernays est entiché par le lien entre la corporation et la démocratie. General Motors et Ford dominent l’exposition.
En 1939, Bernays participe de multiples façons à l’Expo Mondiale se déroulant à New York. Bernays est entiché par le lien entre la corporation et la démocratie. General Motors et Ford dominent l’exposition.
GM, un des clients de Bernays, présente sa vision de l’Amérique du futur, avec son pavillon très couru, le Futurama, dans lequel on peut voir les dessins de ce qui deviendra l’Étendue, la Suburbia, un monde futuriste guidé par la puissance de la corporation.
Une ville miniature fait partie des exhibitions, appelée Democracity, montrant un noyau commercial et industriel encerclé d’immenses landes recouvertes de bungallows. La maquette ressemble à s’y méprendre à l’Amérique du Nord actuelle. L’oeuvre de véritables visionnaires. Ils avaient deviné le futur !
Il faut dire que les grands cartels banquiers avaient profité du Crash de 1929 pour reprendre aux fermiers d’immenses étendues de terre dans le mid-west. Le plan pour le développement de ces étendues arrivait à maturité. Certaines personnes croient que ce modèle de civilisation est le fruit du hasard, ou encore un avènement naturel. Ces personnes se forgent des opinions. Tant mieux.
Certains observateurs attentifs remarquèrent l’absence de lieux de culte dans le modèle réduit. Avant qu’un scandale éclate, comme par magie, on y fixa quelques églises. Quelle importance ? Les habitants de la vraie Futuropolis ne seraient pas au pouvoir, mais plutôt leurs désirs inconscients.
L’Allemagne était étonnamment absente de l’exposition, dans le sens qu’elle n’y louait pas de pavillon. Par contre, sa présence se fit sentir tout au long des deux années de présentation, puisque les nations représentées à l’expo avaient une désopilante tendance à se faire annexer ou conquérir les unes après les autres par cette même discrète puissance teutonne.
La Tchécoslovaquie, puis la Pologne, le Danemark, la Hollande, la Belgique, le Luxembourg, la France, la Norvège… Certains pavillons demeurèrent ouverts jusqu’à la fermeture des lieux en 1940, derniers vestiges de la souveraineté de leurs mères patries.
Encore un de ces détails marrants, le pavillon de la Pologne était voisin de celui de l’Union Soviétique. En 1940, toute la section fut rasée au bulldozer pour faire place à un espace appelé la Commune Américaine.
La Route
 La compagnie Mack Trucks engage Bernays en 1949. Leur problème : ils ne peuvent pas vendre plus de camions. Ils ont saturé le marché. Eddie réalise que la concurrence ne vient pas des autres fabricants, mais bien du chemin de fer. Il parvient à imposer à son client une idée totalement folle, s’attaquer aux trains en faisant une promotion rageuse de l’autoroute. Une fortune est engloutie dans le projet. On forme des comités de citoyens bidons, de faux experts écrivent de vrais articles qui paraissent un peu partout, la pression populaire pèse sur des autorités déjà corrompues par des contributions non négligeables, c’est un véritable raz-de-marée qui prend d’assaut la campagne américaine ! On la couvre de routes ! Faut dire que General Motors est également client de Bernays, et que les tentacules supposément détachées de Standard Oil sont bel et bien là pour contribuer à l’effort. C'est juste si Bernays ne sort pas de sa manche un autre de ses Comités Nationaux des Médecins de Famille pour vanter les vertus de l'asphalte dans la lutte aux ongles incarnés. La civilisation de l’automobile prend son véritable essor.
La compagnie Mack Trucks engage Bernays en 1949. Leur problème : ils ne peuvent pas vendre plus de camions. Ils ont saturé le marché. Eddie réalise que la concurrence ne vient pas des autres fabricants, mais bien du chemin de fer. Il parvient à imposer à son client une idée totalement folle, s’attaquer aux trains en faisant une promotion rageuse de l’autoroute. Une fortune est engloutie dans le projet. On forme des comités de citoyens bidons, de faux experts écrivent de vrais articles qui paraissent un peu partout, la pression populaire pèse sur des autorités déjà corrompues par des contributions non négligeables, c’est un véritable raz-de-marée qui prend d’assaut la campagne américaine ! On la couvre de routes ! Faut dire que General Motors est également client de Bernays, et que les tentacules supposément détachées de Standard Oil sont bel et bien là pour contribuer à l’effort. C'est juste si Bernays ne sort pas de sa manche un autre de ses Comités Nationaux des Médecins de Famille pour vanter les vertus de l'asphalte dans la lutte aux ongles incarnés. La civilisation de l’automobile prend son véritable essor.
Évidemment, Eddie travaille pour le gouvernement états-unien pendant la Seconde Guerre. D’abord comme promoteur de l’entrée en guerre, puis de l’effort industriel, mais éventuellement comme consultant pour l’OSS (l’organisation des services secrets), qui deviendra ensuite la CIA. Comme c’était secret, on ne connaît pas grand’chose des activités secrètes de Bernays pour les services secrets. Comme disait un grand philosophe, « si je te disais mon secret, je ne serais plus agent secret ». Une rumeur court selon laquelle Eddie aurait participé à l’étude de la psyché nippone qui a mené a l’emploi de l’arme nucléaire contre le Japon. L’OSS aurait également caressé le projet de faire éclater les failles sismiques de l’île en bombardant les lisières des plaques techtoniques, mais ça, bon sang, ça serait sacrément dingue.
C’est probablement au cours de son passage à l’OSS qu’Edward Bernays se lie d’amitié avec les sympathiques frères Dulles, John Foster et Allan. Ceux-ci sont avocats, politiciens et grands amateurs de fruits. Ils invitent Eddie à bosser pour une chouette entreprise dont ils sont les avocats et de laquelle ils sont d’importants actionnaires, United Fruit. Ces charmants messieurs feront l’objet d’un chapitre rien que pour eux, donc je ne m’étendrai pas trop sur les grandes oeuvres de leur charmante bizness. Toujours est-il qu’ils avaient beaucoup de bananes à vendre, que c’est la puissance de leur compagnie (et son obsession de la banane) qui a engendré l’expression « république de banane », et que Edward Bernays n’avait évidemment pas un immense défi devant lui lorsqu’on lui a demandé de vendre des bananes à l’inconscient du soi consommateur des occidentaux. Think big.
Au plan de la politique extérieure, on ne fait pas d’omelette au bacon sans casser des couilles. Ça n’a pas toujours été sur des roulettes pour nos amis Dulles. Je n’évoquerai ici que le cas Arbenz, qui a fait date, parce que la chose fait partie des chefs-d’oeuvre de Bernays. Le plan monté pour cette opération a servi souvent par la suite et sert encore aujourd’hui. Je dirais même qu’il sera employé jusqu’à la fin des temps, si par malheur, on se rendait jusque là.

Le colonel Jacobo Arbez Guzman est élu président du Guatemala en 1950. C’est un modéré pragmatique, soucieux de développer le potentiel économique de son pays et d’en améliorer les conditions. Pour faire une histoire courte, Arbenz a l’idée d’acheter à United Fruit les énormes terres non cultivées que celle-ci possède au pays. Devant le refus du géant américain, une loi est promulguée, permettant aux paysans de faire l’acquisition des terres laissées à l’abandon par les grandes sociétés agricoles. Le problème est que la United Fruit a absolument besoin de ces terres pour s’assurer le contrôle de la production et éviter toute concurrence, ce qui lui permet de fixer les prix. Que les paysans crèvent de faim en regardant des champs où rien n’est planté ne fait pas partie de l’équation. United Fruit et Wall Street d’un côté, et le peuple du Guatemala et son gouvernement de l’autre, sont désormais à couteaux tirés. Mais l’empire du fruit possède une arme de persuasion massive.
Bernays est chargé d’une campagne de salissage dans les médias américains au cours de laquelle le gouvernement guatemaltèque est qualifié de communiste et ses mesures en faveur des paysans sont montrées comme autant de preuves de la terrible influence de l’ogre soviétique, en pleine sphère d’influence états-unienne, dans la propre cour de l’Oncle Sam (le terme bidonnant backyard).
Le public lui-même finit par réclamer une intervention et l’armée Impérialiste arme et organise un coup d’état en 1954. Les fils de presse occidentaux annoncent triomphalement la bonne nouvelle de la libération du pays. Ces textes sortent directement du bureau d’Edward Bernays, renseigné heure après heure par son réseau d’espions et d’agents, mi-United Fruit, mi-CIA, infestant la capitale Guatemala Ciudad.
Une junte militaire remplace le gouvernement démocratique, qui règne depuis sur le pays, en collaboration harmonieuse avec United Fruit et ses subséquentes incarnations, qui a repris tous ses droits. Il a malheureusement fallu exécuter, violer, torturer et emprisonner quelques centaines de milliers de personnes, mais c’est le prix à payer pour vivre dans un monde libre et sécuritaire.
Petit sous produit rigolo et inattendu de ce coup d’état, un jeune homme séjournait chez des potes au moment de la prise de la capitale. Ce jeune médecin beatnik, jusqu’à ce jour plutôt buveur, coureur de jupons et ennuyé par la politique, a été tellement sidéré par les évenements que sa vie a changé radicalement par la suite. Il s’appelait Ernesto Guevara Lynch de la Cerna.
À la fin des années 40, l'armée américaine fabriquait des bombes. Beaucoup de bombes. Nucléaires. Un des sous-produits de cette industrie, le fluorure, était un violent poison. Ça coûtait cher de s'en débarrasser. En prévision des éventuelles poursuites que les victimes inévitables de ce fléau risquaient d'entreprendre, on commanda des études cuisinées destinées à faire croire que ce déchet toxique était une panacée... Bernays bossait sur le coup, et comme ses petits instituts dentaires étaient déjà en place, les mêmes qui recommandaient la cigarette depuis 20 ans, on décida que cette crise de merde était bonne pour les dents et Eddie se chargea du boulot. Au lieu de dépenser des millions pour trouver une façon sécuritaire de disposer de ce caca industriel, on le VEND aux communautés, qui avec l'argent de leurs taxes, notre argent, le mélangent à l'eau potable. Montréal résiste encore, pour l'instant... Mais pas Laval, ni... Québec. Tiens, tiens, tiens... Si c'était vrai que ça rend idiot, ce truc... Ça expliquerait le but d'Alain Côté, CHOI, et la montée de Mariolinni !
Golda Meir a approché Bernays qui a ensuite pris en charge l’image publique d’Israël aux Etats-Unis. L’Inde l’a également engagé pour le même travail. Dans les deux cas, Bernays se rapportait fidèlement au Département d’État, donc à ses amis Dulles.
Bernays a vécu jusqu’à l’âge de 105 ans. Il n’a jamais aimé la cigarette et n'a jamais fumé. Au courant depuis les années 30, comme ses employeurs de l’époque, des dangers du tabac, il convainquit même sa femme de cesser de fumer. Possiblement rongé par la culpabilité, il prêta ses talents à la lutte anti-tabac dès les années soixante, proposant même des campagnes si radicales qu’elles furent rejetées par les autorités.
Partiellement conscient (un peu moins que Guy Debord, disons) des aspects néfastes du monstre qu’il avait engendré, il tenta pendant quarante ans de baliser les possibles excès de la propagande et des relations publiques, proposant des lois, des conseils, des ordres professionnels... Sans succès.
Bernays a dit :
Aucun sociologue sérieux ne croit désormais à cette idée absurde selon laquelle la voix du public représente une sorte d’idée divine, sage ou grandiose. La voix du peuple exprime la pensée du peuple et cette pensée est formée pour lui par ses meneurs et par les personnes qui comprennent la manipulation de l’opinion publique. Celle-ci est composée de préjugés traditionnels, de symboles, de clichés et de formules verbales inculqués au public par l’élite.
Dans tous les gestes de nos vies quotidiennes, que ce soit dans la sphère politique ou économique, dans notre comportement en société ou notre réflexion éthique, nous sommes dominés par un petit nombre de personnes — une fraction infime de la société — qui comprennent les processus mentaux et les cadres sociaux régissant les masses.
Il est relativement facile de faire changer les attitudes de millions de gens, alors qu’il est impossible de faire changer l’attitude d’une personne seule.
Il est plus facile de faire accepter son point de vue en citant les autorités dignes de respect, en encadrant l’angle dans lequel notre idée a germé, et en faisant référence à la tradition qu’en disant à quelqu’un qu’il se trompe.
Une phrase qui s’adresse au public ne devrait jamais compter plus de seize mots et une seule idée.
La meilleure défense contre la propagande, plus de propagande.
J’ai été choqué d’apprendre que mes livres ornaient les tablettes de la bibliothèque de Goebbels. Mais je savais que toute activité humaine peut servir des objectifs sociaux ou antisociaux. De toute évidence les attaques contre les juifs en Allemagne n’avaient rien d’une explosion émotive et tout de la campagne soigneusement et délibérément planifiée.
Je suis la victime, et non le bénéficiaire, de ma propre propagande.
L’école publique devrait former l’éducateur et lui faire réaliser que son travail comprend deux volets : l’éducation en tant que professeur, et l’éducation en tant que propagandiste.
Peut-on appeler ça le gouvernement par la propagande ? Si vous préférez, appelons cela le gouvernement par l’éducation. Cependant, l’éducation, dans le sens académique du mot, est insuffisante. Il faut une propagande experte et éclairée, à travers la création de circonstances, la mise en scène d’événements significatifs, et la dramatisation de certains sujets. L’homme d’état du futur sera ainsi capable de mobiliser la pensée du public autour de certains points politiques précis, et pourra enrégimenter une vaste étendue d’électeurs hétérogènes en leur offrant une compréhension claire de la situation, qui les mènera à des actions intelligentes.
Certains objecteront, évidemment, que la propagande finira par s’autodétruire, au moment où ses mécanismes deviendront évidents pour le public. À mon avis, non.
Chapitre 10 - Winston Churchill
 Je n’admets pas qu’on dise qu’un crime grave ait été commis contre les Peaux Rouges en Amérique ou contre les peuples Noirs d’Australie. Je n’admets pas qu’il soit considéré néfaste de traiter ces peuples comme ce fut le cas, par le fait qu’une race plus évoluée, une race d’un niveau supérieur, une race plus sage et avancée soit venue pour prendre leur place
Je n’admets pas qu’on dise qu’un crime grave ait été commis contre les Peaux Rouges en Amérique ou contre les peuples Noirs d’Australie. Je n’admets pas qu’il soit considéré néfaste de traiter ces peuples comme ce fut le cas, par le fait qu’une race plus évoluée, une race d’un niveau supérieur, une race plus sage et avancée soit venue pour prendre leur place
L’Histoire sera tendre à mon égard, parce que c’est moi qui l’écrirai
L’objectif de la Seconde Guerre Mondiale était de ressusciter le statut de l’Homme
Image de bon papa potache
Sir Winston Leonard Spencer-Churchill ! Comme beaucoup de gens de ma génération, j’ai été élevé dans une moite admiration de cet homme d’état qu’on m’a présenté, tant à l’école que dans la culture populaire, comme une sorte de héros bênet, homme du peuple à la bonne bouille, oncle ventru blindé de gros bon sens, et surtout, ennemi juré du fascisme et vainqueur triomphant des forces du mal au cours des deux premières guerres mondiales. Comme moi, le bon Winston aimait les havanes, le whisky, et les fins mots : « Une pomme par jour éloigne le médecin ; lorsqu’on sait viser ».
La réalité, une fois dégagée de la sauce PR qui la nappe des graisses onctueuses de l’hagiographie sportive (la vie des champions), est quelque peu plus prosaïque. Je dois tout spécialement remercier Daniel Yergin pour les mensonges et omissions qu’il a a publiés sur le sujet, puisqu’en peignant une carte aussi précisément erronée du territoire, il m’a presque permis par inversion de recomposer une fresque plus buvable de l’histoire du pétrole, et donc, spécifiquement, une image plus claire d’un de ses plus importants valets, le bon messieurs Winston.
Primo, abandonnons tout de suite cette notion de Churchill l’homme du peuple. Je n’ai aucune idée du genre de moquette que les élaborateurs de notre système d’éducation avaient fumé en nous jetant cette blague, mais il a toujours été clair de son vivant que Winston Churchill était un aristocrate, membre d’une grande famille de nobles anglais, de la maison des Marlborough. Son papa Lord Randolph Churchill était politicien lui aussi et son grand-papa était nul autre que le Duc de Marlborough. Sa maman, Jennie Jérôme, était la fille du millionnaire Leonard Jérôme, surnommé le Roi de Wall Street. Il devait sa fortune à la spéculation et aux chemins de fer. On ne servait sans doute pas de sandwiches au beurre de pinotte pendant les partys de noël.
Ludwig, Alfred, Robert, Alphonse et Edmond ; Histoire grossièrement accélérée du Pétrole British
En mars 1873, Robert Nobel arrive à Baku et y fonde littéralement l’industrie pétrolière Russe. Son frère Ludwig possède une gigantesque entreprise de munitions, tandis que l’autre frangin Alfred dirige l’empire florissant de la dynamite, invention de leur célèbre papa venu de Suède pour armer le Tsar. À l’époque, le pétrole sert essentiellement à l’éclairage et est vendu sous forme de kérosène. Les habiles frères Nobel rivalisent très vite avec le gigantesque monopole états-unien de Standard Oil, la compagnie de Rockefeller. En dix ans, ils parviennent même à le surpasser et au cours des années 80 (pas celles de Thompson Twins, mais celles de Franz Liszt), sont assez puissants pour se frotter à Standard dans une guerre de prix. En 1884, la production pétrolière de Baku atteint les 11 millions de barils. Une des banques faisant partie du consortium Nobel est le Crédit Lyonnais. D’autres Français vont également se joindre à l’aventure.
La branche parisienne de la banque des Rothschild érige une immense raffinerie à... Fiume (!) sur l’Adriatique. Ce sont eux qui vont construire le chemin de fer reliant Baku à la Mer Noire, en échange de quoi ils reçoivent des concessions pétrolières russes. Leur entreprise, Bnito, et celle des Nobel, vont rapidement développer une fructueuse collaboration et transformer la ville de Batum sur la mer Noire en métropole pétrolière.
Les Rothschild, accessoirement, sont d’origine juive, et c’est autour de 1882, au moment même où ils arrivent sur place, que commencent les grandes manifestations antisémites dans le Sud-Ouest de la Russie. Aucun historien n’a jamais cru bon de faire le lien entre les pratiques habituelles de Standard Oil, l’antisémitisme de son propriétaire Rockefeller, et l’apparition des pogroms dans le Caucase, au moment précis où une pétrolière concurrente y prolifère, propriété de banquiers juifs. À mon avis, quand ça a l’air d’un rat, que ça sent le rat, que ça goûte le rat et que c’est écrit “rat” sur l’emballage, il y a de bonnes chances pour que ça soit Rockefeller.
Au moment où le chemin de fer Baku Batum est complété, en 1886, la domination outrancière mondiale de Standard Oil est officiellement terminée, et l’ère des véritables hostilités commence. Les installations du consortium sont constamment la cible de saboteurs « antisémites », qui vont même jusqu’à incendier et dynamiter (ô ironie) les puits de pétrole.
En 1888, Ludwig Nobel meurt d’une crise cardiaque au beau milieu de ses vacances sur la Côte d’Azur. Les journaux comprennent par erreur qu'il s'agit d'Alfred et font l’annonce de son décès. Cela donne lieu à un déchaînement d’articles négatifs sur cette industrie de mort que celle de la dynamite. C’est en lisant ces papiers qu’Alfred Nobel, sain et sauf, mais écorché par tant de haine, décide d’injecter un grande part de sa fortune dans la création des Prix portant son nom, espérant laisser une image plus noble et dynamique que celle de Nobel le dynamiteur.
Après quelques passionnantes péripéties, acquisitions, fusions et combinaisons, le consortium des Nobels-Rothschilds finit par porter deux noms, Royal Dutch Shell d’un côté et Anglo-Persian de l’autre. Ce sont deux compagnies « concurrentes », mais comme Standard New Jersey et Standard Indiana, elles sont contrôlées par les mêmes actionnaires majoritaires, les Rockefeller dans le cas de Standard, les Rothschild dans le cas de Shell, Royal Dutch, Anglo-Persian, British Petroleum (étonnamment propriété de la Reichbank allemande, elle-même contrôlée par les Rothschild germaniques, puis achetée par Anglo-Persian au moment où le gouvernement britannique en fait l’acquisition partielle), Bnito et caetera. Ce sont eux, les Rothschild, qui vont réellement mettre Winston Churchill au monde et l’employer tout au long de la première moitié du siècle pour faire avancer la cause du pétrole, donc pour déposer des sous dans leurs caisses.
Formation du petit Winston
En sortant du collège militaire de Sandhurst, Winston reçoit une commission de second lieutenant des Hussards de la Reine. Il devient correspondant de guerre au cours de ses campagnes et commence ainsi une longue et fougueuse carrière littéraire. Évidemment, l’objectivité des reportages d’un journaliste impliqué personnellement dans les combats pourrait être compromise, mais la grande tradition de justice et de grandeur d’âme des soldats de Sa Majesté nous interdit de soupçonner le moindre biais. Les historiens aiment prétendre que c’est par manque d’argent que Churchill se lance dans cette activité et ça, c’est quand même pas mal rigolo. Cherchons peut-être plutôt du côté de l’ambition politique.
Malgré sa haute naissance, Winston Churchill exige d’être déployé au front, et ça, c’est vrai. Cependant, comme l’a démontré Lord Dedes à la Société Royale d’Histoire, ce n’était pas vraiment par héroïsme, mais surtout en raison du fait que l’alcool était permis dans les zones de combat, alors que l’arrière était maintenu au sec. Personnellement, j’aurais fait pareil.
Passion Naissante pour l’Etripage
En 1895, Churchill se rend à Cuba comme observateur du Daily Graphic pour y décrire la guerre révolutionnaire cubaine. Il se présente comme un ardent défenseur des droits coloniaux Espagnols, notant au passage que sous l'héritage gauchiste de Jose Marti, la révolution cubaine est constituée aux deux tiers d'esclaves libérés, combattant aux côtés des blancs. Il dit craindre la naissance d'une seconde république Noire (après Haïti). Les Cubains vont effectivement vaincre l'Espagne, finalement, mais les États-Unis occuperont l'ïle aussitôt et s'empresseront de remettre leurs chaînes aux combattants noirs. Ouf ! La civilisation l'a échappé belle, encore une fois. Note amusante, c'est à cette époque que les États-Uniens installent leur fameuse base navale de Guantanamo à l'extrême Est de l'île.
Winston est ensuite transféré à Bombay, en Inde, où il devient un des meilleurs joueurs de polo de tout son régiment. Il entend parler d’une bonne bagarre en Grèce et décide de s’y rendre, mais l’armistice est signée avant son arrivée. Qu’à cela ne tienne, trois brigades Britanniques se préparent à aller bouffer du Pashtoune au Pakistan. Il se joint à eux et bing et bang, Winston écrit de jolis articles.
Et hop, au Soudan en 1898 pour participer à la dernière grande charge de la cavalerie britannique à la bataille d’Omdurman. Le courage et la ténacité des troupes impériales aura raison de la paresseuse traîtrise et de la faiblesse de caractère des fourbes Arabes d’Abdullah al-Taashi. En plus de leur supériorité morale et de la grandeur de leurs objectifs civilisateurs, les britanniques profitent d’un léger avantage technique sur leurs adversaires, l’usage de l’artillerie et de la mitrailleuse, contre un ennemi surtout armé de lances et de pétoires. La majorité des sauvages est écrabouillée d’une distance de 3 kilomètres par la flotte postée au milieu du Nil. Les quelques survivants ont malgré tout le panache de se laisser déchiqueter par les mitrailleuses Maxim, mais aucun ne se rend suffisamment près des Anglais pour faire usage de sa lance ou de sa grossière arme à feu. Le nom du glorieux général Britannique sera adoubé d’honneurs et on renomme même une ville canadienne en souvenir de ses exploits : Kitchener. La petite bourgade Ontarienne s’appelait jusque-là... Berlin ! Winston Churchill publie un livre racontant cette passionnante campagne soudanaise, intitulé The River War. « L’Histoire de l’humanité, c’est la guerre »
Winnie Tenté par le Pouvoir Civil
En 1899, après une première tentative électorale infructueuse, il retrouve son bon ami Kitchener et son cousin le Duc de Marlborough en Afrique du Sud où les blancs s’entretuent pour savoir qui aura le droit de régner sur la terre des Africains. Fait prisonnier, il parvient à s’évader, publie le récit de ses aventures et devient enfin célèbre. Les camps de concentration dans lesquels les britanniques enferment les paysans Boers resteront, eux-aussi, célèbres, mais tristement. Winston Churchill publie deux livres sur cette guerre, London to Ladysmith via Pretoria et Ian Hamilton’s March. Le but est atteint, il parvient à se faire élire au parlement en 1900. Plutôt que de siéger en chambre, Churchill part en tournée de conférences et réussit à se faire un petit pactole de dix mille livres, histoire de traire la vache de ses exploits militaires. En dollars de 2007, ce montant équivaut à près de 3 millions.
Churchill change quelque fois d’allégeance, au cours de sa carrière politique, passant des Conservateurs aux Libéraux, puis allant siéger comme indépendant avant de retourner chez les Tories. Quoi qu’il en soit, il monte rapidement en grade dans les gouvernements successifs de ces années agitées. Une chose est claire, cependant, Winston Churchill est et restera pour toujours, à compter des années 10, l’ami intime, fidèle et indéfectible... du pétrole.
Il devient en 1905 le sous-secrétaire d’État aux colonies. C’est en cette qualité qu’il imposera sa constitution à l’Afrique du Sud (vaincue) et qu’il s’occupera de la question des esclaves chinois dans les mines d’Afrique Australe. Churchill devient au cours de ces années un des premiers et des plus forts partisans du libre échange.
En 1910, Winston devient Ministre de l’Intérieur (Home Secretary), ce qui constitue une sacrée promotion. Au cours de son mandat, il se fera remarquer entre autres par son idée de faire intervenir l’armée contre des révolutionnaires anarchistes lors du Siège de la rue Sidney. Il interdit ensuite aux pompiers d’éteindre l’incendie faisant rage dans les bâtiments, et l’affaire se termine en méchoui à la Waco Texas. La même année, Churchill fait encore déployer les militaires (contrairement à ce que prétend l’article confus de Wikipedia) contre des mineurs grévistes à Tonypandy.
Récompensé pour sa poigne de fer, Churchill est bombardé Premier Seigneur de l’Amirauté en 1911. Dans un empire maritime comme celui du Royaume-Uni, ce poste est d’une importance énorme. Une fois en place, Churchill ne perdra pas de temps à accomplir son boulot de valet du pétrole. Il propose une série de réformes et de modernisations, préconise le développement de l’aviation, des blindés, etc. Principalement, il force la Marine de Sa Majesté, le symbole et l’incarnation même de la puissance impériale britannique, à changer les systèmes de propulsion de la flotte du charbon vers le pétrole. Initialement, l’idée est reçue comme une imbécilité de premier ordre, puisque l’île Britannique regorge de charbon, alors qu’on y a pas encore trouvé une seule goutte de pétrole. Cependant, Churchill et ses amis de Shell et d’Anglo-Persian vont réussir à convaincre tout le monde que les ressources pétrolières ne manqueront pas. À cet effet, des effectifs de l’armée sont dépêchés en Perse, où des champs de pétrole immenses sont en voie d’être mis en production. La suite prouvera que cette tranformation était plus qu’hasardeuse et ses conséquences presque fatales pour la souveraineté anglaise. Mais comme la couronne profitera économiquement dès le début de l’exploitation pétrolière et que la fortune royale demeure jusqu’à aujourd’hui intimement liée à ces ressources et à leur exploitation, tout s’explique.
Les Allemands aussi, passent au pétrole ! Ça y est, amis banquiers ! La marine britannique et sa contrepartie allemande se lancent dans la première vraie course à l’armement de l’ère moderne. Les journaux sont mis à contribution et tapissent leurs pages des exploits de l’adversaire, exagérant la force ennemie, comme ça se produira ensuite tout au long du siècle. Quoi qu’il en soit, l’idée est que l’argent passe de la poche des gens aux coffres des industriels, et à compter de 1911, dans les voutes des pétrolières. Selon Churchill, la joute pour l'Or Noir a comme enjeu la prévalence sur l’échiquier mondial : « La domination représente le butin de l’aventure. »
Daniel Yergin s’extasie, dans The Prize : « Au cours de la première grande guerre, le pétrole et le moteur à combustion allaient changer toutes les dimensions de la guerre, jusqu’à la notion même de mobilité sur terre, sur mer et dans le ciel. »
La Route des Grands Massacres
Le Kaiser Wilhelm a lui aussi le pétrole Perse en vue, et il construit depuis quelques années une ligne de chemin de fer destinée à relier Berlin (l’Allemande, pas la Canadienne) et Bassorah, dans ce qu’on appelle aujourd’hui l’Irak, ou... le Merdier. Cette même ligne doit en principe être connectée également aux ressources immenses de la mer Caspienne, à la suite d’une entente avec le Tsar Nicolas, qui voit d’un très bon œil l’idée de se voir relié à la grande et moderne Europe, riche de capitaux. C’est donc un peu beaucoup pour couper l’herbe sous le pied du Kaiser que la première guerre mondiale est déclenchée, quelques mois avant la complétion de la ligne de chemin de fer.
— Quoi ? C'est pas parce qu'un anarchiste des Balkans a tué le Duc Franz Ferdinand et que par le jeu inextricable des alliances toute l'Europe a été forcée d'entrer en conflit ?
Euh... ben... C'est fort plausible. Une autre explication assez solide implique un complot entre les habitants de l'univers Dgszub-25 et les Soldats-lutins du Royaume des Esprits, ceux qui dansent dans la cafetière, les vendredis 13. Tout ça reste mystérieux.
Churchill est aux premières loges de la course aux armements entre l’Allemagne du Kaiser Willhelm et l’Angleterre. Le premier ministre de l’époque le décrit comme « cherchant la bagarre, belliqueux, portant constamment ses peintures de guerre. » Dès le déclenchement des hostilités, et au mépris de la loi britannique et des conventions de l’époque, il met en place un blocus alimentaire, minant les ports, faisant classer les denrées et la nourriture comme « articles de contrebande ». 750 000 Allemands meurent de malnutrition durant le conflit. Les survivants ont une petite dent contre l’Angleterre, disons.
Une semaine avant l’attaque meurtrière du Lusitania, Churchill écrivait dans une lettre à Walter Runciman, le président du Conseil du Commerce : « il est impératif d’attirer des navires neutres près de nos rivages, dans l’espoir spécifique d’entortiller les États-Unis dans la guerre contre l’Allemagne. »
En 1915, une des premières grandes missions à tomber sous sa gouverne, le débarquement de Gallipoli, dans les Dardanelles, tournera au cauchemar et reste encore aujourd’hui un des pires désastres de l’histoire militaire. Du côté franco-britannique, les pertes sont évaluées à 252 000 morts ! Oui, vous avez bien lu, un quart de million de cadavres. Pour la marine, c’est un désastre encore plus épouvantable (l'acier vaut plus cher que le cartilage) avec six vaisseaux de guerre détruits, trois endommagés, un croiseur hors d'état, un destroyer coulé et huit sous-marins perdus. Sir Winston sera plus ou moins forcé à prendre la porte à la suite de cette campagne funeste. Tout en restant député, il va purger sa honte en rejoignant les troupes cantonnées sur le front Ouest en tant que Commandant du 6e bataillon des Fusilliers Écossais. Son second durant cette campagne est Archibald Sinclair, qui deviendra plus tard le chef du parti Libéral anglais.
Balles, Obus, Explosifs !
Les chats ont neuf vies, mais les aristocrates sont éternels. C’est en 1917 que Winston Churchill est rappelé au pouvoir. Il devient Ministre des Munitions, poste logique pour un petit-fils de Wall Street, puisque c’est la Rue du Mur qui contrôle presque 100% de la production de l’armement mondial de l’époque, comme le lecteur attentif (et la lectrice aussi, bien sûr !) l’a vu dans les chapitres précédents. La guerre se termine à peine que Churchill est nommé Secrétaire de la Guerre, ainsi que Secrétaire de l’Aviation. C’est donc lui qui commandera la partie Britannique de l’agression alliée contre la jeune République Socialiste Soviétique de Russie. Churchill est un des plus forts partisans de l’intervention et déclare que le Bolchévisme doit être « écrasé au berceau ». Cependant, malgré ces dures paroles, ladite intervention sera menée très, très, très mollement. Pourquoi ? On y reviendra, à cette prétendue révolution bolchévique. Que la lectrice (et son fiancé !) se contentent pour l’instant d’apprendre avec stupeur que dès 1918, les livraisons de pétrole Russe reprennent vers l’empire Britannique.
Churchill devient le Secrétaire d’État pour les Colonies en 1921 et fait partie des signataires du traité Anglo-Irlandais. C’est donc sous son égide que se crée l’Ulster, cette partie du Nord de l’Irlande qui devient une simple province du Royaume... Uni. Il s’avère que la partie industrialisée et riche de l’Irlande s’y trouve. Cette idée de la partition de l’Irlande, comme on l’a vu au cours du Mauvais Siècle, était particulièrement juste, avisée et efficace ! Peut-être pas autant que la campagne des Dardannelles, mais tout juste. Encore aujourd’hui, personne ne sait véritablement comment résoudre cet inextricable nœud de souffrances et d'horreurs.
C’est en sa qualité de Président du Conseil de l’Aviation que Sir Winston Churchill propose dans les années 20 l’utilisation des gaz toxiques contre les populations tribales Arabes et Kurdes des régions qui allaient s’appeler bientôt... L’Irak. C'est une région névralgique dans le développement de la production pétrolière et ses potes de Shell y ont un monopole. « Je suis fortement en faveur de l’emploi des gaz toxiques contre les tribus non-civilisées... dans le but de semer une vive terreur ». My name is Churchill. Sir Saddam Churchill. En fait, comme les tacticiens allemands du Troisième Reich et les états majors États-Uniens de toutes les époques depuis, Sir Winston Hussein avait un goût prononcé pour les bombardements aériens. Surtout pour protéger des derricks !
C’est sous sa gouverne que furent établies les dynasties des Faisal en Irak et des Abdullah en Jordanie. Il s’agit essentiellement de régimes guignols censés approuver les activités des pétrolières britanniques sur leurs territoires, sourire pour la photo, et tenir de temps à autres des propos terribles contre l’occident, le capitalisme, ou le chewing-gum.
En 1923, Shell propose à Churchill un petit boulot de lobbyiste. Leur projet ? Racheter la partie gouvernementale d’Anglo-Persian. Ça tombe bien pour le petit Winston, qui vient de se faire mettre à la porte du parlement et se cherche du boulot, n’importe quoi pour déjouer l'inéluctable mendicité ! Il promet publiquement à sa femme, la gorge serrée : « Je ne nous laisserai pas crever de faim ». Par Vishnu, ces moments émouvants de l’Histoire peuvent parfois m’émouvoir tellement que j’en suis tout ému. Winston avait réussi au cours de la décennie précédente à faire acheter des millions de barils de pétrole par l’armée, la marine et l’aviation de Sa Majesté. Il était également parvenu à faire investir par le parlement les sous de la Couronne, à même les impôts et le trésor public, dans une compagnie dont les profits et le contrôle revenait à une banque privée. Tout ça, Winston l’avait fait par amour ! Par amour du pétrole, suivant de sincères élans de tendresse pour cette industrie, pour sa substance si limpide, si humaine, si touchante ! C’est pourquoi lorsque ses amis de Shell lui offrent un boulot de consultant, en cette année tranquille de 1923, il se contente d’une somme symbolique pour ses heures, la dérisoire pitance de... 50 000 livres sterling (8 millions de dollars d’aujourd’hui). Robert Cohen, un des dirigeants de Shell déclare : « On ne pouvait pas tellement discuter son prix ». Ah bon ? Encore un de ces impénétrables mystères...
 Chancelier du Trésor Public
Chancelier du Trésor Public
Tous ces désastres mènent Winston Churchill à perdre plusieurs élections consécutives. Qu’à celà ne tienne ! Nommé ministre des finances en 1924 sous le premier ministre Stanley Baldwin, il pousse l’établissement de l’étalon Or, ce qui précipite le pays dans une récession, cause une vague de chômage sans précédent et entraine une épidémie de conflits de travail. Sir Winston fait vraiment chanceler le trésor public ! Churchill avouera plus tard qu’il s’agissait de la pire erreur de sa vie, déclarant candidement ne rien connaître à l’économie, et s’être fié aux bons conseils de son ami le gouverneur de la Banque d’Angleterre, le milliardaire Montagu Norman. En 1926, l’Angleterre fait face à une grève générale.
Il a la particularité d’être l’ami intime du banquier allemand Hjalmar Schacht. Il sera aussi le directeur de la Banque des Règlements Internationaux, la banque fédérale des banques fédérales, qui sera créée en 1930 pour répartir le pillage des ressources allemandes organisé sous le Traité de Versailles. C’est à ce titre qu’en 1939, Montagu vole 6 millions de livres aux Tchécoslovaques et remet la somme à ses potes de la Reichsbank. On multiplie par 42.51 pour avoir le chiffre en livres d’aujourd’hui ? Ça fait 255 million de livres, un joli milliard de dollars. L’Allemagne avait besoin de liquide, en 1939. Les détails de cette épouvantable crosse ne sont pas encore éclaircis.
Norman, qui travaillait beaucoup, sera également un des fondateurs et principaux promoteurs de la très oubliée Fraternité Anglo-Allemande (Anglo-German Fellowship), établie à Londres sous les auspices de Ernest Tennant et de Joachim von Ribbentrop en 1935, deux ans après l’arrivée d’Hitler. Cette organisation, dont de très importants personnages de la société anglaise et allemande feront partie (ministres, généraux, amiraux, banquiers, etc.), se déclarait ouvertement fasciste et pro-nazie.
La Grande Rigolade des Années Folles
Revenons à notre cher Winston, aux prises avec une grève générale. Il déclare en 1926 : « ou bien le pays brise cette grève générale, ou c’est la grève qui brisera le pays. » C’est pourquoi Sir Winston préconise dès lors l’utilisation des mitrailleuses pour convaincre les grévistes de retourner au boulot. Après tout, ça avait bien si bien fonctionné au Soudan. Cette même année, Winston Churchill confie que « le fascisme de Benito Mussolini a rendu service au monde entier, en montrant la façon de combattre les forces subversives ». Il ajoute plus tard au sujet du gros Duce : « c’est un génie Romain, le plus grand législateur d’entre les hommes ».
C’est en 1928 que Churchill pilote finalement cette fusion des pétrolières Anglo-Persian et Shell, ce qui mène à la création d’un nouveau monopole de facto, lorsqu’à Achnacarry en Écosse, les petits amis de Standard Oil sont invités à se joindre à la danse. Le prix du baril monte !
En 1929, Sir Winston se fâche avec les Conservateurs, qui proposent une légère ouverture face aux revendications de l’Inde. Il s’éloigne alors de toute la classe politique anglaise, mais se rapproche d’autant de la petite clique des barons de la presse, des banquiers et du monde de la finance. Il se consacre en même temps à l’écriture et publie entre autres en 1932 un recueil d’essais intitulé Pensées et Aventures (Thoughts and Adventures) dans lequel il propose d’abandonner le suffrage universel. Il demeure un grand admirateur de Mussolini jusqu’à la fin des années 30.
En 1935, Winston Churchill mène l’opposition contre l’octroi à l’Inde de sa souveraineté. Il dit alors de Ghandi que « ce fakir à demi-nu mériterait d’être étendu pieds et poings liés aux portes de Delhi et écrabouillé par un énorme éléphant monté par le Viceroy ». Il fonde la Ligue de Défense de l’Inde, dont le projet est d’empêcher son accession à la souveraineté.
Churchill a longtemps été une des seules voix à craindre la montée d’Adolf Hitler. Le fait que ses grands amis aient été au même moment en pleine campagne de financement de l’effort de guerre allemand diminue peut-être un peu le panache à posteriori de ses qualités de visionnaire.
Lorsqu’éclate la seconde guerre, Winston Churchill est de nouveau désigné Premier Seigneur de l’Amirauté, ainsi que membre du cabinet de guerre. L'Allemagne nazie vient d'envahir la Pologne ! Un allié Britannique ! Winston propose immédiatement d’intervenir avec vigueur avec une invasion de... la Norvège et de la Suède ! Le premier ministre Chamberlain s’y oppose, ainsi que tout le reste du cabinet. Churchill décide d’attendre l’invasion Allemande pour procéder et l’opération, une fois mise en route, est un retentissant désastre qui coûte son poste à... Chamberlain !... Ce sont les scandinaves qui jubilent ! Occupés par le Reich au Sud et agressés par l’Empire de Sa Majesté au Nord. Ce petit détail est parti tout au fond de la trappe à gras du restaurant de l’Histoire, mais je vous en fais cadeau aujourd'hui, parce que je vous aime.
Quant à la Pologne, elle, il lui faudra attendre 1944 pour recevoir « l’aide » (sous la forme bénigne de 40 ans d'occupation totalitaire) que les fameux traités internationaux lui garantissaient et en vertu desquels tout le monde et son canari entre en guerre en septembre 1939. Pendant que l’Angleterre envahit foireusement les innocents scandinaves, la nation polonaise sera divisée en deux, l’Ouest à l’Allemagne et l’Est aux Soviétiques.
Trois mois avant le début de la guerre, Franklin Delano Roosevelt, le président des États-Unis, promet au Roi Georges VI de constituer un blocus naval de l’Atlantique et de s’employer à créer un incident maritime dont il ne resterait plus qu’à attendre les conséquences. Puis, disjonctant toutes les voies de communication normales, dès la nomination de Churchill à la tête de la marine, le même FDR entreprend avec lui une active correspondance, gardée secrète même du cabinet et du premier ministre britannique. Puis il assigne un certain Averell Harriman à titre d’envoyé personnel auprès de Churchill, qui à l’époque n’est pas encore Premier Ministre, mais bien simple Lord de l’Amirauté. Certains messages font référence à une promesse d’intervention États-Unienne donnée par FDR avant même le début du conflit, ce qui contredit toutes les versions officielles et laisse supposer une sorte de danse chorégraphiée par tous les partis impliqués. Si on se rappelle que les banquiers supportant les deux leaders sont les mêmes qui ont monté la machine de guerre nazie (et la soviétique), il devient pratiquement évident que le monde s’est fait arnaquer de quelques trillions de dollars et de 54 millions de vies humaines.
Totalement dépassé par les évènements, Chamberlain, qui avait toujours cru dans la bonne foi d’Hitler (!) et avait cédé devant toutes ses exigences, caprices et gémissements... est forcé de démissionner. Le bon Roi George VI demande à Winston Churchill d’accepter le rôle de premier ministre. Il jouera parfaitement son personnage de celui qui ne cèdera jamais et les Britanniques s’identifieront à sa résolution et à sa détermination.
Tout de suite après un des tout premiers bombardements allemands contre Londres, alors que la capitale est à feu et à sang, le directeur de la boutique de cigares Dunhill téléphone d'urgence à Churchill pour lui annoncer que son stock de Hoyo Monterey Double Corona est sain et sauf.
Roosevelt et Churchill se rencontrent en août 1941 pour la conférence Atlantique. Les deux leaders y discutent avec légereté des beaux grands principes d'autodétermination de tous les peuples de la Terre. Ils avaient manifestement bu. Peu importe ces balivernes, l'essentiel est que la guerre se poursuive. Sir Winston déclare ensuite à son cabinet que « le président a promis de se lancer en guerre sans déclaration et qu’il augmenterait sans cesse le niveau de provocation. Si les Allemands n’aiment pas ça, ils n’auront qu’à attaquer les forces américaines. Tout sera fait pour créer un incident. »
Ce sont par contre finalement les Japonais qui lui permettront de fanfaronner, en attaquant Pearl Harbor. « Nous venons de gagner la guerre », s’esclaffe-t-il, vraisemblablement éploré par la tragédie.
Petits Crimes de Guerre entre Amis
Churchill a la main heureuse en finançant les activités subversives des partisans et des résistants dans les territoires occupés par le Reich et en créant des unités de commandos, sur lesquels sont calquées les Forces Spéciales d’aujourd’hui. Il est à noter que de nombreux éléments des unités de résistants ont été dénoncés et assassinés par les Allemands juste avant l’arrivée des forces Alliées. Certains autres, comme les partisans helléniques ont carrément été écrasés ensuite par les forces britanniques, aidés par 400 millions de dollars d'aide États-Unienne (10,772,000,000 U$D de 2006). Une dictature militaire d'extrême-droite est établie en Grèce et les milices qui avaient lutté contre les nazis sont écrabouillées, dispersées, emprisonnées. En France, les leaders les plus à gauche de la résistance sont trahis et presque tous liquidés par la Gestapo avant le jour J.
Churchill participe aux négociations de partage du butin nazi en compagnie de Franklin Delano Roosevelt et de Staline, qui se réunissent deux fois à Québec et une à Yalta. Je n'ai jamais visité Yalta, mais si je me fie à ce que je connais de Québec, le Monde avait de quoi trembler. Heureusement, par contre, il semblerait que la municipalité n'avait pas encore fluoré son eau et qu'en fait, avant le but refusé à Alain Côté, Québec ait été une ville normale, entièrement peuplée d'habitants sympathiques.
Les trois grandes marionnettes vont donc négocier le bout de gras comme s’il s’agissait du résultat d’un vol de banque, se disputant les « pourcentages d’intérêt ». L’ambassadeur États-Unien en URSS de l’époque s’appelait Averell Harriman (oui, encore lui !). C’est Churchill qui proposera les immenses déportations comme solutions aux problèmes ethniques causés par les frontières redéfinies des pays de l'Est. Les déplacements de 15 millions de personnes d’origine germanique par l’URSS de Staline causeront en définitive un peu plus de deux millions de morts. Sir Winston s’oppose aussi à l’annexion de la Pologne par Staline, mais il ne fera rien pour l’empêcher.
À Québec en 1944, les Alliés s’entendent pour ce qu’on appelle le Plan Morgenthau, c’est-à-dire le projet de destruction de l’Allemagne après sa reddition. Le plan prévoit la division de l’Allemagne en trois zones, Nord, Sud et ‘internationale’. De plus, la Saar serait rattachée à la France, la Silésie du Nord à la Pologne et la Prusse Orientale à l’URSS. Toutes les industries seraient démantelées et les équipements divisés entre les alliés victorieux. Les restes de cette grande nation seraient maintenus pour toujours en une vaste plaine agricole et pastorale. On prévoit également larguer des super-bombes à l’anthrax sur les six principales villes, ce qui devrait, selon le plan, entraîner la mort immédiate par inhalation de plusieurs millions de citoyens, suivie par la lente agonie de millions d’autres.
Le plan Morgenthau, « ultra-secret », est coulé aux médias et Joseph Goebbels ne manque pas de le diffuser et de s’en servir dans les derniers mois de la guerre, pour empêcher tout mouvement de reddition. Il est évident que le but du projet Morgenthau est d’allonger la guerre le plus longtemps possible. Un autre point en faveur de cet argument est l’incroyable histoire de ce général génial George Patton, que les Allemands craignent comme la peste. On lui retire son commandement pendant la campagne d’Italie, parce qu’il a dépassé plusieurs fois les objectifs fixés sans s’arrêter lorsqu’on le lui ordonnait. La raison invoquée ? Il a gifflé un soldat pour couardise. Patton passe ensuite une bonne année à se tourner les pouces dans un camp d’entraînement en Angleterre (!). Bradley, son ancien protégé devenu général en chef du front Ouest, le ramène au front, tout empêtré qu’il est en Normandie. On dit à Patton que c’est sa grande gueule qui pose problème et on lui fait promettre de la boucler. Ce dingue fonce alors dans le front Allemand comme un piranha dans un jeu de quilles et le découpe en frisettes à une vitesse ahurissante, démontrant une capacité presque surnaturelle à trouver les points faibles de l’ennemi. Le commandement Allié, alarmé par son avancée trop rapide, encore une fois, lui ordonne de s’arrêter pour attendre Montgomery (un autre favori des historiens blaireaux comme Yergin) et les autres corps d’armée qui rampent comme des limaces. Patton, tout passionné par son travail, est parti pour Berlin ! On lui coupe les vivres. Le diable attaque les raffineries nazies et s’empare du pétrole qui lui manque pour poursuivre son avancée. Finalement, c’est Bradley lui-même qui doit aller le prévenir que s’il ne s’arrête pas, sa carrière est terminée. Patton comprend que la guerre doit s’étirer le plus longtemps possible, il se calme. On l'envoie même se faire tuer dans les Ardennes où les nouveaux tanks General Motors des Allemands dépècent le 101e para, autre unité en punition. Patton surprend tout le monde et casse le front ! Il fout aux Allemands de leur propre recette à la gueule et les taillade au blitzkrieg. Ça saigne ! Patton adore ! Là c'est reparti, on file à Berlin pour vrai, y a plus d'orchestre, plus de théâtre, plus de rue, rien. Patton va encore ouvrir sa gueule une dernière fois en 1945, suggérant aux journalistes que l'armée États-Unienne devrait enfoncer tout de suite la Russie, tandis qu'elle possède l'avantage du bombardement atomique.
Gros Crimes de Guerre bien Coûteux/Payants
Entre le 13 et le 15 février 1945, Churchill ordonne aux bombardiers alliés de raser Dresden, qui grouille de blessés allemands, de réfugiés et de prisonniers de guerre Russes, causant directement 135 000 morts en quelques heures. Les historiens ne s’entendent pas, apparemment, à savoir si les attaques de Hiroshima, Nagazaki, Cologne, Essen, Francfort, Hambourg et Dresden constituent des crimes de guerre. C’est surtout parce que ce sont des estis de morons. Rien que pour nous faire rire, au début du conflit, Roosevelt avait dit des bombardements de populations civiles — faisant référence à ceux de Guernica en Espagne par la Luftwaffe au profit de Franco, des villages agricoles Éthiopiens par Mussolini et de Coventry par les Allemands, constituaient des « crimes de guerre, une inhumaine barbarie ayant profondément choqué la conscience de toute l'humanité ». Après une petite réunion à Casablanca en 1943, il est décidé par Churchill et Roosevelt de piétiner toute l'Europe sous le talon de ces mêmes bombardements aériens et, tant la France que l'Allemagne, ainsi que tous les pays annexés seront visés sans pitié par des raids menés de nuit sans le moindre prétexte de précision ou de stratégie militaire, dans le but de semer la terreur, et de saper l'envie de combattre des forces ennemies ainsi que de la population civile.
J’ai discuté cet hiver avec un vieil Allemand de Hambourg (oui, j'ai parlé avec un hamburger), qui a accepté de me décrire la scène à laquelle il a assisté, lorsqu’à l’âge de 15 ans il s’est précipité dehors au cours de la première attaque, en 1943. Il habitait un petit village situé à quelques kilomètres du centre de la ville. Les bombes incendiaires avaient déversé tellement de phosphore sur la ville que les eaux de l’Elbe étaient enflammées jusqu’à chez lui. Les habitants épouvantés avaient tenté d’échapper aux brûlures en se jetant dans le fleuve et leurs cadavres jonchaient les berges, encore en flammes. Des familles entières ont été retrouvées collées dans l’asphalte des artères, qui avait fondu sous la chaleur. Les rues étroites de la vieille cité avaient constitué de parfaits corridors de convection pour les rivières de feu qui se sont ensuite mises à serpenter dans tous les quartiers. Pour être bien certains de ne pas se tromper, les alliés ont bombardé Hambourg 187 fois entre 1943 et 1945.
En tout, on estime que les raids aériens alliés ont causé 600 000 morts et 800 000 blessés parmi les populations civiles Allemandes au cours de la guerre. Des villes millénaires sont rasées. Le chef du Bomber Command, Arthur Harris, a dit de l’époque : « Nous avons toujours travaillé à partir du principe que bombarder n’importe quoi en Allemagne était mieux que de ne rien bombarder du tout. » La technique du tapissage de bombes (Carpet Bombing) vient de cette époque. Selon l’Histoire officielle de la RAF : « le niveau de destruction de l’Allemagne à la fin des hostilités aurait dégoûté jusqu'à Genghis Khan. » La campagne d'anéantissement s’arrête en avril 1945 lorsque l’armée de l’air de Sa Majesté rapporte à ses supérieurs qu’« il n’y a essentiellement plus une seule cible digne d’être frappée dans toute l’Allemagne ». Le pays est à toute fin pratique pulvérisé. Chaque bombe a été payée en entier par l’argent du peuple des pays Alliés et le sang des peuples d’Europe. Chaque bâtiment à reconstruire représente un alléchant contrat pour les banquiers qui se présenteront par la suite avec de grands sacs vides, n’attendant que les milliards pour couvrir les vallées de leur joli ciment tout neuf, socialiste d'un côté, démocratsssique de l'autre.
L’Union Soviétique avait obtenu des accords de Yalta le droit de prélever 500 000 esclaves en Allemagne et 200 000 en Roumanie, en guise de réparations. Après tout, il faut bien leur donner une bonne leçon. Ça leur apprendra, à ces chenapans, à habiter cette région.
Les Lendemains qui Chantent
Parlant de l’Union Soviétique de Staline, peu de temps après la guerre, Churchill regrette : « Nous n’avons pas dépecé le bon cochon. »
Churchill a été un ardent promoteur de l’Union Européenne... à laquelle il ne voulait absolument pas que l’Angleterre appartienne !
Une des obsessions qui anime ses vieux jours est l’alliance objective des pays de langue anglaise et il préconise une proche collaboration entre les membres du Commonwealth (Empire British version 2.0 sous un nouveau nom cool) et les États-Unis (Empire British version 3.1 sous une pseudo démocratie cool).
En 1951, Churchill revient pour une dernière balade au sommet du gouvernement British. Il propose d’interdire l’immigration indienne, suggérant en 1955 le slogan « Gardons l’Angleterre blanche ». En 1951 il envoie l’armée défoncer la révolte des Mau Mau au Kenya, puis la rébellion Malayan en Asie du Sud Est. Par chance pour les peuples aborigènes du monde, sa santé péréclite rapidement et il quitte enfin la barre du Royaume Uni en 1955. Il passe le reste de ses jours à peindre et à rédiger les milliers de pages de ses innombrables bouquins, ainsi qu'à accorder des heures et des heures d'entrevues à ses biographes, qui en retour produiront également des milliers de pages et d'innombrables bouquins.
On doit à Churchill l’expression Le Rideau de Fer. On doit le Rideau de Fer à ses potes les grands banquiers de la City, amateurs de Monopoly grandeur nature. Tant que tout le monde s'amuse !
En 1953, sa littérature reçoit l’ultime consécration sous la forme du prix... Nobel.
Chapitre 11 - Armand Hammer
 Son père, médecin juif d’origine russe émigré aux États-Unis, était un leader du Socialist Labor Party of America (parti socialiste des travailleurs des États-unis). Le petit Armand fait fortune durant la prohibition en vendant un « médicament » contenant de l’alcool.
Son père, médecin juif d’origine russe émigré aux États-Unis, était un leader du Socialist Labor Party of America (parti socialiste des travailleurs des États-unis). Le petit Armand fait fortune durant la prohibition en vendant un « médicament » contenant de l’alcool.
En 1921, Armand Hammer part en Russie, sous le couvert d’une mission humanitaire, avec l’intention de récupérer une petite fortune que les Soviétiques doivent à la pharmaceutique familiale. Les connexions de son papa lui permettent de rencontrer Lénine, en pleine phase de NEP. Lénine donne sa bénédiction à Hammer, qu’il surnomme « le petit sentier menant au monde des affaires états-unien. » Hammer obtient dès lors une concession d’amiante bidon (servant à blanchir de l’argent), un business d’importation de blé, une agence de camions Ford, le monopole national des crayons de plomb et des concessions de fourrure en Sibérie. On lui permet également de piller les musées russes de leurs tableaux précieux. Le chef du FBI, Jay Edgar Hoover, écrit sur son dossier au FBI : « un tas de pourris » (a rotten bunch). Il reste toute sa vie proche du pouvoir soviétique. Il est ami de Nikita Khrushtchev et sert d’intermédiaire entre cinq leaders soviétiques et leurs vis-à-vis états-uniens, jusqu’à Michaïl Gorbatchev.
En 1956, il achète une petite pétrolière ruinée, la Occidental Oil. Armé de ses nombreux contacts politiques et financiers il transforme vite son entreprise en géant tentaculaire. Occidental connaît une croissance miraculeuse, montrant des ventes de 700 millions de dollars dès 1966. C’est cette année-là qu’il décroche le gros-lot avec une concession en Libye, qui s’avérera un des plus grands gisements d’or noir du monde, évalué à trois milliards de barils. La pétrolière reste en place après le coup d’état de Kadhafi, le premier septembre 1969.
 Malgré ses évidentes sympathies pour les élites de l’Union Soviétique, Hammer est resté toute sa vie un fervent membre du parti Républicain. Il a été un des grands supporteurs de Richard Nixon. Condamné pour des contributions électorales illégales à ce dernier, il est éventuellement gratifié du pardon présidentiel de George H.W. Bush. Il est également parmi les proches souteneurs de Al Gore, dont le père, Al Gore Sr., comptait parmi ses associés. Al Gore Sr., le papa du grand leader écolo, a fait sa fortune et son influence en tant que président de la division du charbon chez Occidental Petroleum. Au cours de la campagne de Bill Clinton, Ray Irani, pdg d'Occidental Petroleum, soutient le Comité National Démocrate à la hauteur de 470 000 $, en plus d'offrir directement 35, 550 $ à Al Gore lui-même. En 1995, il est invité à passer la nuit à la Maison Blanche, dans la chambre à coucher de Lincoln. Puis, Al Gore s'arrange pour que la réserve pétrolière fédérale de Elk Hills soit cédée à Occidental.
Malgré ses évidentes sympathies pour les élites de l’Union Soviétique, Hammer est resté toute sa vie un fervent membre du parti Républicain. Il a été un des grands supporteurs de Richard Nixon. Condamné pour des contributions électorales illégales à ce dernier, il est éventuellement gratifié du pardon présidentiel de George H.W. Bush. Il est également parmi les proches souteneurs de Al Gore, dont le père, Al Gore Sr., comptait parmi ses associés. Al Gore Sr., le papa du grand leader écolo, a fait sa fortune et son influence en tant que président de la division du charbon chez Occidental Petroleum. Au cours de la campagne de Bill Clinton, Ray Irani, pdg d'Occidental Petroleum, soutient le Comité National Démocrate à la hauteur de 470 000 $, en plus d'offrir directement 35, 550 $ à Al Gore lui-même. En 1995, il est invité à passer la nuit à la Maison Blanche, dans la chambre à coucher de Lincoln. Puis, Al Gore s'arrange pour que la réserve pétrolière fédérale de Elk Hills soit cédée à Occidental.
Hammer se vante à la fin de sa vie d’être le seul humain de l’Histoire à avoir été l’ami de Vladimir Lénine et Ronald Reagan.
 Le gigantesque marché russe devait être converti en marché captif et en colonie technique destinée à être exploitée par une poignée d’États-uniens et les corporations sous leur contrôle.— Antony C. Sutton
Le gigantesque marché russe devait être converti en marché captif et en colonie technique destinée à être exploitée par une poignée d’États-uniens et les corporations sous leur contrôle.— Antony C. Sutton
Wall Street and the Bolchevik Révolution, 1974
Histoire pré industrielle Les premiers écrits évoquant Bakou datent de six cent ans avant J-C. Le petit port a longtemps appartenu aux empires perses. La ville s’est transformée en forteresse au moyen-âge et a su résister durant des centaines d’années aux tentatives de capture, jusqu’à ce que le Shah d’Iran Abbas Premier ne la réduise en poussière en 1604. Pierre Le Grand l’annexe à l’empire Russe en 1723, après un très long siège. La petite cité caspienne change ensuite de main quelques fois. Son importance stratégique est à l’époque principalement due à sa situation de port sur la Mer Caspienne, planté en plein centre de la frontière naturelle des montagnes du Caucase, assise entre deux univers, l’Europe à l’Ouest et l’Asie à l’Est.
Pétrole
 On ramassait le pétrole à la main, à Bakou, depuis l’antiquité. On s’en servait pour s’éclairer. Les historiens arabes du neuvième, dixième et treizième siècles relatent déjà l’importance de cette ressource dans la région. Marco Polo en parle dans ses récits de voyages. Le voyageur allemand Adam Oleari décrit en 1636 une trentaine de puits de pétrole qui giclent avec une grande puissance. En 1683, on exporte la production dans des outres chargées sur des chameaux et par navire jusqu’au Dagestan.
On ramassait le pétrole à la main, à Bakou, depuis l’antiquité. On s’en servait pour s’éclairer. Les historiens arabes du neuvième, dixième et treizième siècles relatent déjà l’importance de cette ressource dans la région. Marco Polo en parle dans ses récits de voyages. Le voyageur allemand Adam Oleari décrit en 1636 une trentaine de puits de pétrole qui giclent avec une grande puissance. En 1683, on exporte la production dans des outres chargées sur des chameaux et par navire jusqu’au Dagestan.
Les toutes premières plate-formes pétrolières du monde sont mises en place à Bibi-Heybat, près de Bakou, en 1803, plus de cinquante ans avant les débuts pétroliers du Colonel Drake en Pennsylvanie. C’est à Bakou que Nikolay Voskoboynikov invente la raffinerie, en 1834, pour extraire le kérosène de l’huile blanche et de l’huile noire.
Mais c’est le succès du développement industriel de l’exploitation du kérosène sur la scène internationale qui a donné l’idée au Tsar réformiste Alexandre II de convier les frères Nobel à Bakou en 1873. Ceux-ci impliquent les Rothschild de France dans leurs projets et la région se transforme à une vitesse fulgurante en royaume de l’or noir. Le premier tanker et le premier pipeline des Nobel sont en fonction dès 1877 et le chemin de fer des Rothschild est en bonne voie d’être complété (Krasnovodsk, Bokhara, Batumi, Bakou).
Alexandre II avait émancipé les serfs de Russie et préparait l’instauration d’une assemblée responsable (la Douma). Il échappe à quatre tentatives d’assassinat entre 1879 et 1881, pour finalement succomber sous les bombes de trois « révolutionnaires » le 13 mars 1881.
Pogroms
C’est à cette époque que débute la première vague de pogroms contre la population juive de Russie. On attribue souvent cette flambée de violence anti-sémite au fait qu’un des assassins du Tsar ait été juif. C’est là une de ces pures absurdités dont l’histoire officielle aime bien nous gaver. Il est de notoriété que ces pogroms aient bénéficié du support de la police secrète du Tsar, l’Okhrana. La quasi-totalité des pogroms ont lieu dans le Sud de la Russie, en général près des installations appartenant à la famille Rothschild, notamment le long de leur chemin de fer. Par un pur hasard dont l’histoire officielle ne saurait s’embarrasser, le concurrent direct des Nobel et Rothschild s’avère être la Standard Oil, créée et contrôlée par John D. Rockefeller, qui fondera les principaux instituts eugénistes quelques années plus tard (La Société pour l’Hygiène Raciale de Berlin et le Cold Spring Harbor à New York, dès 1904).
Succès foudroyant Dès 1886 le pétrole de Bakou dessert Londres grâce à une invention des Nobel, le tanker, via Batum. En 1893, un monopole est formé, réunissant tous les pétroliers de Russie sous un même chapiteau, l’Union des Producteurs de Kérosène de Bakou, dirigée par les Nobel. En 1898, les Rothschild opèrent une flotte de tankers sur la Mer Caspienne. En 1899, la seule ville de Bakou est la première source de pétrole mondiale et livre 11,5 millions de tonnes, deux millions de plus que la production entière des États-unis. En 1903, Bakou produit à elle seule la moitié du pétrole mondial. En 1907, le pipeline Bakou-Batoum est complété par les Rothschild.
La capitale caucasienne est également devenue le nid des révolutionnaires de Russie. C’est là qu’opère une presse révolutionnaire secrète surnommée « la Nina », qui imprime le journal Iskra de Lénine, dont les plaques sont infiltrées par le réseau de distribution des pétrolières. 1 L'agitation atteint son comble en 1904 et 1905. Un des principaux leaders des insurgés est le prêtre Georges Gapon, un agent double de l'Okhrana. Il mène ses protestataires dans une manifestation piège devant le Palais d'Hiver de Saint-Pétersbourg, où la garde du Tsar ouvre le feu, faisant plus de cent morts. Après quelques voyages sympas en Europe, il retourne en Russie travailler pour la police du Tsar. C'est en tentant de recruter d'autres camarades pour le compte des poulets que Gapon rencontre le mauvais bout d'une corde.
Les protestations de la population mènent le Tsar à publier un manifeste promettant liberté de parole et parlementarisme. Les esprits se calment un peu partout, mais pas dans le Sud. La ligne de chemin de fer trans-baikal est saisie par des grévistes. Les installations de Bakou sont sévèrement endommagées au cours de manifestations violentes. Le chemin de fer trans-sibérien est également paralysé par les insurgés. Le Tsar finit par solutionner la crise en bombardant les quartiers populaires à l'artillerie. Un an plus tard, à bout de patience, le Tsar abolit déjà l'assemblée et lance une campagne de procès à ciel ouvert suivis de pendaisons des meneurs ouvriers.
 En 1905 ont lieu les pires pogroms contre les juifs, souvent près des fiefs où œuvrent les Rothschild ou des industries qui leurs sont liées. Les émeutes, révoltes et massacres font 2000 morts et d'innombrables blessés chez les juifs. De 1905 à 1907 la Russie est le théâtre de nombreux assassinats, attentats terroristes et sabotages, toujours pilotés par l'Okhrana, dont on arrive à se demander parfois pour qui elle travaille.
En 1905 ont lieu les pires pogroms contre les juifs, souvent près des fiefs où œuvrent les Rothschild ou des industries qui leurs sont liées. Les émeutes, révoltes et massacres font 2000 morts et d'innombrables blessés chez les juifs. De 1905 à 1907 la Russie est le théâtre de nombreux assassinats, attentats terroristes et sabotages, toujours pilotés par l'Okhrana, dont on arrive à se demander parfois pour qui elle travaille.
Les Rothschild, au sommet de leur gloire de pétroliers, jettent pourtant l’éponge et vendent leurs parts à Royal Dutch Shell à l’orée de la première guerre mondiale. Les Nobel, eux, résistent. Les fils de l’inventeur de la dynamite sont chassés de Russie par la commune bolchevik spontanée de 1917 et fuient le Caucase à pied, déguisés en paysans. Ils se réfugient à Paris où, sans le sou et désespérés, ils vendent leur empire à rabais à… la Standard New Jersey de Rockefeller.
Au cours de la révolution Russe, la région fait l’objet d’une véritable bagarre de hyènes, alors qu’un détachement britannique occupe la ville, que les troupes turques de l’Ottoman Mursal Pasha s’approchent par l’Ouest après avoir pratiquement conquis tout le Caucase, que les Bolcheviks tiennent à leur joyau énergétique, que la ville elle-même s’est déclarée république libertaire, que les armées Blanches (réactionnaires tsaristes) et Vertes (bolcheviks trahis et paysans révoltés) rôdent encore dans la région et que les ethnies locales (Arméniens, Azéris, Cosaques, Georgiens, Russes) sont sur le point de s’entre-égorger. C’est presque à n’y rien comprendre !
En juin 1918, Moscou avait envoyé à Bakou un commissaire bolchevik du nom de Stepan Shahumian accompagné de quelques troupes, en charge de prendre le contrôle de la ville. Cependant, les effectifs demandés par Shahumian sont retenus à Tsaritsyne par ordre de Staline. C’est également par ordre de Staline que le grain récolté dans le Nord du Caucase pour nourrir les affamés de Bakou assiégée est détourné vers Tsaritsyn. Shahumian proteste auprès de Lénine et du Comité Militaire et martèle que Staline refuse de les aider. À cours de nourriture et d’hommes pour le défendre, le soviet de Bakou est livré aux envahisseurs.
En juillet, un coup d’état mené par le Tsariste Dokuchaïev et l’Arménien Avetisov remplace donc le Soviet de Bakou par la Dictature Centro-Caspienne. La flotte Russe prête allégeance aux nouveaux maîtres et empêche la retraite des Bolcheviks par la mer. Cependant, le 30 juillet, l’armée de l’Islam de Mursal Pasha atteint les premières défenses de Bakou et commence à s’assembler pour la bataille. En même temps, les Britanniques de Dunsterville, étonnamment accueillis par Dokuchaïev et Avetisov, viennent s’installer à Bakou par la mer. Quelques escarmouches ne permettent pas aux forces ottomanes de s’emparer de la ville.
Dunsterville fait dans son journal le récit d’atrocités commises par les Arméniens contre les musulmans de la région dont dix mille sont assassinés. L’armée de l’Islam lance une offensive impitoyable le 13 septembre et les Russes Blancs, les Arméniens et les Britanniques évacuent la ville pour se replier sur Anzali. Les généraux de l’armée Ottomane laissent pendant deux jours la ville aux mains des troupes irrégulières Azéries qui se livrent à des massacres inouïs contre la population arménienne de la cité, faisant 20 000 morts, un quart de la population.
Les forces germano-turques ont à peine le temps de célébrer leur victoire à Bakou que l’armistice est signée. Les Anglais réintègrent la cité le 16 novembre et remettent en place le gouvernement de la Dictature Centro-Caspienne.
Les Bolcheviks capturent Bakou en avril 1920 et nationalisent les champs pétrolifères, juste quelques instants, le temps de se retourner et de les offrir en mars 1921 à la Standard des Rockefeller, à Averell Harriman, proche de Morgan et concurrent ferroviaire historique des Rothschild et à Royal Dutch Shell. Un certain Leonid Krasin, banquier bolchevik, anciennement de la multinationale allemande Siemens et ex-planificateur financier du Tsar, émerge en tant que Commissaire au commerce extérieur et au transport du gouvernement soviétique. Il invite ses potes du 120 Broadway à se servir. Le fin négociateur ajoute même les immenses champs de Grozny en guise de su-sucre. C’est l'Anglo-Soviet Trade agreement. La Royal Dutch Shell reprend le contrôle de l’empire des Rothschild en Russie.
En 1924, les « concurrents » Standard New Jersey et Royal Dutch Shell fondent une entreprise commune pour exploiter le pétrole… soviétique.
Bizarrement, Henri Deterding, le pdg de Royal Dutch Shell, marrie la princesse russe Lydia Pavlova, une anti-communiste féroce, et tente de convaincre John D. Rockefeller Jr de sortir Standard New Jersey de la Russie. « Le système soviétique meurtrier ne pourrait pas se maintenir sans le support de vos compagnies ». Lydia Pavlova avait été auparavant la maîtresse du sympathique pétrolier arménien Calouste Gulbenkian.
L’obsession d’Hitler, c’est le pétrole. Il considère qu'il s'agit de la principale ressource de l’ère industrielle et une garantie de puissance économique. Speer déclare à Nuremberg que « le principal motif d’invasion de la Russie était le pétrole ». Avant son suicide, Hitler donne des ordres pour que sa dépouille et celle de son amante soient imbibées de gasoil et incendiées. Dès le départ de la campagne de Russie, le principal objectif allemand est la capture de Bakou.
Hitler calcule que le nombre de soldats qu’il prévoit perdre durant la campagne de Russie se compare avantageusement au nombre de travailleurs retenus par la production de pétrole synthétique et donc, juge que le jeu en vaut la chandelle. Juste avant le commencement de l’opération Barbarossa, un communiste allemand dévoué traverse la ligne de front pour aller prévenir les Russes de l’invasion imminente. Staline le fait exécuter.
Le plan Allemand est de se diriger en masse sur la Crimée et le Caucase, pour couper la Russie de sa capacité de bouger. Mais étrangement, de manière inexplicable, Hitler finit par changer d’idée, pour ordonner à son armée de foncer partout, Léningrad, Moscou, Stalingrad, tout en même temps ! Les incroyables divisions allemandes parviennent quand même à assiéger Moscou, Léningrad et Stalingrad (l’ancienne Starytsine), mais c’est la famine de carburant qui les stoppe à quelques kilomètres de tous leurs objectifs au début de l’hiver 1941. Le Quartier-maître Général déclare qu’il a atteint la fin de ses ressources, le 27 novembre. En voilà, une débilité, dans un domaine où on planifie les ressources des opérations des années d’avance. Pfft ! Plus de gazoil, on bouge plus… Les Allemands auraient, selon l’histoire officielle, mal calculé les distances qu’auraient à parcourir leurs armées pour se rendre à Bakou. Uhm. Des débutants. Des amateurs !
En 1942, la Wermarcht remet ça. Hitler est bien décidé à foncer sur Bakou en tout premier lieu. On a même formé une division d’ingénieurs de 15 000 hommes qui devront remettre sur pied la production pétrolière Russe, une fois Grozny et Bakou conquises. Comme d’habitude, le plan est d’une efficacité inouie. En juillet, les Nazis avancent de 500 kilomètres, détruisent 5000 blindés et 6000 canons, font rien de moins que 600 000 prisonniers, tiennent Rostov et coupent le pipeline reliant le Caucase à la Russie. Le 9 août, ils parviennent à Maikop, petit centre pétrolier, valant un dixième de la production de Bakou. À la mi-août, les Allemands sont au mont Elbrouz, à 150 km de Grozny et de Batoum, et à moins de 600 kilomètres de Bakou. Pendant ce temps, une autre armée, celle de Von Paulus, est entrée à Stalingrad, écrabouillant les défenses extérieures et s’emparant des aérodromes. Tout va bien pour les nazis, la paix hitlérienne est en vue sur le front Est ! Soudain… Le truc improbable…
Télégramme du général Von Kleizt : « Devant moi, plus d’ennemi, derrière moi, plus de ravitaillement ». Il avait la moitié des réserves pétrolières mondiales à sa merci. 5 À très court terme, sa victoire dans le Caucase aurait signifié la fin de la seconde guerre mondiale
Il n’est pas une réforme religieuse, politique ou sociale, que nos pères n’aient été forcés de conquérir de siècle en siècle, au prix de leur sang, par l’insurrection.— Eugène Sue, 1848
Le Filou flou
Par un de ces hallucinants hasards de l'Histoire, le petit Staline porte à la naissance le nom de famille de Djougashvili, qui signifie en Georgien : djouga : « joug » et vili : « fils-de ». Son nom de famille, merveilleusement prédestiné, signifie donc dans sa langue natale « le fabricant de jougs ». Dans le genre, il va connaître toute une carrière. C’est à une success story plus-qu’hollywoodienne que Le Crachoir™© vous convie.Les détails de la vie de Iossif Djougashvili sont nimbés d’un flou artistique du plus bel effet. Par exemple, sa date de naissance est soit le 18 décembre 1878, soit le 21 décembre 1879. Même sa mort reste floue. Il est à peu près mort dans les alentours du 5 mars 1953. Son nom fait l’objet d’un sfumato fascinant. L’Histoire officielle aime bien se couvrir de ridicule en parlant du petit Staline dans la cour d’école, alors qu’il n’adopte ce nom d’artiste qu’en 1917. D'abord surnommé Sosso, Chopour (le grêlé), puis Koba (l’ours), il a également opéré sous les pseudonymes de Riaboy, Besoshvili, Ivanov, Ivan Ivanovitch Vissarionovitch, Gaiov Vissarionov Nijeradjé, Oganes Vartanov Totomyantz, Zakhar Grigorian Melikantz, Peter Alexeievitch Chijikov, Vassiliev, V. Alexeev et Ivan Vassilievitch. Rien que pour montrer comme les grandes idées voyagent, il est (presque) marrant de signaler qu’on a aussi appelé Staline le « Vojd », (le guide), mot qui se traduit en allemand par « führer ».
Le petit Iossif aurait vu le jour à Gori, dans l'actuelle Georgie, d'un père cordonnier et d'une mère couturière, qui lui communiquèrent sans doute respectivement son immense amour des bottes et des costumes. Certains indices laissent croire que le petit Iossif serait le produit illégitime d'une idylle entre sa bonne et dévote maman et… un prêtre lié à la famille. Le père légal de Iossif, Vassirion, soupçonne apparemment la vérité et devient acariâtre, alcoolique et violent. Il inflige dès la plus tendre enfance d’intenses raclées à son fiston en le traitant de bâtard, dont une des plus mémorables laissera le môme avec un bras plus court que l’autre, handicap qu’il conservera jusqu’à la fin de ses jours.
Le prêtre Koba Egnatashvili, probablement le père biologique de Iossif, devient recteur d’un collège et le prend sous son aile. Egnatashvili va constamment abriter son turbulent protégé au cours de son enfance. À l’adolescence, il se signale entre autres en infiltrant des tracts révolutionnaires dans le dortoir de l’école, avant de dénoncer ses petits camarades aux autorités pour possession de littérature subversive.
Défroqué, décrocheur, le petit Sosso va se laisser entraîner dans une vie dissolue, faisant les quatre cent coups dans la région. Il devient un petit brigand qu’on dit habile. Il se spécialise dans la planification des méfaits. Assez vite arrêté, il sera libéré en échange de sa promesse de collaborer avec la police. Il dénonce les potes et gagne vite du galon au sein de l'Okhrana.
Okhrana au plus haut des cieux
En 1898, le chef du bureau moscovite de l'Okhrannoe Otdelente (police secrète du Tsar, section sécurité) s'appelle Sergei Vassiliev Zoubatov. Il est spécialisé dans la provocation. Il a lui-même été enrôlé dans le cadre d’une opération typique de l'Okhrana de l'époque. Arrêté dans sa jeunesse en tant que membre d'un groupe d'étudiants militants, il a été recruté en prison et a commencé par devenir indic, puis agent, pour éventuellement gravir les échelons de la hiérarchie policière.
La première véritable mission documentée du jeune Iossif pour le compte de la police remonte à 1901. Il a 22 ans. Un scandale engendré par un coup que les journaux de l’époque qualifient de « provocation à la Zoubatov » atteint l'Okhrana de Tifflis (Tblissi). Le jeune Djougashvili est impliqué à fond dans l'affaire, ainsi que son ami, le jeune cambrioleur Kamo Somekhi. Les deux jeunes impriment des tracts révolutionnaires et en font porter le blâme sur les membres d'un cercle socialiste, qu'ils dénoncent à la police. Bref, Iossif refait le coup du séminaire. Tous les membres du cercle sont arrêtés sauf Iossif et Kamo.
L'Okhrana engage ensuite notre jeune héros pour qu’il s'intègre aux rangs des émeutiers, grévistes et rebelles qui abondent dans le Sud de la Russie de l'époque. Il participe donc à la déstabilisation de l’empire pétrolier des Nobel et des Rothschild. Le jeune Iossif se fait désormais appeler Koba et commence à jouir d’une réputation de solide braqueur de banque.
D’abord simple indic, il se voit progressivement confier par la police du Tsar de plus en plus de missions d'infiltration des mouvements révolutionnaires. Il ne faut pas longtemps à notre jeune vedette montante pour établir un lien avec les Bolcheviks, qui sont en perpétuelle recherche de capitaux. Ceux-ci offrent à de nombreux bandits la protection structurelle de leur organisation, en échange d’une part des butins. On appelle ces simples vols glorifiés des expropriations. Dans une improbable série de coups foireux et de ratages, il sera successivement arrêté, emprisonné, libéré, repris, exilé, oublié, évadé, écroué, en voyage, revenu, reparti, banni et pardonné. Dans certains milieux, on regarde un type comme lui et on se dit « uhm… ».
Mais Iossif gagne du galon à une vitesse fulgurante et, de surcroît, de façon parallèle dans ses trois rôles, celui de brigand, d’agent du Tsar et de révolutionnaire. Il rapporte un à l’autre, dénonce celui-ci à ceux-là… Et voilà sa carrière lancée pour de bon. Il traite désormais directement avec le sommet, son patron d’un côté est le grand Érémine, directeur de l’Okhrana, et de l’autre, Vladimir Lénine, chef incontesté des Bolcheviks. C’est en service commandé pour Érémine et Lénine que Iossif-Koba est impliqué en 1907 dans la très sale affaire du braquage de Tifflis, hold-up hyper violent ayant mal tourné, au cours duquel on déplore trois morts et cinquante blessés.
1909 est une bien sombre année pour le futur Staline. D’abord, les Mencheviks de Tifflis accusent formellement Iossif-Koba d'être un agent provocateur. Il déménage à Bakou. Puis, encore une fois « évadé » d’un exil lié à une affaire ténébreuse, il rentre à peine à la maison que sa femme Katerina meurt dans des circonstances étranges, qui font croire à un suicide. Iossif déclare à l'enterrement qu'il a désormais perdu tout sentiment pour l'humanité.
Peu de temps après, Stepan Shahumian, futur commissaire de la commune de Bakou, appuyé par de nombreux meneurs du mouvement Bolchevik, accuse formellement notre cher petit Iossif de travailler pour l’Okhrana. Au cours d’un interrogatoire, un policier maladroit a appris à Shahumian que c’était Koba qui l’avait fait arrêter. Iossif ne s’en sort temporairement qu’en retournant l’accusation contre ses détracteurs. Le comité décide de faire enquête. Pur hasard, quelques jours plus tard, les investigateurs du comité sont tous arrêtés par la police et déportés aux quatre vents ! À la fin de cette triste année pour notre héros, son patron Érémine est promu et le remplaçant de celui-ci envoie Iossif terminer sa peine en Sibérie. C’est la loi des séries noires. Iossif ne trouve rien de mieux à faire que de violer la veuve chez qui il est logé et elle tombe enceinte.
Lossif remonte au score !
En 1911, Stepan Petrovitch Beletski, le nouveau directeur de l’Okhrana, et Vladimir Illitch Lénine, chef des Bolcheviks, poursuivent officiellement un but identique, soit la division des forces révolutionnaires en deux groupes opposés, les Mencheviks modérés d’un côté et les Bolcheviks radicaux de l’autre. Beletski fonde la Pravda avec des budgets de la police du Tsar, dans le but d’affaiblir le journal Luch, des Mencheviks. Beletski et toutes les polices secrètes de l’époque infiltrent avec une facilité déconcertante le parti de Lénine, à tel point qu’une affaire très marrante se produit.
Après sa brève déchéance, Iossif est parvenu à revenir au sommet de l’Okhrana. Au début de 1913, à la suite de quelques bonnes manœuvres, notre petit Georgien est devenu l’un des plus grands agents doubles de l’organisation avec Roman Malinovski. La lutte entre les deux est forte, tant à l’Okhrana que dans le parti, et Iossif souffre d’une grande jalousie à l’égard de son rival, que Lénine aime d’amour. Le leader bolchevik appuie la candidature de Malinovski à la Douma. Voyant cela, l’Okhrana décide de truquer l’élection et le protégé de Lénine est élu député. La police secrète a désormais un siège à l’assemblée, et pas le moindre, puisque Malinovski devient le chef des Bolcheviks de la Douma ! Iossif est vert de rage et tente de discréditer Malinovski auprès de Beletski, puis de Lénine, mais sans succès. Tout le monde aime Malinovski !
Frustré, notre beau Iossif s’allie alors au Colonel Ivan Petrovitch Vassilief, un haut gradé ambitieux de la Section Spéciale de l’Okhrana qui croit qu’en exposant l'élection frauduleuse de Malinovski, il fera rouler les têtes de ses chefs et sera promu à leur place. Ce Colonel Vassilief a commencé sa carrière dans le Caucase, où il était chargé de fomenter des pogroms anti-sémites. C’est même à lui qu’est revenu l’insigne honneur de la toute première distribution du sinistre ramassis intitulé Les Protocoles des Sages de Sion.
Autopsie d'un torchon best-seller
Tout commence par une blague. Eugène Sue, le célèbre auteur des Mystères de Paris, écrit en 1848Les Mystères du Peuple, une fiction sarcastique dans laquelle les Jésuites complotent pour dominer le monde. Il est emprisonné, puis exilé et son livre est interdit. En 1864, Maurice Joly en fait une adaptation loufoque dans laquelle les Jésuites sont remplacés par Napoléon III : Dialogue aux Enfers.
Les plaisanteries les meilleures sont les plus courtes, mais en 1895, Matvei Golovinski, agent de l’Okhrana à Paris, recopie la copie de Joly en Russe, et remplace Napoléon III (donc les Jésuites) par les… juifs.1 Le livre est édité en Russie par Pavel Krushevan, trois mois après qu’il ait dirigé l'infâme pogrom de Chisinau, en Moldavie. Golovinski revient en Russie en 1917 où il se fait passer pour médecin et… Bolchevik. Ça lui réussit plutôt, puisqu’il devient député de soviet à Saint-Petersbourg et conseiller de Trotski. Les Protocoles sont publiés en 1920 par le Times de Londres, en 1921 par Grasset en France et par Henri Ford aux États-Unis. Ils servent aussi, bien sûr, de fondement à Mein Kampf, le grumeau phare qui lance Adolf Hitler en orbite en 1926.
Le but original de la manœuvre, selon le chercheur russe Mikhail Lépekhine, était de convaincre le Tsar des dangers de la modernisation à laquelle il soumettait alors la Russie, associée aux grands financiers juifs. Les Protocoles visaient donc bel et bien les associés capitalistes du Tsar et comme leur publication par l’Okhrana semble avoir fait partie d’une vaste campagne, on peut soupçonner la police secrète d’avoir travaillé, non pas pour l’Empereur de Russie, mais pour l’ennemi naturel des Rothschild.
1913 est une année importante dans la vie de Iossif. Aidé d’un côté par Lénine et de l’autre par Beletski, il entre au comité éditorial de la Pravda et change son nom de plume. Il signe dès lors ses articles du nom de son ami : Vassilief. Chose étrange, pendant les quelques mois que dure son association au Colonel Vassilief, Iossif se met à désobéir tant à Beletski qu’à Lénine. Plutôt que de travailler à la division des forces révolutionnaires, il prône leur alliance. Il retarde même la publication d’articles de Lénine. Iossif ose donc s’opposer en même temps à la police du Tsar et à l’armée révolutionnaire ! Venant d’un homme dont la réputation de prudence n’est plus à faire, c’est presque sidérant. Il est difficile de ne pas se réjouir pour notre héros en songeant qu’à partir de ce moment, il compte sans doute secrètement sur un nouvel allié très puissant.
Fait à noter, c’est à ce moment-là, en 1913, que Iossif utilise pour la première fois le pseudonyme de Staline, pour un petit article traitant du problème des Nationalités. Ulcéré et inquiet du comportement de son agent, Beletski le fait exiler en Sibérie (avec logement et salaire) et demande à toutes les sections de l’Okhrana de lui transmettre leurs dossiers sur l’agent Koba. Il reçoit une véritable montagne de rapports.
Beletski n’imaginait sans doute pas que ce dossier était une bombe à retardement d’une puissance insoupçonnée, ni qu’il resurgirait de la poussière et deviendrait l’enjeu de complots et de purges sanglantes, déclenchant des convulsions dans tout le pays et causant la souffrance de millions de gens.
Vladimir Lénine apprend la déportation de son cher cambrioleur et demande à… Malinoski de le faire évader. Celui-ci communique donc avec son directeur à l’Okhrana pour le prévenir de la demande des Bolcheviks. Beletski craint de voir réapparaître cet agent devenu incontrôlable et fait transférer Iossif près du cercle arctique, dans un camp « dont on ne s'évade guère ». Lénine, inquiété par toutes sortes de rumeurs d’infiltration, décide de mettre sur pied un comité de contre-espionnage, et en confie la direction à… Malinovski.
Malheureusement pour ce dernier, Beletski devient sénateur en 1914 et son remplaçant à la tête de l’Okhrana coupe les liens avec son agent vedette, à la suite des machinations du colonel Vassiliev. Malinovski est expulsé de la Douma et exilé en Allemagne. Il reviendra à Saint-Petersboug en 1918 et sera aussitôt arrêté et exécuté par Grigori Zinoviev.*
Les jours heureux de la guerre de 14
Tout va bien pour notre petit Iossif, qui se la coule douce hors d’atteinte de la guerre qui éclate en 1914. Il est même libéré en 1916, en même temps que tous les prisonniers politiques, qui sont recrutés d’office dans l’armée. Par contre, une intervention de l’Okhrana lui permet de s’en sortir indemne et il passe plutôt les derniers mois de son exil dans un hameau paisible, loin des ennuis.
En février 1917, un soulèvement populaire mené par les grands rivaux des Bolcheviks parvient contre toute attente à renverser le Tsar. C’en est fini de l’Okhrana. Du jour au lendemain, Koba perd son employeur de longue date. Il saute dans un train et file en douce vers Saint-Pétersbourg, où la Pravda le réintègre dans son comité éditorial. Iossif garde profil bas pendant ces quelques mois, tout en espérant que personne ne tombe sur les innombrables traces de son impressionnant curriculum vitæ à la police impériale. Le petit Iossif n’est plus grand chose, en fait, mais il ne faut pas trop s’en faire pour notre héros. La providence veille au grain. Une force inconnue va bientôt le propulser vers les cimes.
Chapitre 12 - Staline III
Les tribunaux ne doivent pas freiner la terreur bolchevique. Ce serait un faux semblant ; ils doivent plutôt, dans leur principe, clairement garantir et légaliser la terreur, sans mensonges et sans fioritures.— Lénine, 1918
Les réformateurs de Smolny ne se préoccupent pas de la Russie. Ils sacrifient la Russie de sang froida u nom de leur idéal de révolution européenne et mondiale. Aussi longtemps que je le pourrai, je tenterai de rejoindre le prolétariat russe pour lui dire : « on vous mène à la destruction ! On se sert de vous dans le cadre d’une expérience inhumaine »— Maxim Gorki, avril 1918
Gouvernement provisoire, très provisoire
On assiste donc une révolution populaire au début 1917, financée en grande partie par le Kaiser Willhelm XX, monarque de l’Allemagne, avec laquelle la Russie est en guerre depuis 1914. Le peuple monte aux barricades partout dans l’empire Russe et en quelques semaines, le Tsar est renversé. En février, onde de choc dans le monde entier : le Tsar est renversé. Une coalition bigarrée s’empare du pouvoir (paysans, gauche modérée, socialistes révolutionnaires, réformistes de droite, bourgeoisie, etc.), menée par les Mencheviks de Kerenski dont le gouvernement provisoire s’empresse d’établir une assemblée, de préparer des élections, d’élaborer une constitution, bref, de mettre en place ce que le peuple, dégoûté de la sourde brutalité monarchique réclame. Le Tsar renversé, l’armée Russe, toujours en guerre, est désorganisée et subit défaite sur défaite. C’est un succès pour l’Allemagne.
Cependant, le véritable homme du Kaiser n’est pas Kerenski, mais plutôt le chef incontesté des Bolcheviks, Vladimir Illitch Ulyanov, mieux connu sous le nom d’artiste de Lénine. Le pacte entre le Kaiser et Lénine est simple. Le premier finance les Bolcheviks et le second promet de signer une paix immédiate avec l’Allemagne, à des conditions avantageuses pour celle-ci. Une fois bien assis sur le trône, Lénine s’engage à rembourser son bon maître allemand à même les fonds du trésor national Russe.
À ce propos, le 3 décembre 1917, Richard Von Kuhlmann, ministre allemand des affaires étrangères :
« Ce ne fut que lorsque les bolcheviks commencèrent à recevoir de nous un flot constant d’argent par divers canaux et sous des noms divers, qu’ils purent assurer la pérennité de leur journal principal, la Pravda, engager une propagande énergique et élargir considérablement la base étroite de leur parti. Maintenant, les bolcheviks sont au pouvoir. [...] Ils ont besoin de la paix pour fortifier leurs positions. [...] La signature d’une paix séparée représenterait la réalisation du but militaire recherché et particulièrement la rupture entre la Russie et ses alliés. »
Que font-ils ?
Il est intéressant de noter à posteriori les activités de quelques mythiques héros révolutionnaires au cours de l’hiver 1917.
Lénine, debout parmi les balles qui sifflent, drapeau rouge déchiqueté tenu à bout de bras, un couteau entre les dents et une grenade dans le… Uhm ?… Euh… En fait… Illitch Ulyanov se la coule douce à Zurich, en Suisse, au moment où les révolutionnaires risquent leurs vies dans les rues et affrontent les polices du Tsar. C’est dans un train spécial que le Kaiser fait transporter Lénine (son arme secrète) à travers l’Allemagne en guerre, en compagnie de 40 de ses proches collaborateurs, qui transitent ensuite par la Suède et la Finlande. Y a pas le feu au lac, semble se dire ce Suisse d’adoption. Et puis il serait mal vu par le peuple Russe que ces révolutionnaires traversent simplement le front Allemand pour se rendre à la maison. Pourquoi passer par la Suède ? Lénine a plein accès à un compte de la société Nestlé à Stockholm en 1917. L’affaire est révélé plus tard cette année-là par le journal Jivoe Slovo.
Léon Trotski, le brave, le courageux, l’opiniâtre Trotski, mon idole de jeunesse, où est-il donc ? Je l’ai toujours imaginé juché sur le toit d’une maison, en train de mener l’assaut contre de vilains capitalistes réactionnaires, écartant les obus d’une main et soutenant les blessés de l’autre… Ah. Uhm. Vérification faite, nooon, pas tout à fait. Léon Trotski, pendant la révolution, se trouve à… New York ! Il a été reçu à Wall Street par un groupe de banquiers intéressés par certains aspects du socialisme. En apprenant la nouvelle du soulèvement menchevik, il prend un paquebot vers la mère patrie en compagnie de 278 « Bolcheviks ». Souci ! Son navire est arraisonné à Halifax par le fier gouvernement canadien, pas au courant des nouvelles subtilités du capitalisme, convaincu qu’un navire plein de révolutionnaires communistes constitue une bonne prise. C’est l’intervention directe du gouvernement États-unien qui permettra aux Bolcheviks Newyorkais de repartir.
Tout de même, un des trois grands noms du spectacle soviétique a certainement dû jouer un rôle non négligeable dans la révolution Russe, non ? Le petit Iossif, non ? Debout sur un tank à haranguer les ouvriers, seul face à l’artillerie impérialiste, triomphant au sommet sanglant d’une prosaïque colline, une gatling sur l’épaule et trois mères éplorées à ses genoux… Non ?! Uhm… Mais où est notre héros, alors ? le beau Iossif Djougashvili ? En fait, libéré d’exil par la chute du régime, il revient peinard à Saint-Pétersbourg et retourne au journal de l’Okhrana qui l’employait auparavant, la Pravda, désormais financée par… le Kaiser allemand. Comme toute la structure de la police secrète du Tsar est dissoute et que Malinowski n’est plus dans ses jambes (emprisonné dans un camp en… Allemagne), notre petit Koba a les coudées franches au journal.
Comme plusieurs agents de l’Okhrana, notre pauvre petit Iossif se retrouve sans véritable boulot et doit se sentir bien faible et abandonné, lui qu’on a laissé moisir quatre ans dans un trou perdu. De nombreux anciens de la police du Tsar restent planqués à leurs postes d’agents doubles et jouent le jeu aussi longtemps que possible parmi les révolutionnaires victorieux. Mais pour qui veut bien s’engager à renvoyer l’ascenseur en temps et lieu, les opportunités ne manquent pas. En fait, certains détails permettent de soupçonner que les amis puissants de Iossif Vissarion Djougashvili ne l’ont pas oublié et qu’en 1917, le petit Georgien figure toujours dans leurs plans à long terme.
Beaucoup de gens sympathiques se trouvent justement dans la capitale au cours des mois qui suivent le soulèvement. Parmi eux se distinguent quelques Nord-Américains plutôt bien nantis qui ont décidé, le cœur sur la main, mus par des sentiments progressistes et solidaires, de venir offrir leur aide à la population éprouvée.
Ils font pour la plupart partie de missions sanitaires pour le compte de la Croix Rouge états-unienne. Les principaux financiers de l’organisme incluent J.P. Morgan (banquier et humaniste), E.H. Harriman (baron du rail et humaniste) et Cleveland H. Dodge (Banquier et… financier du président Wilson). Le Conseil d’administration comprend le directeur Henry P. Davidson (partenaire de J.P. Morgan), assisté de Harry Hopkins, ami intime d’Averell Harriman et futur Secrétaire d’État du président Franklin D. Roosevelt, John D. Ryan (Anaconda Copper), George W. Hill (American Tobacco), M.P. Murphy (Guaranty Trust) et Ivy Lee (chef des relations publiques des Rockefeller). Tous sont évidemment engagés dans la lutte solidaire humaniste pour le bien être et la santé des populations. Les coûts de la mission en Russie sont entièrement défrayés par William Boyce Thompson, le directeur de la Federal Reserve Bank de New York. L’expédition comprend vingt-neuf membres, dont sept sont médecins. Les autres sont hommes d’affaires, banquiers et avocats, dont : Andrews (Liggett Tobacco et humaniste), Barr (Chase Manhattan), Nicholson (Swift), Swift (Swift) et Corse (National City Bank).
Ce groupe de philanthropes s’empresse d’aider le gouvernement révolutionnaire de Kerensky et lui refile 10 000 roubles (en deux versements), pour soulager les souffrances des pauvres réfugiés. En même temps, il n’y a pas que la population, qui souffre. Les Bolcheviks aussi, ont besoin d’aide ! Thompson, de la Federal Reserve, gratte le fond de sa poche et parvient à trouver un petit quelque chose à offrir à Lénine : la modique somme d’un million de dollars (approximativement 2,5 milliards en argent de 2009).
Ce qui est vraiment émouvant avec les grands gestes du cœur, c’est qu’ils sont contagieux. Une autre mission est organisée, celle-là par Edgar L. Marston et John D. Rockefeller. C’est la Noël bolchevik ! Anaconda Copper Mining offre 1 500 000 $, General Electric 1 000 000 $ et la fondation Rockefeller fournit une enveloppe discrétionnaire de 5 millions de dollars.
En août 1917, les derniers membres du personnel médical de la mission quittent la Russie, mais les banquiers, eux, restent. Il sont en plein labeur. Que préparent-ils donc ? Faisons d’abord connaissance avec quelques uns des généreux banquiers grâce auxquels le pauvre peuple Russe s’apprête à connaître enfin quelques années de bonheur et de répit.
 William Boyce Thompson
William Boyce Thompson
Ce qui me passionne est de prendre une cause désespérée pour en faire un succès
Considéré parmi les meilleurs promoteurs de capital minier de son époque, il a géré les opérations boursières des Guggenheim avant la première guerre. Son talent extraordinaire pour la manipulation des stocks miniers lui permet de gagner une fortune. Il se spécialise dans le cuivre et dirige au moins trois des principales productrices de cuivre des États-Unis (nota bene : le cuivre un élément essentiel dans la fabrication des munitions). Il dirige aussi en même temps deux importantes compagnies de chemin de fer, ainsi que l’assurance Metropolitain Life. Il fait partie des principaux actionnaires de la Chase National Bank des Rockefeller et c’est à lui qu’on confie la direction de la Federal Reserve de New York lors de la création.
Une fois le succès du coup d’état bolchevik assuré, Thompson quitte Saint-Petersbourg pour une tournée des principales capitales, où il plaide la cause des putschistes soviétiques auprès des chefs d’états et des grands banquiers.
Cornelius Kelleher, l’assistant de Thompson dit du chef médical de la mission : « Ce pauvre monsieur Billings croyait diriger une mission scientifique d’aide humanitaire en Russie. Il n’était rien de plus qu’un masque — la coquille “croix rouge” de cette mission n’était rien de plus qu’un masque. »
 Basil Zaharoff
Basil Zaharoff
D’abord enfant de la rue, petit proxénète et faux-monnayeur avant de devenir marchand d’armes, ce grec né en Turquie et naturalisé français a reçu les surnoms de Marchand-de-la-mort, Roi-des-armes, Camarade-la-mort. Il popularise la mitrailleuse Maxim et s’intègre à l’immense industrielle Vickers, qui arme les deux côtés dans la guerre Russo-nipponne de 1905, entre autres. C’est lui qui construit l’immense complexe industrialo-militaire de la ville de Tsaritsine en Russie, qui sera évidemment le site d’une des batailles les plus meurtrières de la seconde guerre mondiale, sous son nouveau nom de Stalingrad.
Il est objectivement lié à Jacob Schiff et à Churchill en plus d’avoir été un proche de Lloyd George et Aristide Briand. Chevalier de la légion d’honneur en France, Sir au Royaume-Uni, bombardé baron en raison de sa grande richesse. Il aurait investi 50 millions de livres en propagande au cours de la première guerre mondiale, une fraction de ses profits.
Son biographe mentionne que les chefs d’état alliés ne pouvaient pas planifier une opération majeure sans d’abord consulter Zaharoff.
En 1917, il détourne des chargements d’armes destinés au gouvernement provisoire et les livre aux Bolcheviks, en plus de faire pression sur le premier ministre Britannique Lloyd George pour qu’il prenne parti en faveur des bolcheviks.
Après la première guerre, Zaharoff se contente de fomenter de plus petites guerres entre états mineurs et se lance dans l’aventure pétrolière, créant la future British Petroleeum.

Lord Alfred Milner
Premier vicomte de Milner Né en Allemagne et descendant d’un gouverneur de l’Île-du-Prince-Édouard, il étudie à Londres où il brûle les échelons de la très haute fonction publique. Il se distingue par sa vision humaniste et généreuse en Afrique du Sud, où il déclenche la seconde guerre des Boers, au cours de laquelle il innove en parquant les civils dans des enceintes novatrices, véritables ancêtres des camps de concentration. 35 000 femmes et enfants y périssent, ce qui permet l’unification de l’Afrique du Sud sous la bannière impériale britannique.
À son retour d’Afrique, devient président de la minière Rio Tinto (cuivre, sulfites), contrôlée par la Banque d’Allemagne, qu’il dirige pendant 20 ans. Préside également la banque Midland et fait partie des fondateurs de la société The Round Table, essentiellement un club de candides conspirateurs impérialistes. Il est proche du fabricant d’armes Basil Zaharoff, de la Vickers, (grand consommateur de cuivre).
Fait partie des auteurs de la déclaration de Balfour en 1917, document précurseur de l’avènement de l’état d’Israël. Il est physiquement présent à Saint-Pétersbourg, en février 1917, au moment du soulèvement menchevik. Devient secrétaire des Colonies en 1918 ce qui en fait le délégué britannique signataire de l’infâme traité de Versailles. Proche de Henry Ford, il impose les tracteurs Ford en Angleterre.
Il dit de lui-même : « Je suis un nationaliste, pas un cosmopolite. Je suis un nationaliste britannique. Si je suis en plus un impérialiste, c’est parce que la destiné de la race anglaise, en raison de sa position insulaire et de sa longue suprématie navale, est parvenue à prendre racine dans différentes parties du monde. Je suis un impérialiste, et non un partisan de la petite-angleterre parce que je suis un patriote de la race britannique ».
 Raymond Robins
Raymond Robins
Un important membre de la mission est l’assistant de William B. Thompson, ce millionnaire du Klondike, il est devenu un militant « socialiste » en 1912 au contact de Franklin Delano Roosevelt. Lorsque Thompson quitte la Russie le 4 décembre 1917 pour retourner à ses affaires, Robins le remplace à la direction de la mission. Il envoie alors un câble à Washington disant : « (…) la reconnaissance des Bolcheviks est urgente, il aurait fallu l’offrir immédiatement (après le coup d’état - ndla) et si le gouvernement états-unien avait procédé de la sorte, nous serions déjà en contrôle des ressources russes et nous aurions des officiers de contrôle à tous les postes frontaliers. »
Après la chute du gouvernement Kerensky, le Colonel Robins fait cadeau à l’Armée Rouge de Trotski de plusieurs centaines de milliers de boîtes de lait condensé destinées aux nourrissons affamés.
Felix Djerzinski, le directeur et fondateur de la Tchéka, l’ancêtre du KGB, dit de Robins : « Robins a été le plus grand et le plus loyal ami des Bolcheviks parmi tous les étrangers sur place en Russie à l’époque. Il était le seul qui comprenait nos objectifs et sympathisait complètement avec nous et supportait notre gouvernement. Nous lui vouons la plus haute estime. »
Un télégramme de Robins adressé à Thompson, le 23 janvier 1918 :
« Gouvernement soviétique plus fort que jamais. Pouvoir et autorité consolidés grandement par dissolution de l’Assemblée constituante (...) De mon devoir d’insister fortement sur importance d’une prompte reconnaissance de l’autorité bolchevik (...) sommes tous d’accord sur ce point ».
W.L. SaundersFait partie des directeurs de la Federal Reserve Bank. Écrit au Président Wilson le 17 octobre 1918 qu’il « sympathise avec la forme de gouvernement soviétique », tout en prétendant n’être « aucunement motivé par la perspective de mettre la main sur le commerce mondial après la guerre ».
Jacob H. Rubin, un autre financier états-unien, membre des Francs-Maçons et du B’nai Brith, Jacob H. Rubin, soutiendra les Bolcheviks à Odessa en 1920. Né en Russie, il parle encore la langue lorsqu’il se rend sur place. Il est associé à la Union Bank de Milwaukee et à la Provident Loan Society de New York, dont P. A. Rockefeller et Mortimer Loeb Schiff (fils de Jacob Schiff et fondateur des Boy Scouts d’Amérique) étaient d’important actionnaires. C’est lui-aussi sous couvert d’une mission bidon de la Croix-Rouge que ce membre de longue date du parti socialiste se rend à Odessa pour y soutenir l’invasion de l’Armée Rouge. À un certain moment, la lune de miel entre lui et les bolcheviks se termine. Trois ans plus tard, après avoir moisi dans les prisons soviétiques, Rubin rentre aux États-Unis et déclare : « aucun gouvernement n’a jamais été aussi despotique que celui qui règne actuellement sur le malheureux peuple de Russie par un système de terrorisme. Quiconque prétend aujourd’hui que le peuple est bien traité sous les soviétiques est un simple menteur. »
Max May C’est l’Allemand Max May, vice-président de Guaranty Trust (une des banques de Morgan), qui sera le premier président du département étranger de la banque soviétique Ruskombank. Le 10 janvier 1918, Guaranty Trust annonce que Max May ne siégera plus au conseil d’administration jusqu’à la fin de la guerre. La banque déclare au New York Times que le patriotisme de Max May n’est pas remis en question, lui qui est devenu citoyen états-unien. On rappelle que « monsieur May n’a pas son égal dans le domaine des échanges internationaux, mais qu’il a demandé à être relevé de ses fonctions pour la durée de la guerre, ce à quoi le conseil n’a pas pu s’opposer ». On apprend dans le même article qu’en 1918, Max May brasse vingt millions de dollars par jour et que ses échanges annuels se montent à six milliards (en argent de l’époque). 18
 Thomas W. Lamont
Thomas W. Lamont
À la tête du Guaranty Trust de J.P. Morgan. Il fait partie des proches financiers du président Wilson et des fondateurs de la Federal Reserve. Il fait partie de la délégation états-unienne à la conférence de paix de Paris. Au cours des années suivantes, il est conseiller financier auprès de Benito Mussolini en plus de lui arranger un versement de 100 millions de dollars en 1926.
Otto H. Kahn, Directeur de l’American International Company (un holding réunissant Morgan et Rockefeller). Se joint à Schiff et Warburg pour exiger de Wilson de l’aide financière pour les Bolcheviks. Quelques années plus tard, il vante abondamment l’Italie mussolinienne aux investisseurs états-uniens, au même moment où AIC injectait des capitaux mirobolants en Russie Soviétique. Devient membre du Council on Foreign Relations en 1928.
Ivy LeeIl est le responsable des relations publiques des Rockefeller. Il est étonnamment chargé de vendre le bolchevisme aux États-Unis au cours des années 20.
Julius Hammer Le poste de directeur des finances du Soviet Mondial est détenu par Julius Hammer, qui débarque de Russie et devient un des leaders socialistes de New York. Sa famille maintiendra des liens intimes avec les Soviétiques à compter de 1917. Son fils Armand Hammer sera le directeur de la Occidental Petroleum Corporation.
Felix Frankfurter L’Autrichien Felix Frankfurter, un protégé de Jacob Schiff (le banquier qui a armé le Japon dans sa guerre contre la Russie en 1905), joue un rôle important dans le Soviet Mondial de New York et sera par la suite nommé juge de la Cour Suprême des États-Unis par Franklin Delano Roosevelt. Ami à vie de Walter Lippmann. Il a été un des fondateurs du American Jewish Congress et siège à la Conférence de Paix de Paris en tant que délégué Sioniste.
Complétons la liste par un personnage très étonnant, dont l’Histoire a un peu perdu la trace, ce qui est bien regrettable, de l’avis de l’auteur.
 Ludwik Christian Alexander Karl Martens
Ludwik Christian Alexander Karl Martens
Karl Gustav Adolf Martens, le papa de Ludwik, est un riche industriel allemand qui opère une des plus grandes usines d’acier du monde, située à Koursk, en Russie, à la frontière de l’Ukraine. Ludwik Martens fait la connaissance de Lénine à l’université de Saint-Petersbourg en 1893, où ils sont camarades de… classe, et il se joint aux marxistes. Arrêté pour ses activités séditieuses et déporté en Allemagne en 1899. Il émigre ensuite à Londres en 1906.
La guerre éclate en 1914, opposant la Russie du Tsar à l’Allemagne du Kayser. Petit souci : en 1915, Les Russes soupçonnent les Martens de travailler contre eux pour le compte de leur mère patrie et confisquent l’usine familiale. En 1916, Ludwik déménage à nouveau, cette fois à New York, où il s’intègre au milieu dynamique (et humaniste) des banquiers de Wall Street.
En 1917, fiston Ludwik est vice-président d’une firme d’ingénieurs dont les locaux sont situés au 120, rue Broadway à New York. Deux ans plus tard, en 1917, Ludwig Martens fait partie de l’expédition des 278 Russes qui quittent les États-Unis en compagnie de Léon Trotski après l’annonce du succès de la révolution de février des Mencheviks.
Nous ne savons pas grand chose de ses activités en Russie sous le couvert de la mission humanitaire de la croix-rouge. Il est cependant possible de déduire en quoi consistaient ses projets, puisque nous avons la chance de connaître la suite. Les Bolcheviks renversent donc le gouvernement élu en décembre 1917 et Martens s’affaire parmi eux en tant que membre à part entière du mouvement soviétique.
Une fois les soviétiques bien en place, Martens revient à New York en 1919 pour fonder le Soviet Mondial avec des fonds de Guaranty Trust, une des banques de JP Morgan. C’est cet États-unien britannique d’origine Allemande qui devient alors l’ambassadeur russe non-officiel aux États-Unis. Il établit son ambassade à Wall Street, New York, plutôt qu’à Washington. Aux abois, le département d’État perquisitionne les bureaux du Soviet Mondial et Martens est convoqué par le sous-comité du Congrès aux Affaires extérieures, le premier février 1920. Il est soupçonné de fomenter une révolution bolchevik aux États-Unis.
Il témoigne devant le sous-comité que la propagande de son organisation n’a jamais visé les radicaux ou le prolétariat et qu’au contraire, leurs efforts sont essentiellement concentrés du côté des grandes entreprises telles que Guaranty Trust, Chicago Packers, United Steel, Standard Oil, Swift, Nelson Morris, American Steel, International Harvester, etc. Il déclare à cette occasion que les plus grandes corporations États-Uniennes appuient le gouvernement soviétique. L’enquête qui suit corrobore très clairement ses dires, malgré les fortes dénégations médiatiques des grands industriels. Accablé par le dossier du département d’État, Martens est déporté vers l’Union Soviétique en 1921.
De retour en Russie, il voit ses petits amis bolcheviks lui offrir la direction du Soviet Suprême de l’Économie Nationale, puis la direction de Glavmetal, le monopole étatique de… l’acier ! C’est en cette qualité qu’il hérite bien vite de la direction de l’ancienne usine d’acier de son papa à Koursk, qu’il a tout le loisir de moderniser et transformer en l’un des plus immenses chantiers de fer et d’acier du monde.
Histoire d’en situer l’importance, rappelons qu’une des plus grandes batailles de l’histoire de l’Humanité a lieu à Koursk, en 1943. Les état-majors Russe et Allemand vont tout risquer pour cet objectif, défendu avec succès par Staline, mais au prix de sacrifices démentiels, à peine croyables : 250 000 morts et 650 000 blessés, soit des pertes de près d’un million d’hommes ! Ça sera le tournant, le clou dans le cercueil de la campagne de Russie. Le plus grand sous-marin jamais construit a été baptisé le Koursk, coulé dans une affaire vaseuse dont on ne connaît toujours pas le fond.
Ludvik Martens passe le reste de ses jours au sommet de l’État soviétique et fait partie des très rares meneurs « Bolcheviks » qui parviennent à éviter toutes les purges de Staline sans tracasserie. Il est enterré au cimetière honorifique de Novodevichy, où il est voisin d’asticots de Gogol, Tchekov et Rubinstein. Encore un peu, on lui faisait une place dans le mausolée, au Kremlin. Un vrai conte de fées.
Détail marrant, c’est en 1917, au cours du séjour de Martens en Russie, que notre cher Iossif Djougashvili abandonne tous ses pseudonymes au profit de celui de Staline et entreprend son ascension fulgurante vers le sommet du gouvernement soviétique. Staline veut dire acier, en russe.
La Suite du beau programme
Izvestia est fondée le 13 mars 1917. 15 mars, abdication du Tsar. Les Mencheviks tiennent parole et organisent des élections. L’élection nationale est un petit désastre pour les Bolcheviks, qui n’obtiennent que 175 sièges sur 707. C’est le Social Révolutionnaire Viktor Tchernov qui est élu président de l’assemblée. La patience de Lénine et de Wall Street est à bout.
Tant pis ! Entre le 6 et le 8 novembre, le groupe de Lénine procède joyeusement à son coup d’état et renverse sans trop forcer le gouvernement élu. C’est de ces trois petites journées que parle depuis ce jour l’Histoire officielle quand elle mentionne, des trémolos dans la voix « la révolution d’octobre ».
Le gouvernement des putschistes bolcheviks s’active ensuite avec une énergie frémissante ! Le siège du gouvernement est déplacé de Saint-Petersbourg à Smolny. La National City Bank de J.P. Morgan est exemptée par le décret de nationalisation des banques signé par Lénine au moment de sa prise de pouvoir. À la toute première session du gouvernement bolchevique, Lénine convoque Doukhonine, le général en chef de l’armée Russe pour exiger des pourparlers immédiats en vue d’une paix avec l’Allemagne. Celui-ci refuse ? Il est exécuté.
Le 17 novembre, censure globale sur tout le territoire russe : le contrôle de toutes les publications est assumé par les Bolcheviks, qui confient bientôt l’information à un monopole des deux journaux, Izvestia et… Pravda. La Tcheka (police secrète) est instaurée en décembre, dirigée par Felix Djerzinski. Chose très étrange, elle comprend entre autres 500 ressortissants chinois, à qui on confie les exécutions sommaires. Le 25 novembre, Leon Trotski se moque des Mencheviks alors qu’ils quittent le conseil des soviets : « Vous êtes des individus piteux et isolés, vous êtes ruinés, votre rôle est accompli. Allez rejoindre la place qui vous appartient désormais — dans la poubelle de l’histoire ».
Un rapport du département d’État des É-U daté de décembre 1917 avertit que le gouvernement de Smolny (quartier général bolchevik) est absolument sous contrôle de l’État Major Allemand et que plusieurs ou même une majorité de Bolcheviks viennent des États-Unis. Pourtant, le 28 novembre, le président Woodrow Wilson avait ordonné la non-intervention contre le coup d’état bolchevik en préparation. Puis, étonnamment, le 12 décembre, Wilson autorise le secrétaire d’état Robert Lansing à aider financièrement le mouvement contre-révolutionnaire du général Kaledin, dont la rébellion cosaque et monarchiste déstabilise le gouvernement révolutionnaire de Kerensky et des Mencheviks.
Le 14 janvier, une première tentative d’assassinat contre Lénine avorte (commise par des hommes armés non-identifiables). L’assemblée constituante est fermée par les Bolcheviks le 19 janvier 1918. Les gardes rouges ouvrent le feu sur les manifestants. Vingt d’entre eux périssent. L’opposition est jetée en prison.
Le 3 mars 1918, la délégation bolchevique signe le traité de Brest-Litovsk, cédant la Pologne, les États Baltes, l’Ukraine, la Finlande et la Bessarabie, plus une lisière entre Kars et Trézibonde longeant la frontière Turque, un total de 62 millions de citoyens. Une clause secrète est ajoutée selon laquelle Lénine rend aux Allemands 90 tonnes d’or, ce qui en principe nous donne une idée des fonds fournis par le Kaiser pour favoriser la montée en puissance des Bolcheviks. Ulcérés par le traité, les SR se retirent de la coalition Bolchevik. Ils sont immédiatement persécutés. Plusieurs leaders importants de la révolution démissionnent : Bukharin, Bubnov, Piatakov, Dzherzhinsky, Smirnov et le chef de la Tcheka de Saint-Petersbourg, Moisei Uritski. Un congrès extraordinaire du parti Bolchevik est convoqué les 6, 7 et 8 mars. Uritski reprend son poste à la Tcheka lorsque la guerre civile éclate, le 25 mai.
En juillet 1918 le Tsar et toute sa famille, femmes et enfants compris, sont exécutés.
Le 30 août, double attentat contre Uritski à Saint-Petersbourg et Lénine à Moscou. Le premier y laisse la vie et le second est blessé gravement. Staline propose alors la terreur rouge, pour s’attaquer aux responsables. Dès septembre, près de 790 fonctionnaires sont exécutés par la Tcheka. Une vague de brutalité inouïe submerge alors l’opposition. Tortures, passages à tabac, amputations, viols pour les chanceux. Les autres sont abattus, noyés, enterrés vivants, découpés à l’arme blanche, congelés… Les archives officielles soviétiques font état de 12 733 exécutions entre 1918 et 1920. L’historien Orlando Figa parle de près de 300 000 assassinats.
Un nombre impressionnant de socialistes et de Bolcheviks réalisent qu’ils ont été trahis et prennent les armes. C’est l’Armée Verte, subtilement effacée de l’histoire officielle, malgré ses 130 divisions. Les Armées Blanches, monarchises, réactionnaires, sont mieux mises en marché. Une force d’invasion États-unienne s’empare d’Archangelsk, dans l’extrême Nord, tandis que les Britanniques croquent la perle noire, Bakou, au Sud. Guerres, exécutions de masse, révoltes, famines, épidémies, tout l’empire se décompose en une immense et infecte mare de souffrance et de mort, affectant les vies de centaines de millions de personnes. On arrête pas le progrès.


 Alain Finkielkraut en compagnie de l’ambassadeur de Croatie en France
Alain Finkielkraut en compagnie de l’ambassadeur de Croatie en France se mit à comparer Kusturica à Céline : un génie raciste.
se mit à comparer Kusturica à Céline : un génie raciste. pu décider de donner un grand retentissement à la sortie du film afin de séduire le même Lagardère alors qu’ils espéraient une recapitalisation de leur hebdomadaire. Le journal fera sa « une » sur le film, présentera un carnet de tournage, une interview du réalisateur, une autre de Maurice Jarre, auteur de la Bande originale, et publiera un « Pour/Contre ».
pu décider de donner un grand retentissement à la sortie du film afin de séduire le même Lagardère alors qu’ils espéraient une recapitalisation de leur hebdomadaire. Le journal fera sa « une » sur le film, présentera un carnet de tournage, une interview du réalisateur, une autre de Maurice Jarre, auteur de la Bande originale, et publiera un « Pour/Contre ». 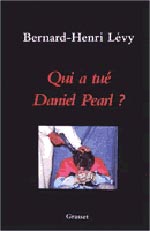 étudiants iraniens et qu’il est signataire, avec Bernard Henri Lévy, d’un appel en faveur de la « Révolution du Cèdre » au Liban. Les deux hommes avaient, auparavant, défendu la « révolution » orange en Ukraine
étudiants iraniens et qu’il est signataire, avec Bernard Henri Lévy, d’un appel en faveur de la « Révolution du Cèdre » au Liban. Les deux hommes avaient, auparavant, défendu la « révolution » orange en Ukraine Le Point dans son dernier numéro (12 mai 2005) propose dans ses pages un débat dans lequel Alain Finkielkraut dénonce à nouveau le « nouvel antisémitisme » et le « racisme anti-blanc » des populations arabes françaises tandis que Bernard Henri Lévy dans son Bloc-Note dénonce la collusion du Pakistan et d’Al Qaïda.
Le Point dans son dernier numéro (12 mai 2005) propose dans ses pages un débat dans lequel Alain Finkielkraut dénonce à nouveau le « nouvel antisémitisme » et le « racisme anti-blanc » des populations arabes françaises tandis que Bernard Henri Lévy dans son Bloc-Note dénonce la collusion du Pakistan et d’Al Qaïda. 
 petit-fils du lieutenant Lipscomb Norvel, et cousin du Sénateur John Norvell, débute sa vie comme journaliste, mais se fait vite remarquer en 1854 en se lançant, à la tête d’une armée de mercenaires, à l’assaut des provinces mexicaines de Baja et Sonora. Il s’en proclame ensuite le président, jusqu’à ce que l’armée mexicaine le repousse en Californie.
petit-fils du lieutenant Lipscomb Norvel, et cousin du Sénateur John Norvell, débute sa vie comme journaliste, mais se fait vite remarquer en 1854 en se lançant, à la tête d’une armée de mercenaires, à l’assaut des provinces mexicaines de Baja et Sonora. Il s’en proclame ensuite le président, jusqu’à ce que l’armée mexicaine le repousse en Californie. Il échappa à la mort au Fort Alamo (en évitant simplement de s'y trouver) et réussit ensuite l'inénarrable en gagnant sa survie lors de la tenue par le général Santa-Ana de la célèbre loterie des bines, au cours de laquelle un prisonnier sur dix parmi un groupe d'évadés repris allait être exécuté. Il s'évada de nouveau et entra pour de bon dans la légende.
Il échappa à la mort au Fort Alamo (en évitant simplement de s'y trouver) et réussit ensuite l'inénarrable en gagnant sa survie lors de la tenue par le général Santa-Ana de la célèbre loterie des bines, au cours de laquelle un prisonnier sur dix parmi un groupe d'évadés repris allait être exécuté. Il s'évada de nouveau et entra pour de bon dans la légende. Les bonnes gens de ce monde sont bien loin d’être satisfaits les uns des autres et mes armes sont les meilleurs pacificateurs qui soient.
Les bonnes gens de ce monde sont bien loin d’être satisfaits les uns des autres et mes armes sont les meilleurs pacificateurs qui soient.  John Davidson Rockefeller
John Davidson Rockefeller voisin appartenant à son ami Harriman. Puis, en 1910, il finance et organise l’Association pour la Recherche Eugénique. Et encore, la même année, l’Office des Données Eugéniques. C’est une passion !… En 1911, son ami et avocat John Foster Dulles résume ainsi la science eugéniste : « en éliminant les membres plus faibles de la population, une race plus pure pourra être créée »
voisin appartenant à son ami Harriman. Puis, en 1910, il finance et organise l’Association pour la Recherche Eugénique. Et encore, la même année, l’Office des Données Eugéniques. C’est une passion !… En 1911, son ami et avocat John Foster Dulles résume ainsi la science eugéniste : « en éliminant les membres plus faibles de la population, une race plus pure pourra être créée » John Pierpont Morgan
John Pierpont Morgan

 Jacob Henry Schiff
Jacob Henry Schiff



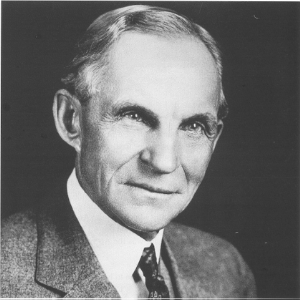

 Si nous comprenons les mécanismes et les motivations de la pensée de groupe, ne pouvons-nous pas contrôler et enrégimenter les masses selon notre volonté, sans qu’elles ne s’en doutent? La pratique récente de la propagande a prouvé que c’était possible, du moins jusqu’à un certain point. — Edward Bernays, Propaganda, 1928
Si nous comprenons les mécanismes et les motivations de la pensée de groupe, ne pouvons-nous pas contrôler et enrégimenter les masses selon notre volonté, sans qu’elles ne s’en doutent? La pratique récente de la propagande a prouvé que c’était possible, du moins jusqu’à un certain point. — Edward Bernays, Propaganda, 1928 Teapot Dome
Teapot Dome En 1939, Bernays participe de multiples façons à l’Expo Mondiale se déroulant à New York. Bernays est entiché par le lien entre la corporation et la démocratie. General Motors et Ford dominent l’exposition.
En 1939, Bernays participe de multiples façons à l’Expo Mondiale se déroulant à New York. Bernays est entiché par le lien entre la corporation et la démocratie. General Motors et Ford dominent l’exposition. La compagnie Mack Trucks engage Bernays en 1949. Leur problème : ils ne peuvent pas vendre plus de camions. Ils ont saturé le marché. Eddie réalise que la concurrence ne vient pas des autres fabricants, mais bien du chemin de fer. Il parvient à imposer à son client une idée totalement folle, s’attaquer aux trains en faisant une promotion rageuse de l’autoroute. Une fortune est engloutie dans le projet. On forme des comités de citoyens bidons, de faux experts écrivent de vrais articles qui paraissent un peu partout, la pression populaire pèse sur des autorités déjà corrompues par des contributions non négligeables, c’est un véritable raz-de-marée qui prend d’assaut la campagne américaine ! On la couvre de routes ! Faut dire que General Motors est également client de Bernays, et que les tentacules supposément détachées de Standard Oil sont bel et bien là pour contribuer à l’effort. C'est juste si Bernays ne sort pas de sa manche un autre de ses Comités Nationaux des Médecins de Famille pour vanter les vertus de l'asphalte dans la lutte aux ongles incarnés. La civilisation de l’automobile prend son véritable essor.
La compagnie Mack Trucks engage Bernays en 1949. Leur problème : ils ne peuvent pas vendre plus de camions. Ils ont saturé le marché. Eddie réalise que la concurrence ne vient pas des autres fabricants, mais bien du chemin de fer. Il parvient à imposer à son client une idée totalement folle, s’attaquer aux trains en faisant une promotion rageuse de l’autoroute. Une fortune est engloutie dans le projet. On forme des comités de citoyens bidons, de faux experts écrivent de vrais articles qui paraissent un peu partout, la pression populaire pèse sur des autorités déjà corrompues par des contributions non négligeables, c’est un véritable raz-de-marée qui prend d’assaut la campagne américaine ! On la couvre de routes ! Faut dire que General Motors est également client de Bernays, et que les tentacules supposément détachées de Standard Oil sont bel et bien là pour contribuer à l’effort. C'est juste si Bernays ne sort pas de sa manche un autre de ses Comités Nationaux des Médecins de Famille pour vanter les vertus de l'asphalte dans la lutte aux ongles incarnés. La civilisation de l’automobile prend son véritable essor.





 On ramassait le pétrole à la main, à Bakou, depuis l’antiquité. On s’en servait pour s’éclairer. Les historiens arabes du neuvième, dixième et treizième siècles relatent déjà l’importance de cette ressource dans la région. Marco Polo en parle dans ses récits de voyages. Le voyageur allemand Adam Oleari décrit en 1636 une trentaine de puits de pétrole qui giclent avec une grande puissance. En 1683, on exporte la production dans des outres chargées sur des chameaux et par navire jusqu’au Dagestan.
On ramassait le pétrole à la main, à Bakou, depuis l’antiquité. On s’en servait pour s’éclairer. Les historiens arabes du neuvième, dixième et treizième siècles relatent déjà l’importance de cette ressource dans la région. Marco Polo en parle dans ses récits de voyages. Le voyageur allemand Adam Oleari décrit en 1636 une trentaine de puits de pétrole qui giclent avec une grande puissance. En 1683, on exporte la production dans des outres chargées sur des chameaux et par navire jusqu’au Dagestan. En 1905 ont lieu les pires pogroms contre les juifs, souvent près des fiefs où œuvrent les Rothschild ou des industries qui leurs sont liées. Les émeutes, révoltes et massacres font 2000 morts et d'innombrables blessés chez les juifs. De 1905 à 1907 la Russie est le théâtre de nombreux assassinats, attentats terroristes et sabotages, toujours pilotés par l'Okhrana, dont on arrive à se demander parfois pour qui elle travaille.
En 1905 ont lieu les pires pogroms contre les juifs, souvent près des fiefs où œuvrent les Rothschild ou des industries qui leurs sont liées. Les émeutes, révoltes et massacres font 2000 morts et d'innombrables blessés chez les juifs. De 1905 à 1907 la Russie est le théâtre de nombreux assassinats, attentats terroristes et sabotages, toujours pilotés par l'Okhrana, dont on arrive à se demander parfois pour qui elle travaille.




